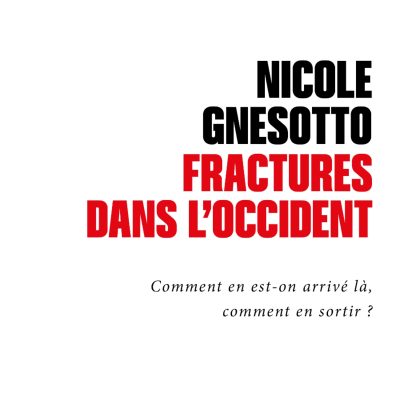Europe: la nécessité d’agir

La littérature portant sur les dix ans de crises auxquels l’Europe a dû faire face est désormais abondante ; celle consacrée à leurs implications politiques pour l’Union l’est beaucoup moins. Or, le moment est venu de s’interroger sur les enseignements politiques que l’on peut tirer aujourd’hui de ces événements. Tel est l’objectif du dernier ouvrage de Luuk van Middelaar, Quand l’Europe improvise, paru aux Pays-Bas en 2017, et qui vient d’être traduit en français aux éditions Gallimard: « sous la pression des événements, une nouvelle Union prend forme. Il est temps d’en brosser les contours » (p. 18) ; il s’agit d’ « apporter la clarté sur ce qui se passe. Pas de jugement sans appel, pas de « solutions » toutes faites, pas de polémiques universitaires : offrir des explications et des analyses en partant d’histoires, d’images et de concepts afin de permettre au lecteur de mieux juger les événements par lui-même et d’agir en conséquence » (p. 8). Le premier intérêt du livre est qu’il a été écrit par un « acteur / spectateur engagé » d’une partie de cette période (2010-2015) puisque l’auteur, historien et philosophe, était la plume du premier Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Il s’était illustré par le très remarqué Passage à l’Europe (éd. Gallimard, 2012).
L’ouvrage se compose de deux parties – la première consacrée aux quatre crises majeures qui ont affecté l’Union depuis 10 ans : la crise de la zone euro ; la crise ukrainienne ; la crise des migrants et la « crise atlantique » avec le référendum britannique sur le Brexit et l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis. L’argument de l’auteur consiste ici à montrer que ces différentes crises doivent provoquer chez les Européens une prise de conscience de leur finitude et de leur vulnérabilité historique. Pour le dire autrement, ces épreuves conduisent à une prise de conscience de soi et font entrer l’Europe dans un « moment machiavélien », véritable « moment existentiel » : « Se savoir mortel conduit à se penser comme unité fortuite dans le flux du temps et à s’armer en conséquence. C’est bien là une nouvelle prise de conscience du moment machiavélien de l’Europe » (p. 190 et 323).
La seconde partie du livre opère une critique des limites de la méthode fonctionnaliste « classique » (de la « théologie supranationale » selon l’expression de l’ancien ministre des Affaires étrangères français Maurice Couve de Murville citée par l’auteur) et du logiciel communautaire sur la base desquels la construction européenne a été légitimée et a fonctionné depuis ses débuts. Cette critique s’appuie sur une analyse des implications du fonctionnalisme en termes de dépolitisation, que l’auteur présente sous différentes formes : technique, constitutionnelle et procédurale mais aussi « téléologique ou évangélique » et du pouvoir exécutif (p. 332-365). L’auteur cherche à montrer, avec raison, que le changement de nature de la construction européenne depuis 1989 – la transformation de la communauté en Union (véritable « deuxième fondation », p. 229-259) – implique un changement radical de méthode : au mode de légitimation technocratique et « légal-rationnel » par les projets et les résultats, il faut substituer un mode de légitimation politique et à la « politique de la règle » une « politique de l’événement » indispensable face aux crises. La politique et la démocratie consistent fondamentalement dans l’expression et la gestion des conflits entre intérêts et des différends ; dans des sociétés marquées par les inégalités, les divergences d’opinion, les incertitudes vis-à-vis de l’avenir, il faut faire des choix, trancher entre des intérêts et c’est là le champ incontournable de la politique qu’il faut faire vivre au sein de l’UE. C’est un registre incontournable de la vie politique et substituer la « politique de la règle » des institutions indépendantes et des technocraties spécialisées aux conflits d’idées ou d’intérêts est illusoire et même dangereux puisqu’elle favorise le renforcement du clivage entre populismes et technocraties.
Ici se situe le cœur de l’analyse du livre de Luuk van Middelaar, comme en témoigne l’ « entracte » entre les deux parties intitulée « Agir dans le temps » : l’effort pour penser l’émergence, sous l’effet des crises, des conditions à réunir pour répondre aux questions clés au cœur de la situation politique de l’Europe. Tout d’abord celle de l’autorité et d’un véritable pouvoir exécutif qui donnent une capacité à agir, c’est-à-dire à décider dans des circonstances exceptionnelles; ensuite, celle de la légitimité à travers la politisation de son fonctionnement en mettant en scène les oppositions « classiques » qui existent d’ores et déjà au sein de l’UE (chap. 7) sauf à maintenir les oppositions de « principe » portées par les forces politiques populistes ou / et extrémistes à l’extérieur de l’Union et à menacer l’existence même de celle-ci (p. 384). L’Europe est confrontée à de multiples crises qui exigent résolution, pouvoir de décision et capacité d’action légitime et c’est cette interrogation fondamentale qui constitue le cœur de la réflexion de Luuk van Middelaar.
La réponse à ces deux questions fondamentales que l’auteur tire des dix années de crises récentes réside dans le rôle joué par les chefs d’Etat et de gouvernement et dans l’autorité européenne (« focus of authority » selon l’expression d’Edward Heath cité par l’auteur) qu’ils incarnent à l’échelle de l’Union. Cette thèse est à première vue séduisante dans la mesure où elle théorise a posteriori la prééminence des gouvernements nationaux en matière décisionnelle, prééminence qui repose sur le fait que seuls les chefs d’État et de gouvernement disposent de la légitimité politique ultime pour prendre des décisions stratégiques face à des défis politiques qui revêtent la forme de « chocs de souveraineté », que ce soit dans le domaine de la monnaie, des frontières, de la guerre et de la paix, etc.
Pourtant, à l’issue de la lecture de cet ouvrage très stimulant, on peut formuler un certain nombre d’interrogations.
La première porte sur la distinction entre la « politique de la règle » et la « politique de l’événement ». L’argument de l’auteur paraît à première vue convaincant et l’on peut s’accorder avec lui pour reconnaître que la transformation de l’UE et la nature politique des défis à relever nécessitent un changement de logiciel quant à la manière de concevoir la décision ainsi que la redéfinition de l’équilibre entre la « règle » et le « choix » discrétionnaire: si la gestion de certaines politiques communes appelle naturellement le recours à la régulation (la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles par exemple), la nature politique des défis auxquels est confrontée l’Union est telle qu’un grand nombre de questions de nature régalienne, qu’il est urgent de traiter, relèvent davantage d’un mode de « gouvernement » (comme « autorité visible ») que de la simple « gouvernance » (et son « administration anonyme », p. 27), par exemple dans le domaine budgétaire, du contrôle des frontières extérieures, de la défense des intérêts communs européens où un pouvoir « discrétionnaire » est indispensable.
Pourtant, il également possible de souligner que les crises ont révélé que des institutions indépendantes dont les prérogatives les placent plutôt du côté de la « politique de la règle » peuvent exercer un pouvoir de décision les plaçant plutôt du côté de la “politique de l’événement”. À titre d’exemple, la Banque Centrale Européenne (BCE) – qui est une institution fédérale mais dont la légitimité repose sur l’indépendance – a fait preuve d’une capacité de réaction rapide et de gestion de crise face aux circonstances exceptionnelles ; il est d’ailleurs remarquable que la crise ait renforcé le rôle de la BCE qui est la seule institution européenne disposant d’un instrument contracyclique immédiatement mobilisable. Seul son rôle de prêteur en dernier ressort a du reste été de nature à rassurer les marchés en dépit du cadre imposé par son mandat. Autre exemple : la Commission européenne a utilisé ses prérogatives en matière de concurrence (la prohibition des aides d’État, y compris des aides fiscales, par les articles 107 et 108 du Traité) pour lutter, efficacement, contre la concurrence fiscale déloyale : l’Irlande a notamment été condamnée à exiger 13 milliards d’impôts de la seule société Apple.
La deuxième interrogation porte sur l’efficacité de l’ « autorité » européenne qu’incarnerait le Conseil européen. Certes, dans des circonstances exceptionnelles, les crises peuvent avoir des vertus positives pour l’Europe, au point d’accréditer l’idée que la « construction européenne progresse souvent grâce aux crises ». Ce caractère potentiellement favorable des crises renvoie au fait qu’elles suscitent une mobilisation politique hors norme, au plus haut niveau des États membres. Il tient aussi au fait que l’urgence impose de prendre des décisions qu’il aurait été plus difficile de prendre selon les rythmes et procédures habituels. Mais, la prééminence des gouvernements nationaux en matière décisionnelle a aussi des conséquences ambivalentes sur la gouvernance européenne face aux crises. Pour le dire en d’autres termes, certes l’ « improvisation » peut présenter un « aspect positif, créatif » et permettre de saisir l’opportunité d’un espace de liberté pour décider et agir ; mais elle peut aussi révéler des « maladresses et des défauts » (p. 40).
La prégnance de la logique diplomatique peut entraîner en effet des conséquences négatives qui sont d’autant plus dommageables en période de crise : difficulté pour l’Union à s’exprimer de manière unifiée et à agir avec efficacité et réactivité ; neutralisation des États membres qui crée alors une incertitude dont les effets sont très dangereux en période de crise. Par ailleurs, il existe de plus en plus de décalage entre le mode de fonctionnement actuel des institutions européennes et les exigences de la crise : le temps des négociations diplomatiques est trop lent (ce que l’auteur reconnaît d’ailleurs lui-même ; cf. p. 56) et le sentiment s’est progressivement développé que l’Europe était toujours en retard d’une crise. Enfin, ce mode de fonctionnement est anxiogène et déstabilisateur : l’issue des négociations est toujours incertaine, les positions des différents gouvernements semblent régulièrement soumises aux calendriers électoraux nationaux (voire régionaux), les décisions prises par les gouvernements peuvent ensuite être remises en cause au niveau national, surtout dans un contexte où de nombreux gouvernements sont très fragilisés politiquement dans leur pays. Ainsi, un pouvoir exécutif morcelé ou pluriel n’est pas optimal du point de vue du critère de l’efficacité.
La troisième interrogation porte sur la question de la légitimité d’une telle « gouvernance ». Le mode de fonctionnement actuel, qui donne notamment la primauté au Conseil européen, pose en effet un problème de lisibilité et de légitimité pour les citoyens européens. Certes, l’action politique se situe toujours à la « frontière de la contrainte et de la liberté » (p. 41) ; mais, depuis dix ans, il est évident que des décisions n’ont pu être prises au niveau national ou européen que sous la contrainte de l’urgence. Or cette contrainte a un coût considérable économiquement, comme la crise de la zone euro l’a montré, mais aussi politiquement puisqu’elle réduit l’espace du choix et de la responsabilité politiques. Hors de l’urgence, la capacité de décision semble également extrêmement réduite : la répétition de négociations conflictuelles et prolongées a souligné les limites du modèle intergouvernemental dans lequel la diplomatie l’emporte sur la démocratie. Plus exactement, chaque État membre se prévaut de sa légitimité démocratique nationale sans qu’une légitimité démocratique européenne permette de résoudre les conflits entre mandats démocratiques nationaux dont l’addition ne produit pas un mandat démocratique européen. Il en résulte une frustration grandissante qui nourrit l’euroscepticisme. Et, dans un cercle vicieux, cette frustration rend plus difficile l’union politique qui permettrait de créer les conditions d’une intégration mieux légitimée.
Par ailleurs, toujours sur le registre de la légitimité, un système démocratique suppose de pouvoir répondre à la question « qui fait quoi ? », condition de la responsabilité politique des gouvernants (p. 310-314). L’auteur définit lui-même le Conseil européen comme un pouvoir exécutif « collectif », comme une « sorte de Chef d’Etat à plusieurs têtes, travaillant autour d’une table ronde et non pas dans un bureau ovale » (p. 245). Or, une telle polyarchie et une telle fragmentation (dont les expressions « Conseil européen », « Eurogroupe » mais aussi « troïka », « task force », ou encore « groupe des 4 », etc. – désignant les Présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de l’Eurogroupe et de la Banque centrale européenne – fournissent une formulation saisissante) ne peut conduire qu’à une dilution de la responsabilité politique qui doit dès lors être clarifiée. Sur ce point, il est frappant de rappeler les termes dans lesquels les Pères fondateurs de la démocratie américaine évoquaient déjà ce risque. Ils soulignaient en effet que, non seulement un exécutif pluriel ne peut ni agir ni décider efficacement, mais de surcroît empêche l’effectivité des mécanismes de responsabilité : « l’une des plus puissantes objections élevées contre la pluralité dans l’Exécutif (…), c’est sa tendance à cacher les fautes et à détruire la responsabilité ».
Quatrième remarque enfin. L’argument de l’auteur sur la nécessaire politisation de l’UE – argument que nous partageons – conduit à combiner politisation et intergouvernementalisme ou « confédéralisme » (c’est-à-dire l’ « apport direct des Chefs d’Etat et de gouvernement », p. 357). Or, les deux ne sont pas nécessairement liés. Cette vision, incarnée dans l’histoire de la construction européenne notamment par le général de Gaulle, part du présupposé que les seuls « producteurs du politique » sont les élites politiques nationales. La politisation de l’intégration européenne passerait donc par le renforcement de l’intergouvernemental, les institutions communautaires étant par définition technocratiques.
Cette approche est potentiellement contradictoire, fondée sur une confusion entre les différents sens du mot « politique », en français : au lieu de permettre la mise en place d’une politique européenne (politics), elle l’empêche en affirmant un monopole des politiques (politics) nationales sur la formulation des politiques (policies) européennes. Or, il convient de favoriser précisément l’émergence d’un véritable espace de représentation politique européen, autrement dit d’une politique (politics) européenne comme espace de formation des politiques (policies) communautaires. Pour le dire autrement, et en termes de légitimité démocratique, accepter l’idée que le renforcement de l’intergouvernementalisme constituerait un levier de la politisation de l’UE reviendrait à considérer que la juxtaposition et l’addition de légitimités démocratiques nationales produirait une légitimité démocratique européenne, ce qui n’est pas le cas (voir plus haut).
Pour autant, cela ne signifie pas que la politisation devrait nécessairement déboucher sur une fédéralisation de l’Union européenne. En effet, il est possible de concevoir une politique (politics) européenne sans pour autant postuler une évolution de l’Union européenne vers un Etat fédéral européen. Il est donc essentiel d’éviter la confusion entre ces deux concepts et ces deux débats. Si l’Union européenne devrait être davantage politisée, dotée d’une représentation politique autonome et sûre de sa légitimité démocratique, cette évolution pourrait rester, au moins à moyen terme, éloignée du modèle fédéral. En effet, une fédéralisation nécessiterait une redéfinition des compétences de l’Union, un renforcement significatif de son budget ou encore un net affaiblissement de la dimension intergouvernementale dans les processus de décision. Or, il n’est pas du tout certain que le contexte politique actuel en Europe permette d’envisager ce type d’évolutions aujourd’hui.
« Politiser » davantage l’UE afin que celle-ci devienne un véritable espace politique de choix et plus seulement un espace technocratique de régulation dont la légitimité reposerait sur les seuls résultats produits suppose de rompre avec l’idée que les choix opérés au niveau européen se résumerait aux trois options qui structureraient actuellement la « politique » européenne : d’un côté, une technocratie européenne composée d’experts dépolitisés et, de l’autre, le populisme nationaliste ; entre les deux, la vie politique européenne serait réduite aux jeux de la négociation diplomatique entre les chefs d’État et de gouvernement, dont on connaît les conséquences négatives qui en résulte en termes de responsabilité et de légitimité. Or, dans les trois cas, l’idée véhiculée est qu’il n’y a pas de système de représentation politique qui fonctionne, ce qui est très dangereux ! Une telle situation doit conduire à prendre en considération la souveraineté populaire à l’échelle de l’Union laquelle peut s’exprimer à travers un cadre parlementaire. Ce qui importe, c’est de mettre en place et de rendre visibles les modalités institutionnelles permettant aux peuples de participer au jeu démocratique européen de manière directe, à travers un système de représentation politique clair et lisible, et d’avoir ainsi le sentiment légitime d’exercer leur influence politique.
Une telle politisation accrue des institutions de l’UE doit permettre à ces dernières de s’appuyer davantage sur un mandat démocratique, et à son fonctionnement d’obéir davantage à des logiques partisanes. C’est un virage délicat à prendre, mais à vouloir l’éviter, la sortie de route risque de devenir inévitable. Cela implique un rééquilibrage avec la culture du consensus, dominante au niveau européen, l’introduction d’une polarisation majorité/opposition et la descente du piédestal de l’expertise dans l’arène de la politique et ce sans pour autant entraîner nécessairement le passage au fédéralisme. En effet, politiser le niveau décisionnel européen n’équivaut pas à lui conférer la souveraineté au détriment des États.
En dépit de ces interrogations et de ces remarques, nous ne pouvons que nous accorder avec la thèse générale défendue par Luuk van Middelaar quant à la nécessité pour l’Europe de se doter une véritable autorité politique légitime capable d’agir face aux événements. Face aux défis internes et externes qui constituent de véritables « chocs de souveraineté », l’UE est interpellée par des défis pour lesquels elle n’a pas été construite (migrations, défis de sécurité, mais aussi « défense » commerciale, etc.). La pression des événements (Italie, politique américaine, etc.) peut-elle permettre de favoriser la cohésion des Européens et d’accélérer les changements nécessaires afin de répondre à ces défis ? Dans un contexte où la logique du rapport de force est primordiale, il faut que les Européens parviennent à penser et à agir en termes stratégiques afin de développer une capacité à peser dans ces rapports de force et à défendre non seulement leurs valeurs mais aussi leurs intérêts stratégiques communs. Cela suppose le « passage » de la paix à la puissance, du forum à l’arène, de l’éthique de conviction à la responsabilité pratique et politique ; etc. Les crises poussent les Européens à devoir agir en tant que corps politique ce qui suppose de briser un certain nombre de tabous et d’impensés afin de prendre au sérieux certaines exigences politiques fondamentales : notamment celle des frontières et celle de l’identité.
Or, « historiquement l’Europe n’est qu’à moitié préparée à une telle mission. Les fondateurs ont poursuivi deux objectifs en parallèle. L’unification de l’Europe était-elle un projet de paix ou un projet de puissance ? (…) Dans le cadre du projet de paix, l’Europe est « éminemment un acte moral » soutenu par la volonté de réconciliation et par l’idéalisme. Dans celui du projet de puissance, la construction européenne est un acte politique fondé sur le jugement et impliquant la redéfinition des intérêts propres des participants. Dans le premier cas, les ressortissants nationaux doivent devenir des citoyens du monde apatrides (ou des consommateurs dépolitisés). Dans le second cas, des Européens engagés, et même fiers de leur identité. En d’autres termes, le projet de paix exige le sacrifice des identités nationales au profit de valeurs universelles tandis que le projet de puissance requiert le développement d’une identité européenne ».