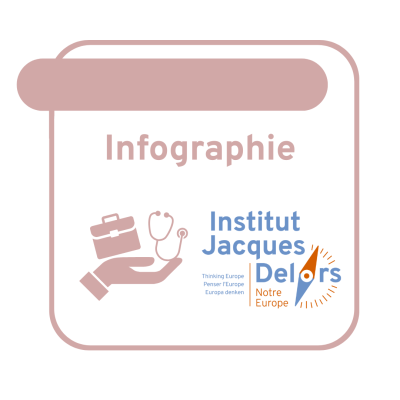Concilier vies professionnelle et familiale, une ambition européenne à tenir

L’égalité entre les hommes et les femmes est l’un des 20 principes du Socle européen des droits sociaux que les chefs d’État et gouvernement de l’Union européenne (UE) ont proclamé en novembre dernier au Sommet social de Göteborg. Pour concrétiser ce principe, la Commission européenne a présenté en 2017 une proposition de directive qui prévoit des règles minimales communes pour une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle : un congé paternité d’au moins 10 jours ouvrables, un congé parental d’au moins 4 mois, non transférables, pour chaque parent, et un congé pour s’occuper d’un proche dépendant d’au moins 5 jours par an (ce qu’on appelle le « congé d’aidant »). Pour ces trois congés, la Commission propose une indemnisation minimale à hauteur des prestations de maladie. La Commission propose également le droit à des formules souples de travail (notamment un aménagement des horaires de travail ou le recours au travail à distance) pour les aidants et les parents jusqu’aux 12 ans de l’enfant.
Lors du Conseil Emploi et Affaires Sociales du 21 juin, les ministres du Travail des pays de l’UE ont adopté leur orientation générale sur cette directive européenne. Cet accord entre les Vingt-Huit est, en soi, une bonne nouvelle, car les réticences des dirigeants et leurs divergences sur ce texte laissaient craindre une incapacité du Conseil à trouver un accord. Rappelons qu’en 2015, la Commission a été contrainte de retirer sa proposition de révision de la directive sur le congé maternité (qui visait notamment à augmenter la durée minimale du congé maternité de 14 à 18 semaines) faute d’accord au Conseil après 7 ans de négociations.
Si l’obtention d’un accord sur ce texte doit être saluée, la position retenue par le Conseil est pourtant décevante. Les Vingt-Huit ont considérablement assoupli la proposition de la Commission : la durée minimale du congé parental non transférable pour chaque parent a été réduite (de 4 à 2 mois) ainsi que la durée minimale pendant laquelle ce congé doit être indemnisé (de 4 à 1,5 mois). Il n’y a plus de référence à une durée minimale pour le congé d’aidant et, surtout, pour les trois congés qui sont l’objet de la directive, aucune référence à une indemnisation minimale n’a été retenue (cette indemnisation est laissée à l’appréciation de chaque État membre) (voir tableau).
Les dirigeants européens ont ainsi fortement limité la portée de cette législation européenne, qui était censée donner une impulsion vers un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement regrettable que les ministres du Travail n’aient pas retenu une règle minimale pour l’indemnisation des trois congés. Concernant le congé parental, il a été établi de façon probante que le recours au congé parental par les hommes est fortement influencé par le niveau d’indemnisation du congé. Lorsque ce congé existe mais qu’il n’est pas ou faiblement indemnisé, les pères ne le prennent pas. C’est le cas de la France, où l’indemnisation du congé parental est très faible – 396 euros par mois – et seuls 4% des pères font usage de leur droit (bien qu’il y ait depuis 2015 une période de six mois du congé parental non transférable vers l’autre parent). Seuls des taux élevés d’indemnisation permettront de renverser la logique financière qui veut que, pour limiter l’impact sur le revenu familial, le congé parental soit pris par le parent qui gagne le moins (souvent la femme).
Si de nombreux États membres n’ont pas soutenu la proposition de la Commission, c’est certainement du fait de ses implications budgétaires. Le président Emmanuel Macron, qui a fait de l’égalité entre les hommes et les femmes l’une des causes de son quinquennat, a par exemple affirmé, au Parlement européen, en avril dernier, qu’il « approuve totalement le principe [du texte de la Commission] mais les congés parentaux payés au niveau de l’indemnité maladie journalière, c’est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable ». Les dirigeants européens considèrent les dépenses liées à cette législation seulement comme coût, alors qu’elles représentent avant tout un investissement dans un modèle de société plus égalitaire.
Cet investissement aurait des retombées non seulement sociales et démographiques (un meilleur partage des responsabilités familiales aurait un effet positif sur le développement de l’enfant et sur le choix des familles d’avoir des enfants), mais aussi des retombées économiques. En effet, de nombreuses études mettent en évidence que le partage inéquitable des responsabilités familiales entre les mères et les pères sont l’une des causes majeures de l’accès inégal au marché du travail entre les hommes et les femmes (le taux d’emploi des femmes est 11,6 points de pourcentage inférieur à celui des hommes dans l’UE) et des écarts salariaux entre eux (les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes et touchent une retraite en moyenne 40% plus faible). Alors que la ministre française de la Santé souligne que la proposition de la Commission concernant le congé parental coûterait 1,6 milliard d’euros par an à la France, la Commission rappelle que le coût de l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi s’élève, lui, à 370 milliards d’euros dans l’UE.
L’accord du Conseil ne marque cependant pas la fin de la partie. Les citoyens européens peuvent espérer que les parlementaires européens, qui voteront leur rapport en juillet, redonnent de l’ambition à cette loi européenne. En effet, le Parlement européen avance dans la direction opposée de celle du Conseil et souhaite préserver voire renforcer la proposition de la Commission. Ainsi, il devrait par exemple fixer une rémunération minimale pour la compensation du congé parental en pourcentage du salaire du travailleur (75% du salaire selon la proposition du rapporteur). Cela permettrait une plus grande harmonisation entre les pays, car la référence de la Commission aux indemnités maladie conduirait à d’importants écarts entre les pays (les indemnités maladie s’élèvent par exemple à 50% du salaire en France, contre 100% au Luxembourg). Le défi des prochains mois sera donc de rapprocher les positions du Conseil et du Parlement européen pour que le texte puisse être adopté avant la fin du mandat de l’actuelle Commission en 2019. Du côté du Conseil, c’est l’Autriche, qui assure la présidence du Conseil durant ce deuxième semestre 2018, qui devra négocier avec le Parlement et la Commission. Alors que le peu d’intérêt de l’Autriche pour ce texte est connu, la mobilisation citoyenne pour une directive ambitieuse est plus que jamais nécessaire.