[EN] Les arguments contestables de la France contre l’élargissement de l’UE
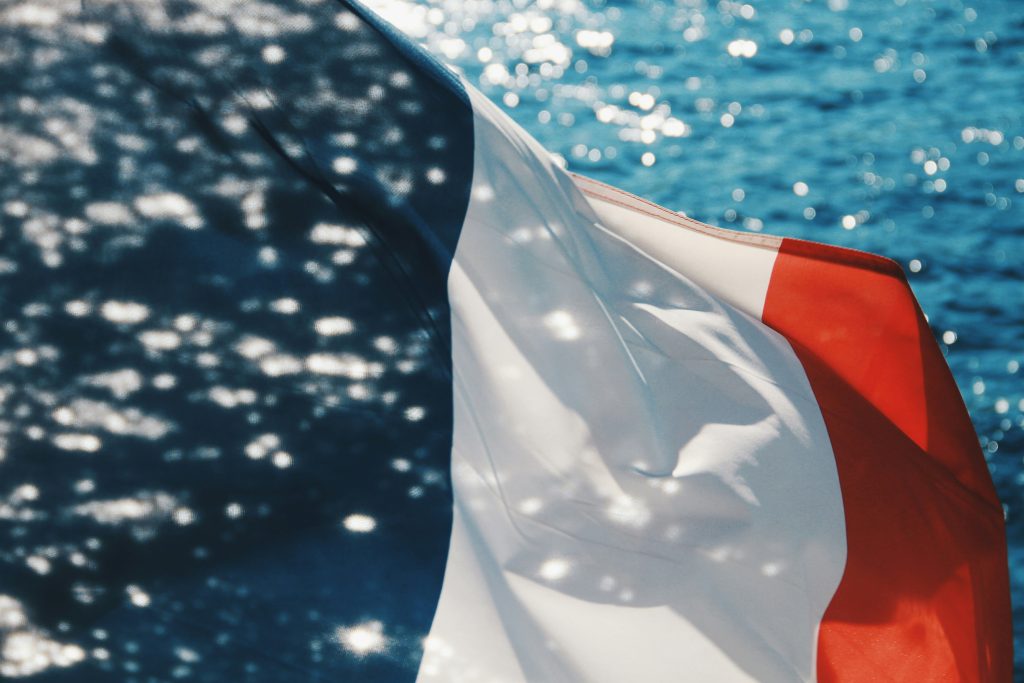
Pourquoi le gouvernement français devrait revoir sa position de veto sur les négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, tout en encourageant une réforme de la procédure d’adhésion.
En octobre 2019, la France a opposé son veto à l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE avec les pays des Balkans, la Macédoine du Nord et l’Albanie. Dans plusieurs communiqués de presse et déclarations publiques, le gouvernement français a avancé deux arguments principaux pour justifier son opposition. Ces arguments étaient (1) la nécessité perçue de réformer les procédures d’adhésion avant que de nouveaux pays puissent rejoindre l’UE, et (2) un compromis supposé entre l’élargissement et l’approfondissement de l’UE de manière plus générale.
Cet article examine de plus près les arguments avancés par les autorités françaises et les soumet à une « vérification de la réalité ». Tout en reconnaissant l’intérêt de repenser les procédures d’adhésion existantes et en appelant à une réforme plus large de l’UE, les sections suivantes montrent que les principales raisons du veto français aux négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie doivent être sérieusement remises en question. Sur cette base, l’article invite le gouvernement français à revoir sa position et à autoriser l’ouverture des procédures d’adhésion.
Sur la nécessité de réformer les procédures d’adhésion à l’UE avant que de nouveaux pays puissent adhérer
Le premier argument avancé par le gouvernement français pour justifier son veto aux négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie est la nécessité de réformer les procédures d’adhésion avant que de nouveaux pays puissent adhérer. Ce raisonnement repose sur le constat que l’UE a fait de « mauvaises expériences » avec les récents élargissements à l’Europe centrale et orientale. Les tendances autocratiques en Pologne et surtout en Hongrie, ainsi que les problèmes persistants de corruption dans des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, ont mis à mal l’engagement de l’UE en faveur de la démocratie libérale et de l’État de droit. Le gouvernement français considère que cette situation est le résultat de l’adhésion à l’UE de pays « non préparés », qui ont ensuite causé des problèmes aux principes et valeurs fondamentaux de l’UE. Pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir, la France en particulier est convaincue de la nécessité urgente de réformer la procédure d’adhésion à l’UE avant d’entamer de nouvelles négociations d’adhésion.
À la suite de son veto, et curieusement pas avant, les autorités françaises ont diffusé un document officieux contenant une proposition de réforme des procédures d’adhésion à l’UE. La position française, telle qu’elle est exposée dans ce document, consiste à rendre ce processus moins bureaucratique, moins automatique et plus politique. Le document informel propose (1) de formuler des conditions plus strictes afin de permettre un rapprochement plus efficace et à long terme des normes et standards européens (en termes d’État de droit et de convergence économique/sociale), (2) de baser les négociations sur différents blocs politiques, grâce auxquels les pays candidats pourraient s’associer progressivement à l’UE, (3) de réformer le processus afin qu’il lie des avantages concrets à cette association progressive, et (4) rendre le processus de négociation réversible, ce qui rendrait plus crédible le respect des critères d’adhésion et inciterait davantage les pays candidats à « rester sur la bonne voie ».
Mais si l’orientation générale de ces propositions françaises visant à réformer la procédure d’adhésion à l’UE est certainement à saluer, la lier à un veto sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie est une stratégie discutable.
Premièrement, la Macédoine du Nord et l’Albanie ont toutes deux déployé des efforts considérables pour se conformer aux exigences européennes afin d’entamer les procédures d’adhésion à l’UE, la Commission européenne ayant confirmé que les mesures nécessaires avaient été prises. Les dirigeants politiques de la Macédoine du Nord (ainsi que le gouvernement grec) ont notamment « dépensé » un capital politique énorme en changeant le nom du pays afin de surmonter l’opposition grecque. Si la proposition du gouvernement français vise à améliorer la crédibilité et les incitations du processus d’adhésion à l’UE, opposer son veto à l’ouverture des négociations d’adhésion après les réformes internes approfondies menées en Macédoine du Nord et en Albanie ne peut que compromettre les objectifs propres à ces pays en matière d’adhésion future à l’UE. De nombreuses études ont montré que les pays candidats entreprennent les réformes les plus importantes lorsque l’adhésion à l’UE est à portée de main. En bloquant le lancement des négociations d’adhésion, les gouvernements nationaux de Macédoine du Nord et d’Albanie pourraient préférer « dépenser » leur capital politique différemment à l’avenir.
Deuxièmement, en opposant son veto au lancement des négociations d’adhésion à l’UE, la France prend en otage deux pays candidats afin d’obtenir le soutien des autres États membres de l’UE pour une réforme plus large. Compte tenu de l’importance géopolitique constante de l’élargissement pour l’UE en tant qu’instrument de politique étrangère, en particulier dans le contexte des Balkans, cette stratégie pourrait permettre d’inscrire la réforme des procédures d’adhésion à l’ordre du jour politique des capitales européennes. Dans le même temps, la position des autorités françaises pourrait éloigner davantage leurs partenaires européens.
Mais même des procédures d’adhésion à l’UE réformées ne permettront pas de résoudre le problème des pays qui commencent à s’écarter de la démocratie libérale et de l’État de droit une fois qu’ils sont membres de l’UE. Si un processus réformé pourrait contribuer à mieux intégrer les normes et les valeurs européennes avant l’adhésion à l’UE, il ne suffira pas à garantir le maintien de la démocratie dans les pays de l’UE une fois qu’ils auront adhéré. Comme le montre R. Daniel Kelemen dans une nouvelle étude sur la Hongrie, plusieurs facteurs contribuent à la création d’un « équilibre autoritaire » pour les pays qui font partie de l’UE :
« Premièrement, le système politique des partis à moitié abouti de l’UE et sa réticence profonde à s’immiscer dans la politique intérieure de ses États membres contribuent à protéger les autocrates nationaux de l’intervention de l’UE. Deuxièmement, le financement et les investissements de l’UE contribuent à maintenir ces régimes en place. Troisièmement, la libre circulation des personnes au sein de l’UE facilite le départ des citoyens mécontents, ce qui affaiblit l’opposition et génère des transferts de fonds, contribuant ainsi à la pérennité de ces régimes ».
L’analyse de Kelemen met en évidence la nécessité d’une réforme substantielle de l’UE pour résoudre ces problèmes. Cependant, le veto sur l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE et la demande de modification des procédures d’adhésion à l’UE ne permettront guère de les résoudre. Lorsque la Hongrie et la Pologne ont adhéré à l’UE en 2004, leurs systèmes politiques correspondaient pleinement à la notion de démocraties libérales. En comparaison, la Grèce et le Portugal disposaient de systèmes démocratiques plus faibles lorsqu’ils sont devenus membres de l’UE, respectivement en 1981 et 1986. Ces derniers ont néanmoins largement conservé, voire amélioré, leur crédibilité démocratique depuis leur adhésion à l’UE, même si leur transition d’un leadership autocratique à l’adhésion à l’UE a été plus courte que celle de la Hongrie et de la Pologne. Même si la Hongrie et la Pologne étaient plus démocratiques lors de leur adhésion à l’UE et ont connu une période de transition plus longue, les deux pays ont connu une évolution vers des régimes plus autocratiques depuis le début des années 2010. Plutôt que de rendre les procédures d’adhésion à l’UE responsables de ces évolutions, l’UE et ses États membres doivent enfin utiliser tous les moyens institutionnels existants pour réagir plus fermement à ce virage vers l’autoritarisme. Cela inclut également la nécessité d’innover en termes de sanctions politiques et économiques possibles. Le processus d’adhésion à l’UE n’est tout simplement pas adapté pour faire face aux menaces autocratiques parmi les États membres actuels de l’UE.
Le compromis entre l’élargissement et l’approfondissement de l’UE
Le deuxième argument, plus profond, avancé par le gouvernement français pour justifier son veto à l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie est qu’il y aurait un compromis entre l’élargissement et l’approfondissement de l’UE. Étant donné qu’il existe différentes visions de l’avenir de l’UE parmi les États membres (potentiels) de l’UE, tout nouvel élargissement rendrait l’approfondissement de l’intégration européenne de plus en plus difficile. Certains pays, comme le Royaume-Uni par exemple, ont toujours considéré l’UE comme un projet d’intégration économique, tandis que d’autres, dont la France, ont largement soutenu l’évolution vers une union plus politique au fil du temps. Les autorités françaises ont en effet depuis longtemps préféré approfondir l’intégration européenne plutôt que de l’élargir davantage.
La perspective de l’adhésion à l’UE de nouveaux pays d’Europe du Sud-Est, dont les préférences politiques pourraient être plus proches de celles des pays du groupe de Visegrád (Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie) que de celles de la France, rend donc compréhensible la réticence du gouvernement français à ouvrir de nouvelles négociations d’adhésion à l’UE. Mais dans le même temps, cette logique ne s’applique que s’il existe réellement un compromis entre l’élargissement et l’approfondissement de l’intégration européenne, comme cela a fait l’objet de débats répétés entre les acteurs politiques, les bureaucrates et les universitaires pendant plusieurs décennies.
Il est intéressant de noter que des recherches récentes soulignent que l’élargissement de l’UE n’entrave pas nécessairement l’approfondissement de l’intégration européenne, mais peut même le soutenir et le compléter. Sur la base de son analyse, Christina Schneider, par exemple, affirme que
« l’élargissement de l’UE ne constitue pas systématiquement un obstacle à la coopération. L’hétérogénéité des préférences au sein du Conseil n’est pas seulement influencée par l’adhésion de nouveaux États membres, mais elle fluctue également au fil du temps en raison des changements survenant sur la scène politique nationale. (…) Alors que l’hétérogénéité des revenus s’est accrue avec l’augmentation du nombre de membres de l’UE, l’hétérogénéité partisane n’a pas été affectée par les élargissements de l’UE, mais plutôt par des changements politiques nationaux tels que les élections ».
En effet, l’adhésion de nouveaux pays ne ferait-elle qu’accroître la diversité des visions pour l’avenir de l’Europe ? Cela dépend en grande partie de l’hétérogénéité des préférences parmi les États membres actuels de l’UE. Compte tenu du degré d’hétérogénéité actuellement assez élevé entre les États membres de l’UE, il est peu probable que la Macédoine du Nord et l’Albanie compliquent davantage les tentatives de réforme visant à approfondir l’intégration européenne.
En outre, le nombre d’États membres de l’UE n’est pas le seul facteur qui pourrait expliquer les difficultés rencontrées dans l’approfondissement de l’UE. Cela dépend également de la taille et de l’importance relatives des États membres (potentiels). Le Royaume-Uni, l’un des plus grands pays de l’UE, qui a continuellement bloqué les tentatives communes d’intégration européenne, devrait quitter l’UE l’année prochaine. Cela devrait en fait faciliter considérablement les efforts d’approfondissement de l’UE par rapport au statu quo. Le départ du Royaume-Uni de l’UE devrait plus que compenser l’adhésion potentielle de la Macédoine du Nord et de l’Albanie, dont le PIB combiné représente moins de 1 % du PIB britannique. Et même si ces deux pays se montraient particulièrement sceptiques à l’égard d’une intégration européenne supplémentaire, leur petite taille permettrait aux pays favorables à l’intégration de surmonter plus facilement toute résistance potentielle grâce à des paiements parallèles.
Une dernière objection à la position française contre l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE concernant le prétendu compromis entre élargissement et approfondissement est que, de toute façon, la Macédoine du Nord et l’Albanie n’adhéreraient pas immédiatement à l’UE. Étant donné que les institutions politiques de ces deux pays doivent encore faire l’objet d’un nombre important de réformes avant de satisfaire à tous les critères d’adhésion à l’UE, ce processus prendra très probablement une décennie entière, voire plus. D’ici là, il y a largement le temps de négocier un approfondissement de l’UE sans avoir à faire face à des vetos supplémentaires de la part des nouveaux États membres. Comme souligné ci-dessus, avec le départ imminent du Royaume-Uni, il existe en fait une fenêtre d’opportunité pour une intégration européenne plus poussée dans les années à venir, ou du moins pour une adaptation des arrangements institutionnels de l’UE afin de faciliter un approfondissement ultérieur.
Mais comme l’a souligné Schneider, cela dépend fortement de l’évolution des préférences nationales des États membres actuels de l’UE. Les principales tentatives de réforme du gouvernement français (axées en particulier sur le renforcement de la zone euro) n’ont pas nécessairement été contrariées par les membres les plus récents de l’UE. Du point de vue français, le principal obstacle à l’approfondissement de l’UE ces dernières années était plutôt l’Allemagne, et ce de manière croissante depuis la Grande Récession et la crise de la dette européenne.
Compte tenu de tous ces arguments, bloquer le lancement des négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie ne semble donc pas être un moyen approprié pour surmonter les difficultés actuelles et faire progresser l’approfondissement de l’intégration européenne. Au contraire, l’« effort solitaire » national du veto français ne fera qu’éloigner davantage ses partenaires européens et rendra un compromis sur la réforme de l’UE moins probable.
La voie à suivre pour la France et l’avenir des procédures d’adhésion à l’UE
Comme le montrent les deux sections ci-dessus, les principaux arguments avancés par le gouvernement français pour opposer son veto à l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE avec la Macédoine du Nord et l’Albanie ne résistent pas à un examen critique de la réalité. Une réforme des procédures d’adhésion ne permettra pas non plus de dissiper les inquiétudes concernant les tendances autocratiques des pays européens une fois qu’ils seront membres de l’UE, et il n’y a pas non plus de compromis inhérent entre l’élargissement et l’approfondissement de l’intégration européenne, qui dépend plutôt du degré variable d’hétérogénéité des préférences des principaux États membres de l’UE au fil du temps.
Si les propositions françaises visant à réformer les procédures d’adhésion à l’UE et l’appel à un approfondissement de l’UE sont les bienvenues et doivent être sérieusement discutées dans les capitales européennes, il n’est pas nécessaire de lier ces efforts de réforme à un veto sur les négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie. Les autorités françaises devraient retirer leur opposition dès que possible afin de minimiser les dommages déjà causés à la crédibilité de l’UE et de garantir que les Balkans occidentaux continueront à « dépenser » leur capital politique sur la voie de l’Europe. Compte tenu des vives critiques et des pressions exercées par les capitales de tout le continent européen, le gouvernement français devrait élaborer un discours qui lui permettra de « sauver la face » : permettre la poursuite des négociations d’adhésion à l’UE (au moins avec la Macédoine du Nord) tout en revendiquant la « victoire » d’avoir lancé des débats attendus depuis longtemps sur les procédures d’adhésion exactes. Les éléments clés du document officieux français constituent certainement un point de départ intéressant pour une telle discussion.




