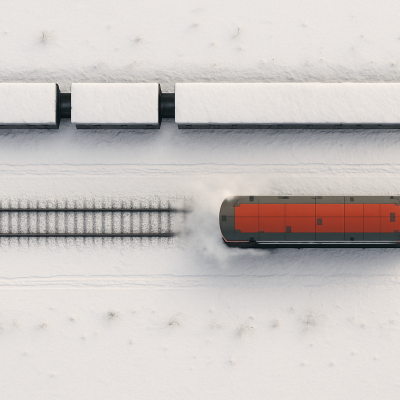[EN] Instaurer la démocratie: une approche moins courante – comment la transition énergétique et la démocratie ont besoin l’une de l’autre

En 2023, la transition énergétique en Europe a fait des progrès significatifs. Cependant, certains médias continuent de laisser entendre que le public n’adhère pas à cette transition vers les énergies propres. Une culture croissante de citoyenneté énergétique révèle qu’une autre histoire, celle d’une appropriation partagée, est possible.
Les crises récentes ont sapé la confiance politique dans les institutions, renforçant la conviction dominante que les institutions démocratiquement élues ne répondent pas de manière adéquate aux besoins du public. Ce sentiment est exacerbé par les observations faites dans plusieurs États membres, où le soutien politique à des réformes énergétiques ambitieuses visant à répondre aux préoccupations liées au coût de la vie a été renversé. La justification de ce revirement repose souvent sur un manque perçu de consentement public à la transition énergétique. Certains discours médiatiques contribuent à cette perception en affirmant qu’il existe un lien direct entre la législation sur les énergies propres et une menace potentielle pour la démocratie.
Cependant, ces affirmations simplifient à l’extrême la situation et négligent des faits essentiels. La transition énergétique de l’UE a fait un bond en avant ces dernières années, marquée par une forte augmentation des énergies renouvelables et un engagement à éliminer progressivement les combustibles fossiles lors de la COP28. De nombreux sondages montrent régulièrement que les citoyens soutiennent cette transition des combustibles fossiles vers les énergies propres, plus de 8 Européens sur 10 étant favorables aux solutions énergétiques propres.
Au-delà du soutien public, on observe également une augmentation constante des différentes formes de participation citoyenne, qui favorisent une transition énergétique durable et démocratique. Qualifiées de « citoyenneté énergétique », ces actions sont mises en œuvre à différents niveaux et impliquent divers acteurs de la production, de la distribution, de la consommation et de la gouvernance énergétiques. Elles remettent fondamentalement en question l’image des citoyens comme des destinataires passifs de la transition, à qui celle-ci est imposée plutôt qu’avec qui elle est menée.
Les coopératives énergétiques, comme la coopérative Energy Communities Tipperary en Irlande, illustrent une forme de citoyenneté énergétique. Lancée en 2014 par quatre communautés collaborant à des projets d’efficacité énergétique, cette initiative est devenue une coopérative officielle regroupant 15 communautés. Sa mission est de promouvoir un système énergétique local plus démocratique et plus autonome. La coopérative engage activement les communautés à sensibiliser à l’énergie, à promouvoir l’emploi local et à lutter contre la précarité énergétique, les citoyens conservant le contrôle par le biais du vote.
En Allemagne, Solocal Energy adopte un modèle similaire de propriété individuelle et collective des infrastructures énergétiques. L’initiative met en relation les habitants de Kassel afin qu’ils achètent et installent des panneaux solaires sur leurs balcons, leur offre des conseils pour installer eux-mêmes des panneaux photovoltaïques et organise des cercles climatiques de quartier. Guidés par des animateurs et des modérateurs expérimentés, les groupes de quartier se réunissent chaque mois pour réfléchir à des idées, planifier et mettre en œuvre des projets conjointement, avant de procéder à une évaluation pour célébrer leur succès. Fondée sur le principe de la sociocratie, la prise de décision repose sur le consentement, les propositions étant ajustées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’objections, plutôt que de rechercher un consensus total, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Convaincue que l’énergie est un droit fondamental, l’association vise à impliquer les utilisateurs défavorisés en ajustant les cotisations en fonction des capacités financières de chacun.
Energie Partagée, une association qui défend, aide et finance des projets d’énergie renouvelable menés par des citoyens en France, en est un autre exemple. Les autorités locales et les groupes communautaires supervisent le financement et la gouvernance de ces projets. L’une des caractéristiques essentielles de cette initiative est le dialogue réflexif régulier visant à définir ce qui constitue une transition énergétique durable et partagée. Ce dialogue peut prendre la forme d’un atelier sur le mix énergétique, facilitant les débats sur les questions énergétiques futures en fonction des choix d’aujourd’hui, ou de projections de films discutant du rôle des citoyens dans la transition énergétique. L’objectif de ces événements est de cultiver une éthique énergétique collective et d’engager les citoyens dans des efforts de collaboration positifs.
Bien que ces exemples ne soient pas des solutions parfaites, ils révèlent ensemble que des possibilités de participation publique au système énergétique existent et sont déjà mises en œuvre. Cela est crucial, car la démocratie dépend de la capacité des citoyens à façonner les sociétés dans lesquelles ils vivent. En offrant des espaces d’apprentissage, de discussion et de délibération communs, la citoyenneté énergétique peut restaurer le sentiment d’autonomie des citoyens tout en renforçant la confiance dans la transition énergétique.
Tout aussi important, ces formes de citoyenneté énergétique présentent une vision plus rafraîchissante de la politique de réconciliation, contrant la représentation médiatique controversée de la transition énergétique. Les histoires positives qu’elles racontent doivent être répétées, financées et reproduites grâce à des innovations politiques qui garantissent l’accessibilité et une prise de décision plus inclusive pour tous les citoyens. Ce sera une étape cruciale non seulement pour soutenir la transition énergétique, mais aussi pour nourrir la démocratie en cours de route.
Les auteurs tiennent à exprimer leurs sincères remerciements et leur gratitude à leurs collègues qui ont contribué à l’élaboration de cet article : Rheanna Johnston, Isabel Syrek, Elisa Giannelli, Pieter de Pous et Manon Dufour de l’E3G, ainsi que Camille Defard de JDI. Les initiatives mentionnées dans l’article sont issues des recherches collectives du consortium EnergyPROSPECTS (financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101022492).