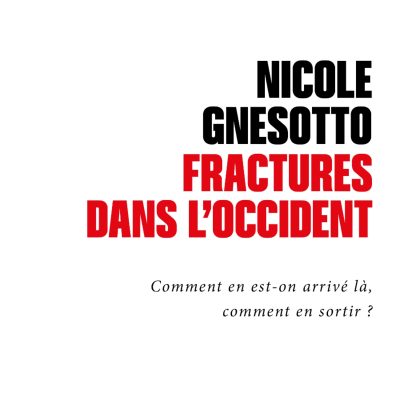[EN] La procédure prévue à l’article 7 à l’encontre de la Pologne et de la Hongrie: quels effets concrets?

Cela fait maintenant plus d’un an que la procédure prévue à l’article 7 du traité sur l’Union européenne a été engagée par la Commission européenne à l’encontre de la Pologne (le 20 décembre 2017) et plus de six mois qu’elle a été engagée par le Parlement à l’encontre de la Hongrie (le 12 septembre 2018). Cependant, l’intérêt médiatique qui a accompagné la mise en œuvre de ces procédures, en raison de leur nouveauté, semble contraster fortement avec les résultats concrets obtenus. La difficulté d’obtenir des informations sur les procédures elles-mêmes met en évidence le rôle joué par le Conseil européen, qui devrait finalement soumettre au vote la déclaration d’un « risque manifeste de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2 », c’est-à-dire les valeurs communes (y compris celles de l’État de droit) de l’Union européenne.
En fait, la période récente met en évidence l’incapacité de l’article 7 à corriger les déviations potentielles par rapport à l’État de droit dans les États membres, sauf si l’on tient compte de la possibilité que le « renforcement du dialogue » tant vanté entre le Conseil des ministres de l’UE (dans sa configuration « Conseil des affaires générales », ci-après dénommé « CAG ») et l’État membre puisse contribuer à rapprocher les positions. Cependant, comme nous le verrons ci-dessous, ce n’est malheureusement pas grâce aux procédures du Conseil qu’une légère correction de la situation en Pologne a été autorisée, même si celles-ci font partie de l’arsenal qui permet de maintenir la pression sur les gouvernements concernés.
La proximité des élections européennes et l’utilisation politique potentielle des questions relatives à l’État de droit – dans le cadre d’une division entre les forces progressistes et nationalistes en Europe – nous obligent également à réfléchir à la manière dont les outils de maintien de l’État de droit peuvent être affinés afin d’éviter que les cas polonais et hongrois ne se reproduisent.
Comme prévu par les traités, le déclenchement de l’article 7 à l’encontre de la Pologne a donné lieu à trois auditions du gouvernement polonais devant le CAG, sur la base des quatre recommandations correctives émises par la Commission européenne entre juillet 2016 et décembre 2017, ainsi que de l’application des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans des affaires impliquant le système judiciaire polonais. Chaque audition était accompagnée d’une présentation PowerPoint de la délégation polonaise (d’une durée comprise entre 40 minutes et une heure), suivie d’une possibilité pour les représentants nationaux de poser deux questions à la délégation polonaise. Les trois auditions ont duré au total entre deux et trois heures et ont porté sur tous les sujets abordés dans les recommandations. Il s’agit notamment du fonctionnement, de la nomination et de la mise à la retraite forcée des juges de la Cour constitutionnelle, de la mise en œuvre effective des décisions rendues par la Cour avant 2016, des procédures d’appel extraordinaires permettant la réouverture de procédures déjà jugées, ou encore du rôle du Conseil national dans le processus de nomination des juges. Il convient de noter qu’à l’exception d’une question posée par un représentant estonien, aucun pays d’Europe centrale ou orientale (y compris l’Autriche, qui assurait la présidence du Conseil) n’a pris la parole lors de ces auditions, les questions provenant principalement de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Espagne, du Portugal, du Benelux et des pays scandinaves. Cette fracture géographique reflète les divisions politiques qui subsistent sur cette question et l’absence d’intérêt commun au sein du Conseil pour cette procédure. La nature hautement technique et juridique de l’affaire exige également que les équipes ministérielles soient extrêmement bien préparées, ce qui peut également conduire les capitales à faire des choix politiques quant aux questions sur lesquelles leur personnel doit se concentrer.
Le rôle du Conseil dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7, et en particulier celui de sa présidence tournante, mérite une discussion approfondie. En effet, à l’issue de ces trois auditions (ou plus, si nécessaire), le Conseil pourrait organiser un vote (après avoir obtenu l’accord du Parlement européen) sur le « risque manifeste de violation grave » de l’État de droit, qui nécessite l’accord des quatre cinquièmes de ses membres. Il convient toutefois de noter que la présidence roumaine actuelle semble manifester un désintérêt flagrant pour ces questions ; comme l’a fait remarquer la journaliste Alexandra Brzozowski, l’État de droit n’a pas été abordé lors du premier CAG de 2019, contrairement à toutes les réunions du même format en 2018. Les professeurs de droit européen Laurent Pech et Patryk Wachowiec ont symboliquement noté que l’État de droit est manifestement absent de la page « Europe des valeurs communes » du site web de la présidence roumaine. Bien que la Commission ait pu présenter son analyse des procédures lors du GAC du 19 février 2019, la paralysie du Conseil sur la question de l’État de droit, alimentée notamment par les préoccupations suscitées par le cas roumain, fait craindre qu’aucun progrès significatif ne soit réalisé dans l’une ou l’autre procédure avant que la présidence ne soit transférée à la Finlande le 1er juillet 2019.
Au-delà de cela, il semble que peu de pays aient une approche structurée sur la manière de contourner les limites du Conseil afin de continuer à faire pression sur la Pologne et la Hongrie. Au contraire, ces deux pays ont une stratégie très claire pour leur défense et y consacrent d’importantes ressources administratives. C’est particulièrement vrai pour Budapest, qui publie régulièrement de longs documents pour clarifier ses arguments et cherche à obtenir le soutien d’autres États membres, tandis que Varsovie agit de manière plus discrète, mais néanmoins efficace, pour gagner du temps.
Enfin, il est clair que les discussions en cours sur le prochain cadre financier pluriannuel peuvent influencer négativement les positions nationales, dans le cadre des négociations permanentes et chevauchantes qui régissent traditionnellement le fonctionnement du Conseil. Il semble donc y avoir un manque relatif d’unité, voire parfois d’intérêt prolongé, de la part des États membres quant aux avantages potentiels de la procédure en raison des blocages expliqués ci-dessus. La structure et le fonctionnement du Conseil, ainsi que la lenteur des procédures, font le jeu des pays incriminés et finissent par favoriser l’absence de progrès dans leur dossier. Il est également regrettable qu’au niveau institutionnel, le Parlement européen ne puisse pas jouer un rôle plus important dans les procédures prévues à l’article 7 : il est clair que ses membres pourraient jouer un rôle important en maintenant ces discussions sous les feux de l’actualité politique et en continuant à faire pression sur leurs gouvernements. Il semble toutefois que la présidence autrichienne du Conseil n’ait organisé qu’un seul petit-déjeuner informel sur la question, avec notamment la députée européenne Judith Sargentini (NL-Verts/ALE), auteur du rapport sur l’État de droit en Hongrie qui a conduit au déclenchement de l’article 7. Il convient également de noter qu’une controverse récente a mis en évidence la réticence du Conseil à associer le Parlement aux discussions sur l’État de droit. En effet, dans une note orale remise lors d’une réunion du personnel, le service juridique du Conseil a estimé que les services du Parlement ne pouvaient pas être entendus dans le cadre des travaux du Conseil. Le fait que cette note ait été émise oralement et n’ait été consignée dans aucun procès-verbal ou autre document écrit donne clairement l’impression que le Conseil souhaitait pouvoir nier de manière plausible sa décision de ne pas impliquer le Parlement dans ces affaires. Les procédures prévues à l’article 7 ne sont donc pas à l’abri de la concurrence institutionnelle, ce qui laisse peu d’espoir d’un changement de cap sous la présidence roumaine.
La seule façon de présenter l’article 7 comme ayant eu des effets positifs est d’inclure cette procédure dans la boîte à outils plus générale dont dispose l’UE pour mettre fin aux abus de l’État de droit. En effet, il semble que ce soit la combinaison des actions devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée « CJUE ») et des procédures d’infraction engagées par la Commission qui ait conduit à des progrès mineurs dans la réforme du système judiciaire polonais. Ce sont ces mêmes outils qui devront être utilisés pour continuer à aller de l’avant, les procédures d’audition servant dans ce cas, pour les chancelleries intéressées, d’occasion de recueillir des informations sur les procédures judiciaires en cours.
Une demande de mesures provisoires présentée par la Commission a été traitée en urgence par la CJUE, qui a ordonné la suspension temporaire – dans l’attente d’un arrêt au fond – des mesures concernant l’âge de la retraite des juges de la Cour suprême polonaise, ce qui a conduit à une situation assez bizarre dans laquelle certains juges mis à la retraite d’office ont été autorisés à reprendre leurs fonctions. En outre, la demande de décision préjudicielle (à la CJUE) présentée par la Haute Cour irlandaise concernant la demande d’extradition d’un citoyen polonais détenu en Irlande (l’arrêt dit « Celmer », 2018) a également incité la CJUE à se prononcer sur la validité du mandat d’arrêt européen si le pays requérant présentait des déficiences systémiques ou généralisées susceptibles d’affecter l’indépendance du système judiciaire. La CJUE a invité les juridictions nationales à vérifier les risques d’absence d’accès à un procès équitable devant un tribunal indépendant, jetant ainsi les bases d’une structure jurisprudentielle susceptible de remettre en cause le principe fondamental de confiance mutuelle qui régit les relations entre les systèmes judiciaires des États membres de l’UE.
Toutefois, ces avancées, bien qu’importantes, ne peuvent empêcher totalement la mise en œuvre des réformes du système judiciaire polonais, ni même d’autres abus tels que le fait que certains juges polonais, qui ont saisi la CJUE de questions préjudicielles, ont fait l’objet d’enquêtes disciplinaires préliminaires en Pologne, ce qui constitue manifestement un moyen de pression. De plus, les modifications récemment adoptées à la loi sur l’organisation de la Cour suprême n’ont pas touché au statut des juges nouvellement nommés, et la Cour constitutionnelle n’a pas encore repris son fonctionnement antérieur. La réticence manifeste des hauts dirigeants politiques polonais à appliquer les mesures adoptées par la CJUE et le fait que les recommandations émises par la Commission n’aient pas été suffisamment mises en œuvre (à l’exception, par exemple, de l’âge de la retraite des juges, qui a été harmonisé) signifient que la Commission devra continuer à engager des procédures d’infraction contre les modifications suggérées dans ses recommandations et qui n’ont pas été mises en œuvre jusqu’à présent. L’exemple le plus récent en date remonte au date, lorsque la Commission a adressé une recommandation à la Pologne concernant ces nouvelles mesures disciplinaires à l’encontre des juges. Les États membres et leurs systèmes judiciaires (y compris le système polonais, comme on l’a vu plus haut) continueront également à jouer un rôle dans la construction de la structure jurisprudentielle de la CJUE par le biais de leur recours à celle-ci. Si cette dernière n’a pas souhaité remettre immédiatement en cause le principe de confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires nationaux dans l’arrêt Celmer, 2019 pourrait également conduire à une construction juridique plus solide dans le traitement du cas polonais.
Il est toutefois impossible d’affirmer que la Commission porte le même intérêt à l’affaire hongroise. Dans l’état actuel des choses, il est difficile d’imaginer un changement dans cette affaire avant que ne soit résolue l’équation entre l’identité politique de la prochaine Commission et l’avenir du parti dominant en Hongrie, le Fidesz, au sein du Parti populaire européen. Des propositions ont été faites, notamment par la députée européenne Sophie in’t Veld (NL-ADLE), en vue de la création d’une « Union pour la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux », qui rendrait permanent un mécanisme annuel, dirigé par le Parlement, chargé d’examiner l’état de l’État de droit dans les États membres. Cette proposition est soutenue par les gouvernements belge et allemand, qui ont exprimé leur soutien à un mécanisme de comité de pairs tournant qui remplirait la même fonction, mais où la participation des États membres serait volontaire. Le leader du PPE et Spitzenkandidat, Manfred Weber, s’est également prononcé en faveur de cette proposition, avec un fonctionnement légèrement différent, selon un éditorial publié dans la presse allemande le 18 mars 2019. Enfin, au cours du mois d’avril, la Commission devrait publier une nouvelle communication sur l’État de droit, faisant suite à celle du 11 mars 2014 qui établissait un cadre pour la conduite des discussions entre les États membres et la Commission avant tout déclenchement de l’article 7. Cependant, la France et l’Allemagne ont toutes deux publié une déclaration demandant une première audition de la Hongrie en septembre, ouvrant la voie à une discussion sur cette possibilité au niveau du CAG.
Enfin, il est important de noter que les progrès sur le cadre de l’État de droit ont été dissociés des discussions sur les mécanismes liant l’octroi de fonds européens au respect de l’État de droit ; en effet, la proposition de la Commission de mai 2018 devrait être revue dans le cadre des discussions sur le prochain cadre financier pluriannuel, notamment dans la mesure où elle exigerait une « majorité qualifiée inversée » pour débloquer le versement des fonds. Il est clair que la Commission recherche un autre instrument qui satisferait les États membres qui souhaitent voir ce concept inscrit dans le prochain CFP. Dans cette optique, il reste essentiel d’établir une distinction claire entre les mesures relatives à l’État de droit prévues à l’article 7 et les mesures éventuelles liant le respect de l’État de droit à l’octroi de fonds, afin que les deux conservent une base juridique stable. En outre, le non-respect par plusieurs pays de la région de leurs obligations en matière d’asile reste également tout à fait distinct de la question de l’État de droit.
Les effets limités de l’article 7 en matière d’État de droit en Pologne et en Hongrie soulèvent évidemment la question de l’efficacité de cet instrument, en particulier dans ce cas particulier où la présidence du Conseil ne souhaite pas jouer un rôle décisif et faire avancer ces procédures. Il semble que l’année 2019 ne sera pas propice à des progrès sur cette question, à moins que la future présidence finlandaise ne se montre nettement plus active que la Roumanie. En attendant ces avancées institutionnelles, la qualité du dialogue politique entre la Commission et Varsovie n’a, jusqu’à présent, montré aucun signe d’amélioration, et il semble probable que la campagne électorale ne changera pas cette situation. Deuxièmement, et surtout, la question de la possibilité de revenir sur ces réformes deviendra de plus en plus pressante et embarrassante, notamment dans le contexte des élections législatives prévues en Pologne à l’automne 2019. De plus, il est également clair que les pays potentiellement visés par les procédures relatives à l’État de droit peuvent se sentir en confiance car, dans les conditions actuelles, l’Union européenne dispose de trop peu de moyens pour assurer la défense de l’État de droit sur le continent. À court terme, il reste à voir si les questions relatives à l’État de droit seront utilisées dans la campagne électorale par ceux qui soutiennent une approche forte (les pays scandinaves et du Benelux, la France dans une moindre mesure) afin de mobiliser leur électorat. À cet égard, il est intéressant de noter que les propositions d’Emmanuel Macron pour une « renaissance européenne » ne font pas référence à l’État de droit, alors que sa campagne présidentielle avait montré son intérêt pour cette question, qui a depuis été abordée par Nathalie Loiseau, secrétaire d’État aux Affaires européennes et désormais tête de liste du parti présidentiel aux prochaines élections européennes.