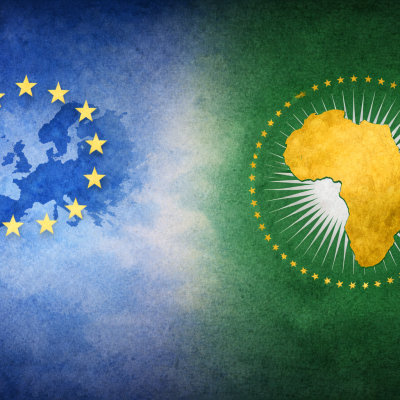[EN] Stabilisateurs automatiques pour la zone euro: quelles sont les options envisagées?

Ce document d’orientation rédigé par Nathalie Spath, chercheuse affiliée à l’Institut Jacques Delors – Berlin, notre bureau en Allemagne, contribue au débat sur la manière de doter la zone euro d’un mécanisme d’absorption des chocs asymétriques. Il répond au défi de la stabilisation automatique et enrichit les solutions potentielles en analysant les promesses et les problèmes des mécanismes de stabilisation automatique pour la zone euro. Il examine trois des propositions les plus influentes en matière de mécanisme de stabilisation automatique : une assurance contre les chocs cycliques (CSI) proposée par Enderlein, Guttenberg et Spiess (2013) ; une assurance chômage européenne (EUI) proposée par Dullien (2014a) ; et une réassurance proposée par Beblavy´, Gros et Maselli (2015). L’analyse révèle les hypothèses sous-jacentes à chaque proposition, identifie les principales exigences et compare les paiements nets ainsi que les propriétés de stabilisation.
L’analyse conclut que les trois propositions offrent des mécanismes sophistiqués qui pourraient être mis en œuvre au niveau européen pour assurer une stabilisation automatique. Toutes trois présentent des promesses et des problèmes différents, et la préférence pour l’une ou l’autre est une question de priorités. La CSI repose sur un indicateur dont la précision est limitée, mais qui offre des exigences réduites. La proposition offre une solution technique en lissant les écarts cycliques ; elle repose sur une approche économique étroite. L’EUI repose sur une approche plus holistique. Les paiements au niveau individuel rendent le mécanisme tangible pour les citoyens, mais ajoutent en même temps de la complexité à sa conception. Les principaux défis résident dans l’harmonisation des marchés du travail et dans la complexité des procédures juridiques qui en découle, y compris les modifications des traités. La réassurance fournit une couverture en cas de crise grave et n’est donc que semi-automatique. Bien qu’elle soit intuitive, la part discrétionnaire ajoute une charge administrative difficile à mettre en œuvre au niveau européen.
L’introduction et la partie 1 présentent le problème de la stabilisation macroéconomique, la partie 2 passe en revue les propositions existantes et évalue leurs spécificités. La partie 3 analyse les conclusions et examine les solutions possibles pour atténuer les défis identifiés dans les propositions. Le document d’orientation conclut en fournissant aux décideurs politiques une base solide pour évaluer les promesses et les problèmes des trois propositions de stabilisateurs automatiques.