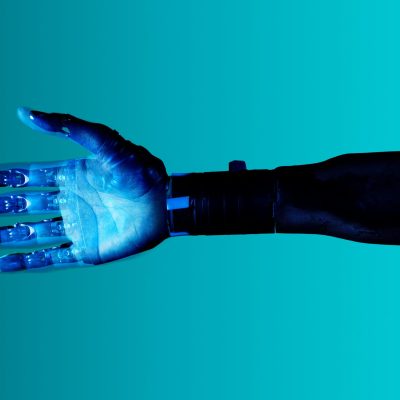[EN] UE-ASEAN : deux pour danser le tango ?

L’accord signé en 1973 entre la Communauté économique européenne de l’époque et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), six ans seulement après la création de cette dernière, a été le premier accord de coopération interrégionale jamais conclu par l’Europe occidentale dans son ensemble avec un autre organisme régional étranger. Cette importance symbolique, associée à la tendance de l’UE, dans le cadre de son approche des relations internationales fondée sur le soft power, à promouvoir l’intégration régionale ailleurs, confère aux relations entre l’UE et l’ANASE une signification particulière. Cependant, l’UE et l’ANASE sont deux entités régionales multidimensionnelles très différentes, avec des histoires, des objectifs, des structures et des capacités très différents. C’est cette asymétrie qui est au cœur des difficultés rencontrées dans leurs tentatives de coopération interrégionale.
La présente étude donne un aperçu de ces relations en examinant deux dimensions étroitement liées, à savoir la dimension politique et la dimension économique. Deux « bémols » dans le domaine politique sont examinés, à savoir la question de l’annexion par l’Indonésie de l’ancienne colonie portugaise du Timor oriental et, source d’aggravation constante, le problème du régime répressif en Birmanie/Myanmar. Sur ces deux questions, la pratique interventionniste de l’Europe au sein de l’Union européenne se heurte au principe sacro-saint de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays membre de l’ANASE.
En examinant la dimension économique, l’étude fournit un aperçu statistique des échanges commerciaux entre les deux organisations régionales et souligne l’importance des IDE européens en Asie du Sud-Est. Cependant, un déficit commercial de 30 milliards d’euros avec l’ANASE, concomitant à un enthousiasme européen déclinant pour les négociations commerciales multilatérales, a conduit l’Union européenne à chercher depuis 2006 à signer un accord de libre-échange avec l’ANASE dans son ensemble. À ce stade, ces négociations semblent au point mort. Compte tenu de ces obstacles politiques et économiques, l’étude conclut par une évaluation de l’avenir des relations entre l’UE et l’ANASE en tenant compte des disparités entre les deux entités régionales.