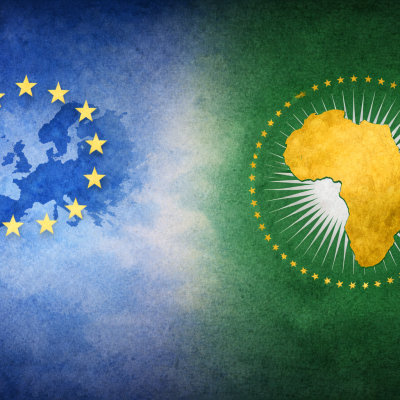[EN] Vers une union de l’épargne et de l’investissement?
Conférence annuelle de l’Institut Jacques Delors

Modération : Eulalia Rubio, chercheuse senior à l’Institut Jacques Delors
Eulalia Rubio a ouvert la deuxième table ronde, qui portait sur l’Union de l’épargne et de l’investissement (UEI), une proposition clé du rapport d’Enrico Letta sur l’avenir du marché unique de l’UE.
Messages clés des participants :
Pierre Gramegna, directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES) (vidéo)
Dans un message préenregistré, Pierre Gramegna a prononcé le discours d’ouverture de la deuxième table ronde. Il a établi un lien entre la mise en place du projet d’Union des marchés des capitaux (UMC) en 2014 et l’Union de l’épargne et de l’investissement (UEI) proposée par Enrico Letta en 2024. M. Gramegna a déclaré que le marché unique restait fragmenté et que de nombreuses barrières internes rendaient les investissements en Europe difficiles. Selon lui, des marchés de capitaux plus intégrés (par exemple dans les domaines du capital-risque, des marchés d’actions et des marchés obligataires) stimuleraient l’innovation et la productivité. Le développement de ces marchés contribuerait à une meilleure allocation des capitaux dans l’UE, en permettant une meilleure utilisation de l’épargne abondante des ménages. M. Gramegna a souligné que la majeure partie du financement des besoins d’investissement définis dans le rapport Draghi (750 à 800 milliards d’euros) devrait provenir du secteur privé. La création de l’Unité de service d’investissement (SIU) serait un élément crucial pour mobiliser ces montants.
Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers en France
Marie-Anne Barbat-Layani a commencé sa présentation en évoquant les origines du projet CMU dans les années 2010, mené par Sir John Hill. À l’époque, M. Hill avait souligné les différences entre l’UE et les États-Unis en matière de financement privé, avec un financement bancaire très développé en Europe et un financement par les marchés dominant aux États-Unis. L’objectif de l’UMC était alors de développer le financement par les marchés européens grâce à une plus grande intégration. Selon Mme Barbat-Layani, beaucoup de progrès ont été réalisés depuis 2014, mais aucun marché financier véritablement intégré n’a encore été créé dans l’UE. Elle a souligné que les fonds destinés à financer les investissements dans les domaines de l’écologie, du numérique et de la défense seraient en principe disponibles, mais qu’ils ne sont actuellement pas affectés aux bons endroits. Mme Barbat-Layani a fait valoir que le coût d’un marché non intégré est élevé et a présenté une série de recommandations sur la manière de concrétiser l’unité de supervision unique. Tout d’abord, elle a déclaré que la supervision des marchés devait être davantage intégrée avec la création d’un superviseur unique. Selon elle, les autorités nationales de surveillance ne se font pas suffisamment confiance, ce qui entraîne des différences réglementaires. La simplification ne peut être réalisée que s’il existe une surveillance intégrée, car une « décision finale » en matière d’interprétation est nécessaire pour garantir la cohérence entre les États membres. Deuxièmement, Mme Barbat-Layani a souligné que pour développer davantage les marchés des capitaux en Europe, il faudrait notamment développer le secteur de la titrisation. Troisièmement, elle a également estimé qu’il était nécessaire de développer une gamme de produits européens destinés aux investisseurs de détail afin de permettre une véritable intégration des marchés. À cet égard, Mme Barbat-Layani a souligné les grandes différences de fiscalité entre les États membres, qui devraient être davantage harmonisées afin de garantir que ces produits soient également attractifs dans toute l’UE. Dans l’ensemble, elle a constaté un soutien fort et généralisé en faveur du développement de l’unité de supervision unique, d’autant plus que les finances publiques sont sous pression et que les capacités de financement des banques sont limitées. Selon elle, des résultats rapides pourraient être obtenus dans les domaines de la supervision et de la titrisation.
Verena Ross, directrice exécutive de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
Verena Rossa a souligné que les marchés financiers de l’UE restent très fragmentés par rapport à ceux des États-Unis : presque tous les États membres ont leur propre bourse, contre deux grandes bourses aux États-Unis. L’UE compte également 14 chambres de compensation et de nombreux systèmes de règlement. Alors que les marchés boursiers publics sont en déclin, avec moins d’entreprises qui entrent en bourse, les investissements doivent être complétés par d’autres sources, en particulier pour les start-ups, qui sont essentiellement financées par des banques peu enclines à prendre des risques. L’UE manque également de fonds de pension qui pourraient jouer un rôle dans la capacité d’investissement. Le système des pensions publiques est sous pression. Des incitations fiscales devraient encourager les investissements dans les fonds de pension. M. Ross a convenu avec Mme Barbat-Layani que la surveillance prudentielle devrait être exercée au niveau de l’UE sur la base de règles communes. Le Parlement européen et le Conseil ont donné un mandat à la Commission européenne. Mais le nombre de détails à traiter et les compromis à faire exigent une plus grande flexibilité dans le processus législatif.
Johannes Lindner, codirecteur du Centre Jacques Delors à Berlin
À la suite du plaidoyer d’Enrico Letta et de Mario Draghi en faveur de l’USI, Johannes Lindner a fait valoir que le projet était désormais beaucoup plus justifié qu’il y a un an. Le projet a bénéficié d’une nouvelle appropriation et d’un nouveau leadership grâce aux efforts conjoints de Macron, Scholz et Lagarde et à l’approbation de la lettre de mission de la nouvelle Commission. Mais Lindner a également mentionné un certain nombre d’obstacles à la réalisation de l’USI. Premièrement, la nature de l’intégration des marchés des capitaux en fait une question hautement technique, sur laquelle les décideurs politiques pourraient ne pas vouloir investir beaucoup de capital politique. Deuxièmement, le projet se heurte à des obstacles liés aux fortes différences entre les législations nationales dans des domaines tels que la fiscalité, le droit des sociétés et les systèmes de retraite, ainsi qu’à la diversité des acteurs concernés, qui ont des intérêts particuliers. Troisièmement, les enjeux diffèrent d’un État membre à l’autre, et les avantages sont généralement plus dispersés que les risques. Enfin, le projet a été retardé par la situation politique intérieure en France et en Allemagne. Pour que l’UIS devienne une réalité, M. Lindner a présenté une stratégie en trois volets. Premièrement, la pression exercée par le secteur devrait contribuer à faire avancer les différentes propositions, même s’il s’est montré moins optimiste quant à une réforme de l’architecture de surveillance. Deuxièmement, M. Lindner a fait valoir qu’il faudrait s’engager dans les débats nationaux pour faire avancer l’UIS. Il faut débattre de la manière dont les gens épargnent pour leur retraite, et les réformes et les nouveaux produits dans les systèmes de retraite pourraient contribuer à développer l’UIS au niveau européen. Enfin, il a souligné que les responsables politiques devraient saisir les opportunités offertes par d’autres discussions, telles que celles sur les instruments d’investissement public. Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) sera probablement assorti d’un fonds de compétitivité, qui devrait être conçu de manière à attirer également l’épargne et les investissements privés.