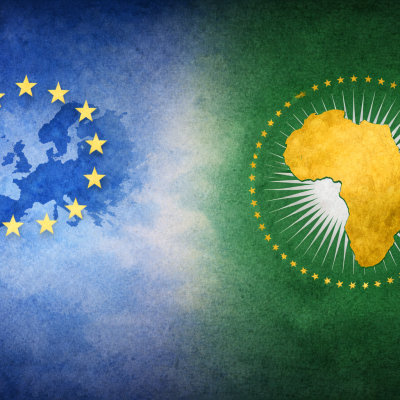Entre crises et ambitions: repenser le budget de l’UE
Infolettre juillet-août 2025

Le 16 juillet prochain, la Commission européenne devrait présenter sa proposition pour le prochain cadre financier 2028-2034. Cet instrument, généralement adopté pour une période de 7 ans, fixera le cadre des recettes et des dépenses de l’Union européenne à long terme. Le précédent avait été adopté en 2020 pour la période 2021-2027. Il avait été complété en 2020 par le plan de relance Next Generation EU et révisé en 2024 afin d’inclure, entre autres choses, la facilité pour l’Ukraine doublant ainsi quasiment le montant initialement prévu. En effet, jamais probablement avant ces dernières années, l’Union européenne n’avait été confrontée à autant de crises simultanément depuis la pandémie de Covid en 2020 à la guerre en Ukraine en 2022 en passant par les crises énergétiques, agricoles etc. L’emprunt commun de 750 milliards contracté en 2020 a facilité son adaptation afin de répondre à ces aléas.
Le contexte international dans lequel s’inscrit le nouveau cadre financier et les défis auxquels sont confrontés les Européens n’augurent pas moins d’imprévus et de besoins financiers. Changement climatique qui s’intensifie, décrochage économique et technologique, vieillissement de la population, la liste est longue et grâce aux rapports rédigés par Enrico Letta et Mario Draghi, le diagnostic est bien connu. Pourtant, le budget commun ne représente qu’1,02% du PIB européen ce n’est presque rien et l’équation du prochain cadre financier se révèle presque impossible à résoudre.
Côté ressources, les États rechignent à accroître leurs contributions nationales, peu de nouvelles ressources propres devraient venir abonder ce budget et la possibilité d’un nouvel emprunt commun reste incertaine, alors même qu’à partir de 2028, le budget européen devra inclure dans ses dépenses le remboursement de l’emprunt contracté lors de la pandémie de Covid, soit entre 25 et 30 millions par an (presque 20% du budget initial). Face à cela, les arbitrages risquent d’être massifs du côté des dépenses et les choix cornéliens lourds de sens et de conséquences. Que penseraient les jeunes européens si le budget, consacré au programme Erasmus, programme le plus populaire au sein de l’UE, venait à être amputé d’une partie de son budget ? Que penseraient les citoyens européens si l’ambition climatique de l’Union européenne était amoindrie alors même qu’en ce début d’été caniculaire, ils perçoivent mieux que jamais le réchauffement climatique ? Que penseraient les habitants des régions rurales et périphériques, qui sont déjà sceptiques sur le projet européen, s’ils recevaient moins de soutien financier pour développer leurs territoires ? Et en même temps, comment financer la sécurité et la défense, l’innovation et la relance de la compétitivité sans réorienter certains moyens ?
Lors du précédent exercice, 90 % des plus de 2 000 milliards d’euros du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et de l’instrument de relance Next Generation EU sont pré-affectés à des objectifs spécifiques, des programmes ou des enveloppes nationales. Cela laisse peu de ressources disponibles pour les imprévus. Il est probable que cela changera peu offrant de fait peu de flexibilité et de réactivité aux aléas au budget commun des années à venir. En plus, une part importante de ces sommes sont allouées aux Etats Membres et leur enveloppe actuelle va servir de plancher à la négociation à venir. Face à des ressources amoindries, la conséquence en sera une nationalisation encore plus importante du budget commun, soit moins de moyens disponibles pour des investissements transversaux et européens. Il y a donc de forts risques que les projets transversaux servent de variables d’ajustement. Dans ce contexte, qui financera le développement des interconnexions électriques nécessaires à la transition énergétique, l’européanisation des industries de défense ou encore l’expansion du réseau européen de trains à grande vitesse si ce n’est pas un budget commun ? Et pourtant, ces initiatives peuvent générer une forte valeur ajoutée pour l’ensemble des pays d’abord parce qu’elles permettent de réduire les coûteuses et fragmentations qui perdurent, voire s’amplifient mais aussi parce qu’elles sont une condition essentielle à l’essor d’une Union européenne, puissance globale. Les Européens ne s’y trompent pas puisqu’Eurobaromètre après Eurobaromètre, ils plébiscitent l’intégration européenne comme le seul niveau pertinent pour relever les défis auxquels ils font face. Un manque d’ambition viendrait très certainement renforcer la confiance des citoyens dans leurs élites et l’euroscepticisme.
La copie que présentera la Commission européenne le 16 juillet ne sera qu’une première ébauche du futur cadre financier pour 2028/2034. Les États, au sein du Conseil, puis les députés, vont négocier pendant des mois et ensuite il faudra que le Parlement européen approuve le texte. Les débats seront inévitablement vifs et la voie vers un accord sera étroite. Malgré la technicité du sujet, les débats devront être éclairés et décryptés afin d’engager les citoyens et d’éviter des polarisations contre-productives. Les priorités devront être claires et peut-être donner lieu à des cibles de dépenses, comme ce fut le cas pour le budget actuel pour lequel par exemple, 30% des sommes engagées devaient aider à la transition énergétique. Les projets proposés devront être concrets et éclairer la valeur ajoutée qu’apporte un financement européen. L’enjeu est énorme et nous renvoie à un constat souvent fait par Jacques Delors, celui de la survie ou du déclin.
Il nous reste donc à attendre le 16 juillet. Bonnes vacances à tous.