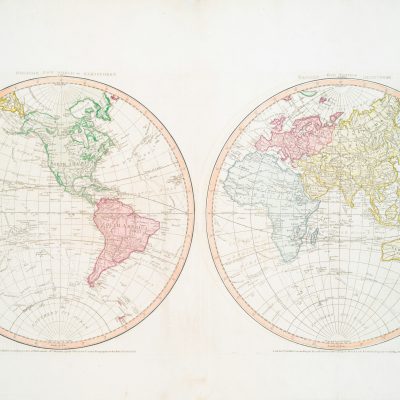Indispensable mais en désordre de marche: l’Europe géopolitique toujours en chantier

Les Européens s’agitent pour la défense de l’Ukraine, et c’est à leur honneur. Après la calamiteuse réunion Trump-Poutine à Anchorage, ils ont accompagné le président Zelensky à Washington, le 18 aout, pour qu’il ne soit pas seul face aux pressions américaines en faveur d’une capitulation. Depuis le début de la guerre, ils ont envoyé pour plus de 160 milliards d’euros d’aide financière, humanitaire et militaire à l’Ukraine. Ils ont accordé la protection temporaire à plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens. Depuis mars 2025, ils multiplient les rencontres au sommet de la « coalition des volontaires » chargée d’apporter des garanties de sécurité à l’Ukraine, après un accord de paix. Pour s’assurer du soutien américain à cette initiative, ils ont même accepté un marché indigne : acheter aux Etats-Unis les armes qu’ils fourniraient ensuite à l’Ukraine, dans le cadre d’un accord commercial signé le 27 juillet, qui ne taxe de 15% que les exportations européennes aux Etats-Unis et qui entérine plus que jamais l’allégeance de l’Europe à l’Amérique. Pour les défenseurs d’une Europe souveraine, la pilule est dure à avaler. Pour les défenseurs de l’Ukraine, c’est sans doute une décision utile. Janus a toujours deux visages.
En revanche, les conditions pour que l’UE devienne un acteur stratégique majeur, pour l’Ukraine et pour l’Europe, sont loin d’être remplies. D’une part, la paix n’est pas au rendez-vous, ce qui rend impossible toute garantie de sécurité à l’Ukraine. La Russie se refuse en effet à tout compromis : la réunion en Alaska entre Trump et Poutine n’a eu d’autres résultats que de démontrer à la face du monde la volonté inébranlable de la Russie de continuer la guerre. D’autre part, la participation des Etats-Unis à cette future coalition de volontaires donnant des garanties de sécurité à l’Ukraine, après un plan de paix, reste une pure hypothèse : Donald Trump n’a strictement rien promis, et même ses éventuelles promesses sont réversibles et modifiables. Autrement dit, les Européens se réunissent, discutent, font des plans, des calculs et des scenarios, comme lors de la réunion des volontaires à Paris, le 4 septembre dernier, mais rien ne peut se mettre en œuvre tant que ces deux hypothèques, russe et américaine, ne sont pas levées. Enfin, il serait plus que temps que les règles européennes elles-mêmes soient respectées : la présidente de la Commission n’est pas le chef des armées, la défense n’est pas de son ressort, et ses déclarations sur « un plan précis » de déploiement de troupes en Ukraine, avec participation américaine, sont tout simplement surréalistes et dangereuses. Il est indéniable que les initiatives de la Commission, sur l’industrie et le financement de la défense, ont été décisives ces dernières années, ne serait-ce que pour sortir les Etats-membres de leur léthargie naturelle sur ces sujets. Toutefois, plus la Commission tentera de s’emparer indument de la responsabilité politique de la défense, moins la dimension européenne de cette défense apparaitra crédible et acceptable par les opinions européennes.
En attendant, que faire ? Sur le plan diplomatique, les Européens n’ont jamais proposé un projet spécifique de retour à la paix : leur politique se limite au soutien sans réserve de la position de l’Ukraine, quelle qu’elle soit, face aux exigences délirantes de la Russie. Cette totale solidarité a certes des vertus, notamment face aux tergiversations américaines. Mais le temps n’est-il pas venu de passer à autre chose ? A une proposition de paix ad hoc, négociée avec Kiev, mais de facture européenne ? Un plan de paix négociable, avec ou sans cessez-le feu préalable, devrait en effet être proposé par les Européens, plutôt que de laisser face à face deux formules également inacceptables : l’extrémisme de la Russie et le laxisme des Etats-Unis. Il est nécessaire de préparer des plans de sécurisation de la future Ukraine. Il le serait encore plus de l’aider à signer un accord de paix qu’elle-même trouverait acceptable et durable. Dans la foulée, il serait utile que les travaux du Conseil, voire de quelques Etats membres volontaires, se concentrent sur la répartition concrète des responsabilités : comment mettre en œuvre l’article de défense de l’UE (art 42-7), en cas de défaillance de l’article 5 de l’Otan, pour la défense d’un Etat balte par exemple ? Comment fonctionnerait un pilier européen de l’Otan ? etc. Quant à la gouvernance de la défense européenne, ce sont les Etats-membres qui en portent seuls la responsabilité. Il est heureux que l’Allemagne, par la voix de son Ministre de la défense, ait rappelé à l’ordre la présidente de la Commission en soulignant que la défense n’est ni un jeu de rôle ni une scène de théâtre. Reste à espérer que tous les Etats en soient également bien convaincus.