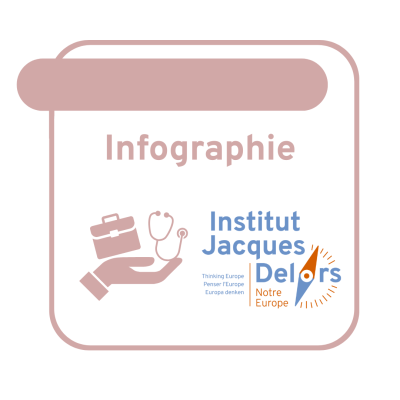L’Autorité Alimentaire européenne: enjeux institutionnels de la régulation des risques
Etude publiée en 2001 dans l’ancienne série « Problématiques européennes ».

AVANT PROPOS DE JACQUES DELORS
Bien qu’elle ne soit pas encore totalement dénouée, on peut d’ores et déjà affirmer de la « crise de la vache folle » qu’elle constitue un des évènements saillants de l’histoire européenne de ces quinze dernières années. Elle a contraint les responsables politiques et administratifs, les experts et les producteurs à s’interroger sur leur rôle dans la garantie de la sécurité alimentaire aussi bien au niveau de nos États que de l’Union européenne. De façon plus générale, elle a révélé des mutations profondes de nos sociétés, dans leur rapport à l’alimentation, aux progrès scientifique et technique, à l’acceptation du risque.
Pour ravageur qu’il soit, cet épisode a sa contrepartie créatrice : il contribue à remettre à plat des questions fondamentales que bien peu jugeait utile d’approfondir jusqu’alors : Quel est le statut de l’expertise scientifique ? Que doit-on faire lorsque les faits scientifiques sont incertains, insuffisants ou contradictoires ? Où s’arrête la responsabilité de l’expert et ou commence celle du politique ? C’est à l’intersection de ces interrogations nouvelles qu’est en train de naître l’Autorité alimentaire européenne, dont l’historique méritait d’être retracé en ce qu’il éclaire des problématiques qui sont destinées à perdurer.
Il faut porter au crédit de l’actuelle Commission et de son Président d’avoir considéré, dès son investiture, que ces questions devaient être au premier plan de ses priorités et de présenter maintenant un projet opérationnel. Il faut porter au crédit des États membres d’avoir très vite accepté le principe d’une solution européenne, à la même dimension géographique que le problème posé. On aimerait que ce genre d’évidence, qui est loin d’aller de soi, s’impose plus souvent lorsque nécessaire, comme par exemple dans la lutte contre le crime international ou lorsqu’il est question de la protection de l’environnement.
Il reste que le débat est loin d’être clos si je me réfère à l’analyse dense et nuancée de François Lafond. Je retiens pour ma part deux questions qui méritent un examen plus approfondi : Pourquoi se limiter au domaine alimentaire alors que la prochaine crise née du conflit entre le progrès scientifique et l’aspiration de nos sociétés à la sécurité, si elle doit se produire, sera par nature imprévisible et vraisemblablement différente de la « crise de la vache folle » ? Est-on certain qu’en distinguant aussi nettement la frontière entre l’expertise et la décision politique, l’on soit définitivement quitte d’une réflexion sur la « régulation des risques » dans un univers incertain alors que la demande de sécurité de la part des citoyens européens n’a jamais été aussi exigeante ?
Je remercie François Lafond d’avoir clarifié, autant que faire se peut, ces questions difficiles et qui le resteront longtemps encore. Puisse cette étude contribuer à l’émergence, dans la société européenne, de cette « culture du risque » que les plus lucides de nos responsables politiques commencent à appeler de leurs vœux.