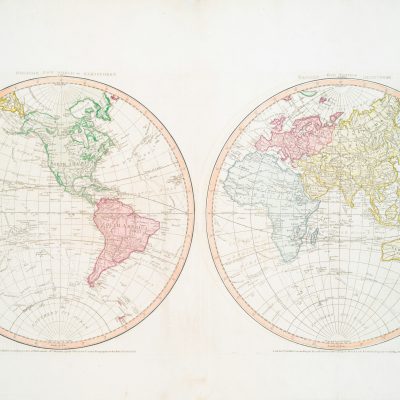Les 100 jours de l’Union européenne sous Donald Trump

Qu’a fait l’Union européenne durant les 100 premiers jours de Donald Trump ? Question pas forcément absurde, au regard des enjeux cruciaux que le président des États- Unis soulève par sa gestion absolument abracadabrantesque de l’ordre international. Toutefois, durant ces mêmes trois mois, le bilan de l’Union européenne n’apparait pas forcément très brillant.
L’enjeu stratégique est de premier ordre. Il concerne aussi bien l’avenir de la guerre en Ukraine que celui de la sécurité de l’Europe dans son ensemble. L’Union et ses États membres ont certes soutenu les efforts du président Zelinsky, financièrement, militairement, politiquement, tout en renforçant les industries de défense ukrainiennes. Dans l’optique d’un futur cessez le feu, négocié toutefois sans aucune participation de l’UE, ils ont avancé plusieurs idées pour illustrer la contribution possible des Européens : notamment le déploiement d’une « force de réassurance » pour soutenir l’Ukraine contre toute rupture du cessez le feu par la Russie. La France et le Royaume Uni ont pris le leadership de cette assistance militaire : Londres comme Paris ont rivalisé d’énergie pour réunir les chefs de gouvernement d’une quinzaine de pays volontaires (2 mars et 15 mars à Londres, 17 février et 27 mars à Paris), du 11 au 13 mars à Paris ce sont trente-sept chefs d’État-major qui se sont réunis à Paris, même effervescence en avril avec une réunion tripartite des États-Unis de l’Ukraine et de trois Européens, à Paris le 17, et à Londres le 23 dans le même format tripartite, etc. etc. Or rien de concret n’est sorti de cette agitation diplomatique : ni la mission, ni la zone de déploiement de la force de réassurance n’ont fait l’objet d’un accord, très peu de pays sont prêts à déployer des troupes en Ukraine en l’absence de soutien américain, même le Royaume Uni s’est mis à hésiter, en parlant plutôt de forces aériennes que de troupes au sol. Quant à proposer une initiative diplomatique européenne, négociée avec l’Ukraine, qui aurait pu permettre de sortir des surenchères américano-russes, les Européens n’ont pas donné l’impression d’y avoir travaillé sérieusement, voire même d’y avoir pensé.
Enfin, sur le volet de la défense européenne, la construction d’une autonomie stratégique si unanimement considérée désormais comme une priorité, n’a pas avancée d’un iota.
L’enjeu commercial est tout aussi vital. Donald Trump s’est engagé dans une spirale protectionniste qui attaque frontalement le dogme européen d’un libéralisme juste et non faussé. Pris lui-même à son propre piège, Donald Trump a dû faire machine arrière et proposer à tous les pays concernés (sauf la Chine) un moratoire de 90 jours pour « négocier » avec les États-Unis. Sur ce dossier, les Européens ont été davantage à la hauteur du défi : il est vrai que le commerce représente l’ADN de la construction européenne, et que la Commission a accumulé une expertise et une légitimité dans les guerres commerciales qu’aucun État ne lui dispute. Contre la première salve de droits de 25% sur l’acier et l’aluminium européens, l’Union a d’abord répliqué par des droits de douane réciproques sur certains produits américains, pour un montant équivalent (27 milliards d’euros) aux éventuelles pertes subies par les industries européennes. Motos, volaille, soja étaient concernés. Après l’annonce par Donald Trump d’un moratoire de trente jours sur les droits de douane réciproques, l’UE a suspendu ces mesures de rétorsion, « pour donner une chance aux négociations ». Or cette générosité européenne peut faire débat : en effet, les taxes sur l’acier et l’aluminium, imposées par Donald Trump dès février 2025, restent en vigueur et n’entrent pas dans le moratoire. On se demande pourquoi l’UE n’a pas appliqué un principe de réciprocité en maintenant certaines taxes en riposte.
Reste enfin l’enjeu démocratique, sans doute le plus crucial pour l’avenir de l’UE. L’équipe américaine ne cesse de militer en faveur d’une contre-révolution fasciste en Europe. Le vice-président américain, JD Vance, ne cache pas son soutien à l’AFD, le parti d’extrême droite allemande qui a obtenu 20,8% des voix aux élections législatives de février 2025. Marco Rubio, accuse le gouvernement allemand dont les services viennent de définir l’AFD comme un extrémisme de droite : « «L’Allemagne vient de donner à son agence d’espionnage de nouveaux pouvoirs pour surveiller l’opposition. Ce n’est pas de la démocratie, c’est de la tyrannie déguisée» Elon Musk soutient l’extrême droite britannique et n’hésite pas à faire ce qui ressemble fortement à un salut nazi. Son collègue et ennemi Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump et adepte lui aussi du salut nazi, vient de dévoiler son plan de conquête idéologique des États européens : “Après Berlin, avec le mouvement MAGA, nous prendrons l’Europe ». Autrement dit, l’ingérence américaine dans les élections européennes est à la fois transparente et cynique : certains États protestent, mais l’UE dans son ensemble reste muette. Les Russes et les Chinois sont accusés d’agression quand ils tentent de nous manipuler, mais les USA semblent avoir un traitement de faveur honteux.
Bilan des 100 premiers jours de l’UE sous Trump ? Peut nettement mieux faire et le devrait très vite.