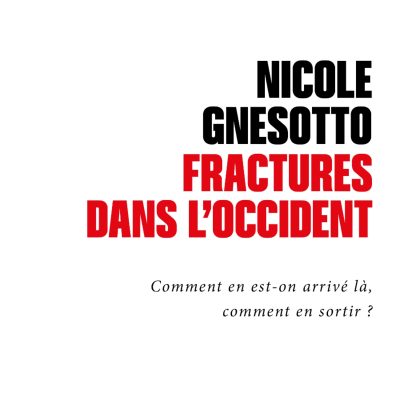Les élections européennes et la France: deux paradoxes, des éternelles victimes

On craignait une poussé majeure des partis populistes-extrémistes lors des élections européennes du 9 juin 2024 : ils ont certes progressé, mais ils gagneront au total moins d’une vingtaine de sièges au Parlement européen. Le résultat le plus frappant de ces élections concerne en revanche le décalage entre la stabilité des institutions, leur solidité même, comparée aux dynamiques de déstabilisations profondes dans plusieurs pays membres. La France bien sûr, sous l’effet de l’incroyable décision d’Emmanuel Macon sur la dissolution immédiate de l’Assemblée ; l’Allemagne également, où la coalition du chancelier Scholz a subi un revers majeur au bénéfice de la CDU/CSU ; la Belgique, où le premier ministre a dû démissionner face à l’échec fulgurant de son parti et le premier rang largement gagné par deux partis rivaux nationalistes et extrémistes ; l’Autriche, ou l’extrême droite du FPO est arrivée en tête avec une majorité forte ; même la Pologne, récemment convertie à la démocratie réelle, s’avère encore très fragile, avec un coude à coude entre les populistes du PIS et le parti gouvernemental de Donald Tusk. Bref, la crise démocratique est bien réelle dans un nombre important de pays, notamment dans la CEE historique des six fondateurs.
Le second paradoxe concerne l’effroi suscité un peu partout par la perspective d’une arrivée au pouvoir en France des partis d’extrême droite ou d’extrême gauche, et la passivité politique officielle des leaders et des institutions européennes. En 2000, lorsque le FPO autrichien de Jörg Haider avait remporté les élections générales, la présidence portugaise, avec le soutien de la Commission et du Parlement européen, avait publié une déclaration détaillant les mesures diplomatiques bilatérales qui seraient prises si la coalition avec le FPO voyait le jour. Ces sanctions devaient être mises en oeuvre dès la formation du gouvernement. Aujourd’hui ? Rien. D’une part, tout le monde semble trouver normal que la Hongrie de Victor Orban prenne la présidence de l’Union européenne au 1 juillet, alors que ce pays est en violation notoire de l’état de droit, et qu’il est sous le coup d’une procédure d’infraction de la part de la Commission européenne. D’autre part, le leadership politique de Giorgia Meloni, qui se réclame du « post-fascisme », semble non seulement admis mais même agréable, tant le couple franco-allemand irritait, chaque pays pour des raisons différentes, depuis des décennies. Obsédées par leur confirmation ou leur nomination, les grandes voix européennes se gardent donc bien de manifester leurs inquiétudes, se réfugiant derrière le très commode respect de la volonté des peuples. Résultat : la Commission va sans doute entamer une procédure de sanctions contre la France, mais au nom de critères techniques et financiers (le déficit excessif de Paris), la présidente et les ténors du Parlement européen se taisent sur la montée du fascisme, du racisme, de l’islamisme et de l’antisémitisme dans le pays qui fut aux origines de la construction européenne. Enfin, triste confirmation s‘il en était besoin : le glorieux peuple européen n’existe pas. On ne voit venir en effet, du côté de la société civile, aucun mouvement syndical, aucune mobilisation des intellectuels européens, aucune manifestation d’ampleur contre le risque de voir la France sombrer.
Même s’il est difficile d’anticiper l’état de la France après le deuxième tour du 7 juillet, il peut néanmoins être utile de cerner les risques que ferait courir à l’Union une France gouvernée aux extrêmes. Les programmes du RN ou du Front de gauche sont extrêmement flous à ce stade, mais certaines tendances semblent fortes, au-delà de l’inévitable accroissement de la dette publique et du déficit budgétaire français. Tout d’abord, et dans les deux cas, une remise en cause de la solidarité atlantique est inévitable. Ceux qui croient que la cinquième République réserve la politique étrangère et la défense au seul président de la République, se trompent : les articles 20 et 21 de la Constitution stipulent : « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée ». « Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale ». Quant à l’Assemblée nationale, elle possède l’arme suprême, le blocage ou la réduction des budgets : dans ce chapitre, les aides à l’Ukraine seront sans doute les premières victimes, quels que soient les accords conclus, avec, pourquoi pas, comme le dit le RN, une réduction de la contribution française au budget de l’UE. Quant à la défense européenne, elle sombrera très vite dans le pacifisme tiers-mondiste, l’anti-germanisme ou le nationalisme nucléaire qui dominent dans tel ou tel des partis extrémistes. Deuxième conséquence : la remise en cause des accords de libre-échange signés ou en cours de discussion, le choix d’une préférence nationale, en premier lieu pour les commandes publiques, la remise en cause d’une partie de la PAC, le refus de l’élargissement notamment à l’Ukraine. Troisièmement enfin, le risque d’un Etat ingouvernable, par absence de majorité absolue, par émeutes populaires, par résistances administratives, ou les trois à la fois, ce qui reviendrait pour la France à une politique de la chaise vide virtuelle, devant l’impossibilité pour le pays de prendre des décisions.
Il y a encore un mois, nul n’aurait imaginé pareil scénario de désastre. L’Histoire jugera les responsables d’une telle régression. Les perdants quant à eux n’ont pas besoin d’attendre longtemps pour être fixés, citoyens de France comme des autres pays de l’Union européenne, unis hélas dans le seul visage possible du peuple européen, en 1914 comme en 2024, celui de victime désignée. Jean de La Fontaine l’écrivait déjà en 1668 : « Hélas ! On voit que de tout temps les petits ont pâti des sottises des grands ».