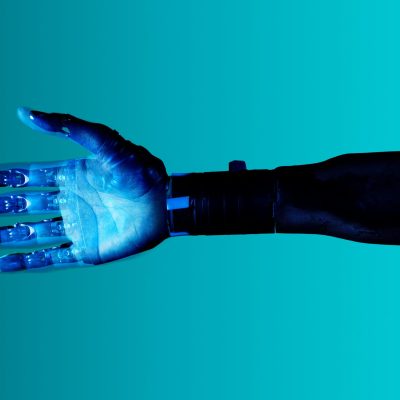L’impact inattendu de la prospérité
Comment la manipulation des conséquences de la mondialisation par les mouvements d’extrême droite met-elle en danger l’ordre international ?
Publié pour la première fois au Centre brésilien pour les relations internationales (CEBRI) en septembre 2024.
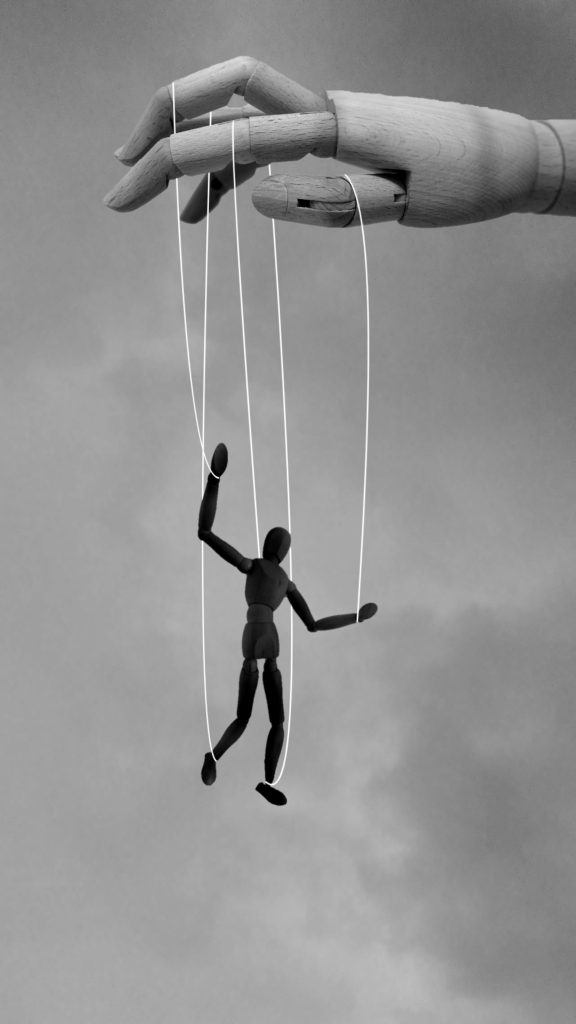
Dès les années 1990, la société civile mondiale et de nombreuses organisations non gouvernementales ont souligné les limites de la mondialisation. Lors des Forums sociaux mondiaux à Porto Alegre (Brésil) et ailleurs, ainsi que lors de réunions d’organisations internationales majeures telles que la conférence annuelle de l’OMC à Seattle en 1999, les lacunes d’une intégration économique, financière et commerciale qui ne profitait qu’à quelques-uns ont été dénoncées. Ces mouvements sociaux ont été soutenus par les partis d’une gauche déjà qualifiée avec mépris de radicale quelques années seulement après la fin de la guerre froide et l’effondrement du système économique communiste, que beaucoup ont interprété comme une victoire du capitalisme par le chaos, la fin de l’histoire en quelque sorte.
Pourtant, ces mouvements sociaux masquaient une instrumentalisation naissante des conséquences de la mondialisation par un autre « extrême » politique, l’extrême droite. Paul Krugman avait déjà décrit ce phénomène lorsqu’il a publié Pop Internationalism en 1996. L’auteur dénonçait l’instrumentalisation de la dynamique économique à des fins politiques par le biais d’interprétations erronées ou déformées. Et s’il admet que le libre-échange n’est pas toujours le choix le plus efficace, en particulier dans des situations de concurrence imparfaite ou de rendements croissants, il élude les conséquences non économiques de la mondialisation. Cette omission a ensuite été reprise par de nombreux analystes (tels que Thomas Friedman, auteur de The World is Flat en 2005) et critiquée par les mouvements d’extrême droite, qui dénoncent une « certaine » élite qui profite de la mondialisation mais ne veut pas voir ses défauts et les difficultés d’une classe ouvrière au bord de la paupérisation, les perdants de cette même mondialisation, expliquent-ils.
Un impact inattendu de la prospérité qui, instrumentalisé par ces partis d’extrême droite, met aujourd’hui en danger non seulement nos démocraties, mais aussi l’ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale précisément pour assurer un développement économique généralisé, accessible à tous dans des conditions plus équitables que par le passé, et ce, afin d’éviter les guerres… Cette rhétorique anti-élite et complotiste a été au cœur de l’élection de Donald Trump aux États-Unis et du choix du peuple britannique, lors du référendum de 2016, de quitter l’Union européenne (Brexit). Sa banalisation et sa résonance auprès d’une population fragilisée par la mondialisation ont conduit à la montée des partis d’extrême droite dans de nombreux pays et, dans certains cas, à leur arrivée au pouvoir, comme en Italie, en Pologne, au Brésil et en Argentine ces dernières années. Néanmoins, ces mouvements sont au moins autant une source de danger que de solutions.
L’analyse s’est sans doute développée ces dernières années. Économistes, sociologues et politologues ont tenté de comprendre le phénomène. Comment la mondialisation peut-elle être parmi les causes de la montée des partis d’extrême droite ? Comment ces mouvements peuvent-ils menacer l’ordre international ? La littérature éclaire divers facteurs possibles, allant des causes économiques et sociales à des explications plus culturelles, voire géopolitiques. Cet article vise à résumer ces différents facteurs afin de comprendre comment les partis d’extrême droite ont pu se les approprier pour convaincre leurs partisans et prospérer politiquement. Il explique ensuite dans quelle mesure les « recettes » proposées par ces partis sont non seulement loin d’être des solutions, mais risquent également d’amplifier encore les problèmes, conduisant à un cercle vicieux de repli et de violence de plus en plus profitable à l’extrême droite, mais néfaste pour l’ordre international, le développement économique et le progrès social, ainsi que pour la paix et la stabilité dans le monde.
Comment la mondialisation peut-elle être l’une des causes de la montée des partis d’extrême droite ? Comment ces mouvements peuvent-ils menacer l’ordre international ? (…) [Cet article] explique dans quelle mesure les « recettes » proposées par les partis [d’extrême droite] sont non seulement loin d’être des solutions, mais risquent également d’amplifier encore les problèmes, conduisant à un cercle vicieux de repli et de violence qui profite de plus en plus à l’extrême droite, mais nuit à l’ordre international, au développement économique et au progrès social, ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans le monde.
L’IMPACT INATTENDU DE LA PROSPÉRITÉ DANS UN MONDE GLOBALISÉ
Dans un article publié en 2021, l’économiste Dani Rodrik observe : « Il existe des preuves convaincantes que les chocs de la mondialisation, qui agissent souvent à travers la culture et l’identité, ont joué un rôle important dans la montée en puissance des mouvements populistes, en particulier ceux de droite. » Il explique que, si les experts ont souvent opposé les causes économiques et culturelles à la montée du populisme d’extrême droite, la réalité est plus complexe. Pour rappel, Dani Rodrik a été l’un des premiers économistes, à la fin des années 1990, à souligner les effets pervers d’un processus de mondialisation qui crée des gagnants et des perdants, et à relier les questions économiques et politiques à travers un trilemme qui décrit l’impossibilité de combiner à la fois l’intégration économique (mondialisation), la souveraineté nationale et la démocratie (Rodrik 1998).
Plusieurs exemples illustrent la complexité des conséquences de la mondialisation et les liens entre celles-ci et la montée des partis d’extrême droite au cours des vingt dernières années, au-delà des seuls facteurs économiques. La Pologne en est un bon exemple. Le pays est devenu membre à part entière de l’Union européenne en 2004. Son produit intérieur brut par habitant s’élevait alors à 6 684 dollars américains par an. Vingt ans plus tard, il a été multiplié par trois pour atteindre 21 600 dollars américains, ce qui correspond à la plupart des pays qui ont rejoint l’Union européenne à cette époque. Cependant, le miracle économique et l’enrichissement global de la société polonaise ont peu pesé face aux craintes liées à la crise migratoire de 2015, au sentiment de perte de souveraineté ou aux inégalités qui persistaient entre les régions de ce pays. En 2015, un gouvernement d’extrême droite a remporté les élections.
Plus précisément, le facteur culturel de la mondialisation est étroitement lié aux flux migratoires et à leur instrumentalisation par les partis d’extrême droite. Dans un article publié en 2011, Lucassen et Lubbers avaient déjà noté le racisme endémique dans la société américaine et la stigmatisation croissante de la religion musulmane en Europe. Pour ces partis d’extrême droite, la mondialisation a amplifié les flux migratoires en supprimant les frontières. Ces arguments sont discutables, et la réalité de la situation est loin de les confirmer, car les flux migratoires sont le plus souvent une conséquence de la guerre, et les frontières sont encore étroitement surveillées dans le monde entier.
L’impact des flux migratoires sur la montée du nationalisme culturel a été expliqué par Eatwell et Goodwin en 2018 (Eatwell & Goodwin 2018). Les auteurs démontrent comment la mondialisation et l’immigration ont intensifié les discours xénophobes et identitaires et développent un modèle où quatre facteurs se combinent pour créer un ressentiment parmi certaines parties de la population : (1) la destruction de la culture nationale par l’immigration à grande échelle ; (2) la rareté des opportunités due à la mondialisation, mais aussi au ralentissement de la croissance dans l’économie postindustrielle ; (3) la méfiance des électeurs ruraux et ouvriers à l’égard des institutions, qui se sentent de plus en plus aliénés par les médias et les élites libérales, cosmopolites et urbaines ; (4) le déclin des partis politiques et des idéologies traditionnelles, qui entraîne une plus grande volatilité dans les décisions des électeurs et le soutien aux partis entre les élections. Dans ce contexte, le sentiment de marginalisation, de perte d’identité et/ou d’opportunités crée un fort ressentiment à l’égard d’une classe politique qui n’a pas su protéger les plus faibles, entraînant le recul des partis traditionnels, comme le décrivent Eatwell et Goodwin, au profit des partis extrémistes. La diffusion d’informations et de désinformations via les réseaux renforce encore cette instrumentalisation et cette perception du facteur culturel, créant des chambres de résonance pour les actualités et les images choquantes, un biais de confirmation, des instruments très efficaces pour mobiliser les foules et une plateforme accessible pour diverses théories du complot.
En ce qui concerne le facteur économique, la libéralisation économique, dans ce cas par le développement des flux commerciaux, est également à blâmer. Elle a facilité la délocalisation et la désindustrialisation des économies les plus avancées, détruisant les emplois les moins qualifiés et créant un chômage de masse parmi les classes populaires. Et même si ce phénomène est avéré, la solution proposée par l’extrême droite – repli sur soi et protectionnisme – est loin d’être optimale. Il faut dire que, dans l’ensemble, les économies les plus avancées se sont enrichies grâce à la mondialisation. Le cas des États-Unis est instructif à cet égard. Au cours de la décennie qui a précédé la crise de 2008, et donc au moment où la Chine a adhéré à l’OMC, ce pays a connu une croissance sans précédent. Plus intéressant encore, après la crise de 2008 et jusqu’à la pandémie de Covid-19, il a connu la plus longue période de croissance ininterrompue de son histoire. Le revenu annuel par habitant du pays est passé de 37 101 dollars américains en 2001 à 80 779 dollars américains (c’est-à-dire, en neutralisant l’inflation, de 46 500 dollars américains à 60 256 dollars américains), ce qui représente une augmentation moyenne de 600 dollars américains par habitant et par an, hors inflation, ou 1 900 dollars américains aux prix courants, inflation comprise (FMI 2024). Cependant, cette prospérité est largement perçue, à juste titre, comme inégalement répartie, ce qui alimente un ressentiment croissant parmi les populations qui se sentent laissées pour compte.
L’économiste Angus Deaton, lauréat du prix Nobel, a souligné dans plusieurs de ses travaux ce qu’il décrit comme le désespoir des classes ouvrières aux États-Unis (Deaton & Case 2020). L’auteur observe que les décès par suicide, overdose ou alcoolisme sont en augmentation constante dans ce pays depuis deux décennies, mais qu’ils touchent surtout les hommes blancs non hispaniques sans instruction, bien plus que le reste de la population. L’une de ses observations est la relative stabilité, voire la dépréciation, des revenus de ces classes populaires dans un pays qui s’est considérablement enrichi. En conséquence, l’augmentation massive des inégalités crée un sentiment d’injustice, terrain idéal pour l’extrême droite et même les théories du complot. Il convient donc de discuter d’un facteur social ou politique plutôt que d’un facteur économique. Dany Rodrik (1998) conclut son article en notant que « l’intégration économique internationale semble avoir entraîné une désintégration interne dans de nombreux pays, creusant le fossé entre les gagnants et les perdants de l’exposition à la concurrence mondiale ». L’intégration insuffisante de ces conséquences différenciées et inégales de la mondialisation dans les politiques nationales (éducation, santé, politiques de redistribution) amplifie encore l’écho de ce discours extrémiste. Cet argument rejoint les indicateurs macroéconomiques et interroge le lien entre la croissance économique renforcée par les opportunités offertes par la mondialisation, mais reste déconnecté du bien-être de la population (justice et égalité, sécurité économique et emploi, accès à la santé, etc.).
Les crises financières, comme celle de 2008, en sont un autre exemple. Elles sont presque toujours le résultat d’une prise de risque excessive (spéculation) de la part des acteurs financiers, des banquiers, des investisseurs et d’une population aisée disposant d’économies à investir. En fin de compte, cependant, ce sont les classes populaires qui supportent le poids de la crise économique et des difficultés qui l’accompagnent : déflation, chômage, récession, inflation, etc. Il existe de nombreux exemples historiques du lien entre la crise financière et la montée de l’extrême droite, comme le soulignent Funke et al. (2016) dans leur étude sur les conséquences électorales des crises financières dans 20 pays développés depuis 1870. Doerr et al. (2020) se penchent sur la montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930, soulignant le rôle des faillites bancaires dans l’antisémitisme et le soutien au parti nazi dans ce pays. La déréglementation des marchés financiers dans les années 1990 a conduit à leur mondialisation et à leur expansion, sans précédent dans l’histoire économique. Elle a facilité la prise de risques par ceux qui pouvaient investir et en tirer directement profit, mais elle a également créé les conditions de la crise de 2008 et de ses conséquences pour la classe ouvrière. Dans un ouvrage publié en 2014, Wolfgang Streeck analyse également dans quelle mesure la crise de 2008 était le résultat du changement néolibéral du capitalisme après les chocs pétroliers des années 1970 et s’est accélérée après la fin de la guerre froide. Il explore les tensions et les conflits qui en ont résulté entre les États et les gouvernements, les électeurs et les intérêts capitalistes, tels qu’ils se sont exprimés dans l’inflation, la dette publique et l’endettement privé croissant, ainsi que les conséquences pour l’évolution des relations entre le capitalisme et la démocratie, conduisant à ce qu’il décrit comme « une immunisation croissante du premier contre la seconde ».
Pour diverses raisons, la mondialisation crée une insécurité économique (Margalit 2011). Qu’elle soit réelle ou perçue, cette insécurité reste un concept multiforme, combinant des facteurs internes à chaque pays et des facteurs plus globaux. Sur le plan interne, nous constatons les conséquences négatives de la mondialisation déjà décrites pour une partie de la population, souvent les classes ouvrières, qui conduisent à une crainte de paupérisation et de déclassement. Le facteur mondial est directement lié aux lacunes d’une gouvernance mondiale dépassée face à ce contexte mondial, aux défis posés par la mondialisation et à ses conséquences (Ikenberry 2018). Cette gouvernance s’avère inadéquate, non seulement parce qu’elle est incapable de relever les nombreux défis mondiaux, mais aussi parce qu’elle n’a pas réussi à se réformer pour s’adapter à un monde plus diversifié, multilatéral et fragmenté, où les pays du Nord (essentiellement l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie) ont progressivement perdu de leur influence au profit des pays émergents et de la Chine.
De plus, ces échecs de la gouvernance mondiale l’ont empêchée de prendre le relais de l’affaiblissement des États et des politiques publiques nationales. D’une part, la déréglementation ou le non-respect des règles par les gouvernements ou les entreprises a entraîné des distorsions de concurrence préjudiciables. D’autre part, la concurrence fiscale entre les pays et, plus généralement, l’inadéquation entre les flux de revenus circulant librement à travers le monde et un système fiscal qui reste national crée non seulement les conditions d’une évasion fiscale massive, mais réduit également les ressources disponibles pour investir dans les politiques publiques en matière de santé, d’éducation et d’infrastructures. Enfin, face à des défis mondiaux tels que le changement climatique, l’affaiblissement de la gouvernance mondiale empêche la réponse coordonnée nécessaire pour produire ou protéger les biens communs mondiaux (Bava 2022).
Cette insécurité tend à renforcer l’extrême droite, comme le souligne l’article publié en 2018 par Colantone et Stanig, qui étudie 15 pays européens soumis à des chocs liés aux importations chinoises. Cependant, les deux aspects de cette insécurité sont, bien sûr, étroitement liés et, en même temps, ambigus. Dans un article publié en 2016, Paul Krugman note que les importations chinoises ont peut-être été des facteurs décisifs dans la hausse des salaires et le maintien d’un taux d’emploi très élevé, pratiquement inconnu dans l’économie américaine depuis 20 ans. La concurrence croissante est source de meilleurs prix pour les consommateurs et de pouvoir d’achat, mais aussi de chômage pour les travailleurs : les gagnants et les perdants de la mondialisation ont conduit à l’amplification des inégalités, au sentiment d’injustice et à la peur de la déclassification. Face à cette ambiguïté, les stratégies de sécurité économique tentent de se définir, notamment celle développée par l’UE. Comment protéger les salariés des entreprises confrontées à une concurrence mondiale acharnée tout en préservant le pouvoir d’achat des consommateurs, inévitablement affecté par les contraintes de la concurrence internationale ? Comment protéger le marché européen et les entreprises européennes sans risquer la fermeture des marchés étrangers ?
UN ORDRE INTERNATIONAL MENACÉ : QUELLES CONSÉQUENCES ?
Les conséquences de la crise de 2008 ont donné lieu à de nouvelles manifestations affiliées à ce que l’on décrit souvent comme des mouvements radicaux de gauche, tels que le mouvement « Occupy Wall Street » aux États-Unis, un mouvement populiste de gauche contre les inégalités, la cupidité des entreprises et des marchés financiers et l’influence croissante de l’argent en politique ; « Podemos » ou « Indignados » en Espagne, qui s’opposent aux politiques d’austérité et au chômage ; ou « Nuit debout » en France, contre une loi de réforme du marché du travail, la loi « El Khomri » en 2016. La même année, les partis populistes de droite gagnaient du terrain. La victoire de Donald Trump a suivi celle de Rodrigo Duterte aux Philippines, dans une année qui a également vu Poutine et Erdogan maintenir ou amplifier leur emprise autoritaire en Russie et en Turquie, respectivement, et les mouvements d’extrême droite faire de nouvelles percées à travers l’Europe (Worth 2017). Toujours cette année-là, le 23 juin 2016, le peuple britannique a voté à une majorité de 51,89 % en faveur de la sortie de l’Union européenne en réponse à la question référendaire « Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l’Union européenne ou quitter l’Union européenne ? ».
Cependant, alors que les mouvements de gauche s’opposent généralement au système économique capitaliste, qu’ils considèrent comme une source d’injustice sociale néfaste, les partis d’extrême droite estiment que l’érosion des frontières entre les pays, l’essor des flux commerciaux, financiers et personnels compromettent la souveraineté des pays (Biancotti et al. 2017) et la sécurité des individus, des économies nationales et des sociétés (Salgado & Stavrakakis 2019) . Ils préconisent alors un repli sur soi pour « reprendre le contrôle », comme le préconisent les partisans du Brexit au Royaume-Uni (Abreu & Öner 2020). Même si leur diagnostic est dogmatique et instrumentalisé, il s’appuie sur les expériences ou les sentiments d’une partie de la population concernant les conséquences réelles de la mondialisation. Cependant, les solutions et les politiques qu’ils proposent sont lourdes de dangers immédiats et à long terme.
L’exemple britannique illustre bien l’impasse et les dangers de ces « recettes ». En effet, la Grande-Bretagne a probablement été le premier pays à expérimenter une forme de déglobalisation. L’appartenance au marché unique européen est considérée par les partis d’extrême droite européens comme l’une des formes les plus réussies de la mondialisation et de ses conséquences, car elle garantit la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des travailleurs grâce à des normes et des règles communes. Huit ans après le référendum et près de quatre ans après la sortie effective du pays de l’Union européenne, celui-ci est loin d’avoir « repris le contrôle », comme en témoigne la destitution de la Première ministre Liz Truss à l’automne 2022 après avoir présenté un budget jugé coûteux et donc dangereux par les marchés financiers. Il souffre également de difficultés économiques : les investissements restent inférieurs à ce qu’ils étaient avant le référendum, la croissance réelle est nettement inférieure à la croissance potentielle, et les contraintes réglementaires supplémentaires générées par la fin de la libre circulation dans un marché européen unique entraînent des coûts supplémentaires estimés à 20 % pour certains secteurs et des retards importants (temps nécessaire pour franchir la frontière rétablie par le Brexit, nouvelles formalités nationales à respecter, etc. Les problèmes sociaux et la pauvreté restent également élevés, en partie liés à une inflation plus forte qu’ailleurs en Europe, et ils amplifient les tensions communautaires, comme ce fut le cas début août 2024 (Kirka 2024).
Les quatre années de l’administration Trump aux États-Unis, de 2016 à 2020, sont des exemples instructifs des limites de ces politiques et des dangers que cette vision du monde fait peser sur les relations internationales et la gouvernance mondiale. En effet, l’une des conséquences de cette période a été, aux États-Unis, un contrôle plus strict de l’immigration. Outre les tragédies humaines, cela a entraîné de graves pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs spécifiques de l’économie et dans certaines régions fortement dépendantes des travailleurs étrangers. Une étude récente publiée en mai 2024 par le Bureau national de recherche économique a souligné que cet impact dépasse le secteur agricole, car les populations immigrées sont surreprésentées dans les secteurs des nouvelles technologies et des start-ups : « En 2022, les quatre entreprises privées américaines les plus valorisées (…) avaient des fondateurs immigrés (Chodavadia et al. 2024, 3). »
De plus, le refus de reconnaître les résultats des élections de 2020 affaiblit encore aujourd’hui les institutions de la démocratie américaine. À un niveau plus global, le retrait des États-Unis du Plan d’action global conjoint (JCPOA) de 2015, de l’accord sur le nucléaire iranien ou de l’accord de Paris sur le climat, le blocage de l’Organisation mondiale du commerce ou le durcissement des relations avec la Chine ont été des décisions cruciales qui ont déstabilisé les relations internationales au niveau régional ou mondial.
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU… PRAGMATISME ET COMPROMIS POUR RECONSTRUIRE UN NOUVEL ORDRE MONDIAL
« On ne peut pas tomber amoureux d’un marché unique. » Cette phrase, souvent répétée par Jacques Delors lorsqu’il présidait la Commission européenne entre 1985 et 1995, est également présente dans le discours qu’il a prononcé devant le Parlement européen le 17 janvier 1989, lorsqu’il a ajouté : « L’Europe en tant que partenaire exige une plus grande cohésion, un plus grand sens des responsabilités, plus d’initiative. L’histoire frappe à notre porte. Allons-nous faire semblant de ne pas l’entendre ? » À ce moment précis, le rideau de fer qui séparait l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest était déjà en train de se fissurer, et le mur de Berlin allait tomber quelques semaines plus tard, présentant à l’Union européenne l’un des plus grands défis de son histoire, celui de l’élargissement. Néanmoins, au début des années 1990, l’Acte unique européen relance le projet d’un marché unique européen. Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 1993, créant un marché intérieur au sein duquel les personnes, les biens, les services et les capitaux pouvaient circuler librement. Moment clé de la construction européenne, la vision libérale qui a dominé cette période nous a fait oublier les avertissements de Jacques Delors : la prospérité n’est pas une fin en soi, et elle est loin d’être la solution à tout. La montée des mouvements d’extrême droite à partir de cette époque, et plus encore après la crise de 2008, est directement liée à ce refus ou à cette incapacité de voir et d’entendre à la fois les limites du modèle libéral et les craintes qu’il suscite dans une partie de la population.
À la fin des années 1990, cette contestation était menée par un certain mouvement de gauche à travers le monde, comprenant des partis politiques, des syndicalistes, des ONG, des mouvements autochtones et des mouvements sociaux. Ils militent pour une réforme d’un ordre mondial jugé injuste et au service des intérêts capitalistes d’une minorité[1]. L’échec de l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) en 1997 est une première illustration de ces luttes. Négocié au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à partir de 1995, il vise à synthétiser et harmoniser les accords bilatéraux préexistants dans ce domaine. Il est destiné à faciliter les investissements étrangers en interdisant la discrimination fondée sur la nationalité des investisseurs, mais aussi en permettant aux entreprises privées d’intenter des actions en justice contre les pays pratiquant le protectionnisme et la préférence nationale. Révélé par des mouvements citoyens américains, ce projet a suscité de vives protestations de la part des partisans de l’exceptionnalisme culturel, des écologistes et des syndicalistes, et a finalement été abandonné.
Un autre exemple est le projet de taxation des transactions financières, ou taxe Tobin, qui a conduit à la création de l’Association pour l’imposition internationale des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC). De même, en décembre 2001 à Doha, au Qatar, l’Organisation mondiale du commerce a lancé un cycle de négociations sur le commerce et le développement, qui n’a abouti à rien à ce jour. Ces trois exemples soulignent à quel point le diagnostic des limites de la mondialisation avait déjà été posé il y a plus de 20 ans et à quel point les enjeux restent très similaires aujourd’hui.
La réaction de la plupart des États aujourd’hui face à la montée de l’extrême droite est tout sauf orientée vers la réflexion ou même vers des initiatives en faveur d’un nouvel ordre mondial, ou tout au moins vers une réforme de l’ordre existant. La concurrence et la confrontation l’emportent sur la coopération. Il en résulte essentiellement des réponses politiques nationales, une attitude de chacun pour soi mêlée à une attitude assez généralisée de repli sur soi, avec un certain nombre de limites.
La réaction de la plupart des États aujourd’hui face à la montée de l’extrême droite est tout sauf orientée vers la réflexion ou même vers des initiatives en faveur d’un nouvel ordre mondial, ou tout au moins vers une réforme de l’ordre existant. La concurrence et la confrontation dominent plutôt que la coopération. Il en résulte essentiellement des réponses politiques nationales, une attitude de chacun pour soi mêlée à une attitude assez généralisée de repli sur soi, avec un certain nombre de limites. Face à des problèmes systémiques, les réponses nationales sont manifestement inefficaces : comment agir contre les émissions de gaz à effet de serre produites ailleurs, qui réchauffent inévitablement notre climat ? Comment retrouver une marge de manœuvre financière en réformant la fiscalité dans un monde concurrentiel ? Comment résoudre la question migratoire en agissant sur ses causes plutôt que sur ses conséquences ? Le niveau national ne peut que tenter de répondre aux conséquences et, à l’instar d’un pansement sur une plaie béante, il ne peut que masquer temporairement les effets du problème sans apporter de solution. En conséquence, le changement climatique s’aggrave et, avec lui, les craintes de catastrophes naturelles, terrain idéal pour les tendances populistes. Pire encore, la montée de l’extrême droite conduit souvent à des choix politiques difficiles et médiatisés au niveau national, que les dirigeants politiques jugent indispensables pour avoir une chance de remporter les élections, mais qui sont loin d’être des solutions durables et peuvent même s’avérer contre-productifs. C’est le cas, par exemple, des réponses purement quantitatives et sécuritaires au défi de la migration. Outre leur caractère inhumain, ces réponses ne contribuent en rien à endiguer les flux migratoires. Et pourtant, on estime qu’en Europe, par exemple, une gestion raisonnée et une politique migratoire ambitieuse au service de l’intérêt général européen pourraient contribuer à réduire l’écart de croissance entre l’UE et les États-Unis (le fameux « marasme européen », source de nombreuses études et rapports récents).
Le discours de l’extrême droite divise et fragmente, reflétant la polarisation et la violence croissante des situations politiques dans la plupart des pays où ces partis jouissent d’une certaine popularité, menaçant directement la stabilité des institutions démocratiques ainsi que la tendance à la fragmentation de la mondialisation. La mondialisation entre amis, telle que proposée par certains, est un facteur d’exclusion pour d’autres et ne peut que renforcer les tensions géopolitiques dans un cercle vicieux dangereux. En effet, l’isolationnisme et le protectionnisme sont des facteurs d’injustice entre les pays. Une mesure protectionniste prise par les États-Unis à l’encontre du Bangladesh n’a pas le même poids ni les mêmes conséquences que l’inverse. Les théories économiques du commerce international ont décrit avec précision ce phénomène concernant les politiques commerciales, mais nous pourrions étendre cette approche à de nombreux autres domaines : les relations de pouvoir et de force, ainsi que les capacités économiques, qui rendent les conséquences des politiques nationales très injustes.
En effet, un tarif douanier ou une subvention imposés par un grand pays modifient également les prix mondiaux. Les politiques agricoles des grands pays riches dans les années 1980 et 1990 en sont un parfait exemple : elles ont fait baisser le prix des produits agricoles sur les marchés mondiaux en raison de l’offre excédentaire qu’elles ont produite. En Europe, les prix payés aux agriculteurs européens étaient garantis par une politique agricole commune qui compensait tout écart entre ce prix garanti et celui offert par les marchés mondiaux. Cela a encouragé les agriculteurs européens à produire de plus en plus, ce qui a conduit à une surproduction qui, à son tour, a alimenté les marchés mondiaux et fait baisser les prix. Les Européens ont essayé de stocker ou de transformer ces excédents ou de mettre en place des quotas (comme dans le cas des quotas laitiers), mais le coût de cette politique était tel qu’elle a conduit à une réforme.
Néanmoins, une région aussi riche pouvait se permettre une telle politique, ce qui serait impossible et impensable pour un pays ou une région moins favorisés – et cela fournit quelques pistes initiales pour des politiques adaptées aux défis mondiaux. Bien sûr, l’Europe pouvait se permettre une telle politique agricole, mais un seul État européen aurait-il pu se le permettre ? Certainement pas, et la même conclusion pourrait être tirée pour d’autres régions ayant des initiatives régionales – loin d’être une solution idéale (l’exemple de la politique agricole commune (PAC) – la politique agricole de l’UE – en est un bon exemple), mais déjà une solution moins mauvaise que le retrait national.
Un autre risque lié aux différences de pouvoir et de ressources disponibles entre les pays est toujours illustré par la question de l’agriculture et l’impact des politiques agricoles, y compris la PAC, sur l’agriculture des pays pauvres – ces pays sont aujourd’hui, comme l’illustre tragiquement la guerre en Ukraine, terriblement vulnérables car ils dépendent largement des importations alimentaires. Il s’agit d’un phénomène assez récent, qui remonte à plusieurs décennies et qui est directement lié à l’impact des politiques agricoles des pays riches sur les marchés mondiaux. La spirale baissière des prix décrite ci-dessus, associée aux excédents commerciaux qui en ont résulté, a stimulé les importations au détriment de la production locale. C’était là le principal défi de l’accord signé à Marrakech en 1995, qui a non seulement créé l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mais a également inclus l’agriculture parmi les questions à négocier, ainsi que les aspects agricoles du cycle de Doha des négociations sur le commerce et le développement au sein de l’OMC depuis 2001.
CONCLUSION
La mondialisation a joué un rôle fondamental dans la croissance, l’innovation et l’emploi au cours des quatre dernières décennies (Rodrigues 2024). Elle a sorti des millions de personnes de la pauvreté, leur a donné accès à des biens de consommation, a permis à de nombreux pays de développer enfin leur économie et, grâce aux progrès technologiques, a produit des innovations qui facilitent ou sauvent des vies. Cependant, l’ouverture des marchés et la pression concurrentielle qu’elle entraîne, associées aux progrès technologiques, ont également contribué à la destruction d’emplois et à l’appauvrissement des travailleurs dans certains secteurs, voire dans des régions entières. Loin d’apaiser les relations internationales, elle a contribué à l’émergence de tensions géopolitiques de diverses natures et amplifié les migrations internationales, renforçant le sentiment d’incertitude et d’insécurité parmi les populations déjà précarisées par l’ouverture des marchés. Dans le même temps, le réchauffement climatique est apparu comme une menace existentielle commune. Paradoxalement, dans un monde en voie de mondialisation, tous ces facteurs ont affaibli la gouvernance internationale, menaçant l’ordre mondial et alimentant une rhétorique extrême et polarisée, qui a encore renforcé la menace qui pèse sur l’ordre mondial et la cohésion des pays et des peuples.
L’avenir d’un nouvel ordre international dépendra de la capacité de la communauté internationale, des gouvernements, des entreprises et de la société civile à répondre à ces questions et à inverser la tendance en faveur de l’extrême droite.
Pour lutter contre ce phénomène, nous devons trouver les conditions d’une nouvelle forme de gouvernance mondiale qui soit inclusive et adaptée aux défis posés. Plusieurs expériences sont en cours. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, de l’initiative de l’OCDE en faveur d’une imposition minimale des grandes entreprises, de l’accord de Paris sur le climat, de la réglementation des marchés financiers et de l’intégration européenne, mais il reste encore beaucoup à faire dans ces domaines et dans d’autres, tels que les questions migratoires, la réglementation des technologies numériques et la santé publique. Quelles actions communes ? Quelles institutions mondiales ? Quels moyens et mécanismes ? Comment restaurer la légitimité de ces institutions face à la montée de l’extrême droite ? L’avenir d’un nouvel ordre international dépendra de la capacité de la communauté internationale, des gouvernements, des entreprises et de la société civile à répondre à ces questions et à inverser la tendance face à l’extrême droite.
Notes
[1] À partir de 2001, leurs initiateurs ont présenté les Forums sociaux mondiaux comme une alternative sociale au Forum économique mondial, qui se tient chaque année à Davos depuis 1971.
Références
Abreu, M. & Ö. Öner. 2020. « Disentangling the Brexit Vote: The Role of Economic, Social and Cultural Contexts in Explaining the UK’s EU Referendum Vote » (Démêler le vote sur le Brexit : le rôle des contextes économiques, sociaux et culturels dans l’explication du vote du référendum britannique sur l’UE). Environment and Planning A: Economy and Space, 52(7) : 1434-1456. https://doi.org/10.1177/0308518X20910752.
Bava U. S. 2022. « Multilatéralisme contesté et crise de la coopération ». The Progressive Post, 24 novembre 2022. https://feps-europe.eu/contested-multilateralism-and-the-crisis-of-cooperation/.
Biancotti, Claudia, Alessandro Borin & M. Mancini. 2017. Euroscepticism: Another Brick in the Wall. Mémo, Banque d’Italie. 10.13140/RG.2.2.35326.48960.
Chodavadia, Saheel A., Sari Pekkala Kerr, William R. Kerr & Louis J. Maiden. 2024. « Entrepreneuriat des immigrants : nouvelles estimations et programme de recherche Saheel ». Bureau national de recherche économique, document de travail 32400. http://www.nber.org/papers/w32400.
Colantone, I. & Piero Stanig. 2018. « The Trade Origins of Economic Nationalism: Import Competition and Voting Behavior in Western Europe. » American Journal of Political Science, 62 (4) : 936-953. https://doi.org/10.1111/ajps.12358.
Deaton, Angus & Anne Case. 2020. Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton : Princeton University Press.
Doerr, Sebastian, S. Gissler, J. L. Peydró & H. J. Voth. 2020. « From Finance to Fascism ». Barcelona School of Economics, document de travail 1092. https://bse.eu/research/working-papers/finance-fascism.
Eatwell, R. & M. Goodwin. 2018. National Populism: The Revolt against Liberal Democracy. Londres : Pelican Books.
Friedman, Thomas L. 2005. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York : Farrar, Straus and Giroux.
Funke, Manuel, Moritz Schularick & Christoph Trebesch. 2016. « Going to Extremes: Politics after Financial Crises, 1870-2014 ». European Economic Review, 88 (C) : 227-260. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.006.
FMI. 2024. « Base de données des perspectives économiques mondiales ». Enquêtes économiques et financières mondiales. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April.
Ikenberry, G. J. 2018. « The End of Liberal International Order? » International Affairs, 94 (1) : 7-23. https://doi.org/10.1093/ia/iix241.
Kirka, Danica. 2024. « What’s Behind the Anti-Immigrant Violence that Has Exploded across Britain? Voici un aperçu. » AP News, 5 août 2024. https://apnews.com/article/britain-riots-unrest-social-media-misinformation-attack-5824d3136675e10d6a25c9e17287c994.
Krugman, Paul. 1996. Pop Internationalism. Cambridge : The MIT Press. https://mitpress.mit.edu/9780262611336/pop-internationalism/.
Krugman, Paul. 2016. « Trade and Jobs: A Note ». The New York Times, 3 juillet 2016. https://archive.nytimes.com/krugman.blogs.nytimes.com/2016/07/03/trade-and-jobs-a-note/.
Lucassen, G. & M. Lubbers. 2011. « Who Fears What? Explaining Far-Right-Wing Preference in Europe by Distinguishing Perceived Cultural and Economic Ethnic Threats ». Comparative Political Studies, 45 (5) : 547-574. https://doi.org/10.1177/0010414011427851.
Margalit, Yotam. 2019. « L’insécurité économique et les causes du populisme, reconsidérées ». Journal of Economic Perspectives, 33 (4) : 152-170. https://www.jstor.org/stable/26796840.
Rodrigues, Maria João. 2024. « A New Global Deal, Reforming World Governance ». Fondation européenne d’études progressistes (FEPS). https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/2024/04/A-New-Global-Deal.pdf.
Rodrik, Dani. 1998. « Has Globalization Gone Too Far? » (La mondialisation est-elle allée trop loin ?) Challenge, 41 (2) : 81-94. https://doi.org/10.1080/05775132.1998.11472025.
Rodrik, Dani. 2021. « Why Does Globalization Fuel Populism? Économie, culture et montée du populisme de droite ». Annual Review of Economics, 13 (1) : 133-170. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-070220-032416.
Salgado, Susana & Yannis Stavrakakis. 2019. « Introduction : discours populistes et communication politique en Europe du Sud ». European Political Science, 18 (1) : 1-10. https://doi.org/10.1057/s41304-017-0139-2.
Streeck, Wolfgang. 2014. Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Londres : Verso Book.
Worth, Owen. 2017. « Globalization and the “Far-right” Turn in International Affairs ». Irish Studies in International Affairs 28 (1) : 19-28. https://doi.org/10.3318/isia.2017.28.8.