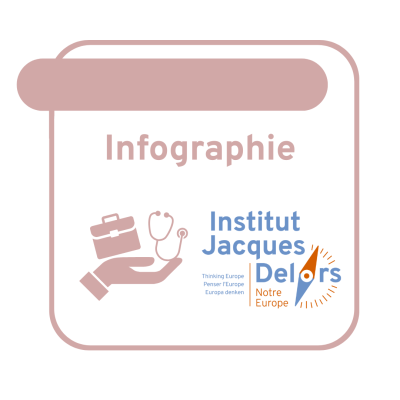Face au Coronavirus: l’indispensable incarnation politique de la solidarité européenne

« Le climat qui semble régner entre les chefs d’État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l’Union européenne », a alerté Jacques Delors dans une rare prise de parole publique au cœur de la crise du coronavirus sévissant durement en Europe. Ce manque de solidarité a déjà marqué les opinions, en particulier en Italie, tout comme les divisions étalées lors du dernier Conseil européen.
L’étendue de la crise sanitaire et la grave récession économique que vont entraîner les mesures draconiennes prises pour enrayer la pandémie exigent au contraire en réponse un sursaut collectif des dirigeants européens, avec la solidarité pour étendard.Bien que péniblement conclu, l’accord à l’Eurogroupe est un premier encouragement. Mais la solidarité ne doit pas résulter que de de laborieux calculs et de compromis techniques. Elle est un fondement de la construction européenne qui, à l’appui de sa traduction sanitaire et budgétaire, appelle une incarnation politique à la hauteur des circonstances historiques à surmonter. Comme l’a reconnu Angela Merkel, « l’Union européenne fait face à sa plus grande mise à l’épreuve depuis sa fondation ».
Cette épreuve exige une solidarité qui sous-tend la construction européenne depuis ses premiers pas. La Déclaration Schuman, dont le 9 mai prochain marquera le 70ème anniversaire, appelait à des « réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». Le concept même de « Communauté » signifie à la fois des échanges ouverts et confiants entre ses membres, la mise en commun de moyens et l’entraide en son sein. La substitution de l’Union aux Communautés n’a rien retiré à cette triple dynamique du projet européen qu’a résumé Jacques Delors selon sa fameuse formule : «La concurrence qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit».
Sur le fond, cette solidarité trouve son origine dans « le patrimoine spirituel et moral » auquel l’UE fait référence dans le préambule de sa Charte des droits fondamentaux. Mais elle s’est développée en raison de l’interdépendance et des intérêts liés à la préservation du projet européen et de ses biens communs, que représentent aujourd’hui notamment le marché intérieur et l’euro. Cette assistance mutuelle intéressée rend d’autant plus évidente une solidarité européenne, sans lui retirer tout motif émotionnel et fondement altruiste.
Pour permettre et garantir sa mise en œuvre, la solidarité européenne s’appuie sur des bases juridiques établies ainsi que divers mécanismes, fonds et programmes financés par le budget européen. Depuis une vingtaine d’années, de nouveaux instruments spécifiques à l’UE, créés explicitement au nom de la solidarité, l’ont plus encore instituée : « clause de solidarité », « fonds de solidarité de l’Union européenne » ou plus récemment « Corps européen de solidarité ».
Malgré un large éventail de types et d’échelles d’interventions, la mise en pratique de la solidarité européenne est limitée en matière sanitaire. D’abord, son étendue dépend du champ de compétences de l’UE qui les exercent entièrement, en partage ou en appui avec les États membres, en vertu du principe de subsidiarité. Il a été rappelé depuis le début de l’épidémie de Covid-19 que la compétence européenne dans le domaine de la santé publique n’était que d’appui. Les institutions européennes ne disposent pas directement des équipes, ni des équipements pour intervenir dans l’urgence. Néanmoins, ceci n’a pas empêché la Banque centrale européenne d’agir et la Commission de trouver les bases juridiques pour prendre maintes initiatives afin de secourir des États et citoyens en détresse.
À défaut de compétences directes, la solidarité européenne peut s’exercer indirectement autrement. Ainsi en assouplissant ou en suspendant temporairement plusieurs dispositifs du jeu normal de la concurrence sur le marché européen (aides d’État) et de l’encadrement budgétaire (Pacte de stabilité), la Commission a facilité le recours des États à leurs instruments nationaux de solidarité. Celle-ci s’accomplit ainsi en creux au niveau européen.
Mais lorsque l’épreuve devient collective aux Vingt-Sept et d’ampleur inédite depuis la Seconde guerre mondiale, la solidarité européenne doit se montrer au grand jour. Malmenée au fil des crises des dix dernières années (1), cette solidarité exige aujourd’hui à la fois d’être officiellement activée (2), une impulsion franco-allemande (3), une figure incarnant le combat commun qui comble le déficit de leadership et d’incarnation européen actuel (4), une stratégie géopolitique et de communication internationale (5). Celle-ci est incontournable dans une crise qui donne lieu jusqu’ici, au contraire, à un « EU-bashing » dangereux pour l’avenir du projet européen.