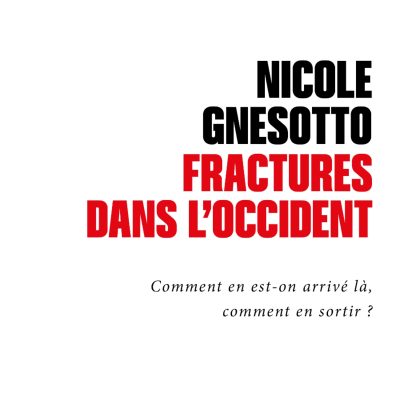L’Union européenne face aux populismes

Plusieurs élections récentes ont remis sur le devant de la scène la question du populisme en Europe. Les élections cantonales françaises de mars 2011 ont ainsi ramené le Front national à un niveau comparable à celui des années 1990 et du début des années 2000 (autour de 15%), tandis que les élections législatives en Finlande d’avril 2011 portaient le parti des « Vrais Finlandais » à la troisième position avec 19% des suffrages. Avant elles, l’arrivée du parti de Geert Wilders dans la coalition gouvernementale néerlandaise (son Parti de la Liberté constituant désormais la troisième force politique du pays avec 24 sièges), comme le score important obtenu par le Parti des Démocrates suédois aux élections législatives (5,7% des suffrages et 20 sièges pour la première fois), avaient déjà ranimé des débats et des controverses autour de ce phénomène politique particulier qu’est le populisme et donné à son extension un véritable cadre européen.
Ces débats sont certes récurrents depuis les succès du FPÖ dans les années 2000 en Autriche, qui avaient conduit plusieurs États-membres de l’Union européenne à se prononcer en faveur de mesures « disciplinaires » à l’encontre du gouvernement autrichien de l’époque. Plus qu’une condamnation formelle des instances communautaires, les « sanctions » alors adoptées portaient essentiellement sur la suspension des relations bilatérales officielles entre l’Autriche et les 14 États-membres et reposaient sur la volonté plus ou moins explicite d’affirmer une certaine unité de valeurs et de sauvegarder « l’esprit » de la démocratie en Europe. La « crise autrichienne » eut quelques conséquences institutionnelles, qui seront évoquées plus loin, mais elle marque surtout, avec le recul, la première réaction collective à un phénomène qui était alors « localisé » dans certains pays, avant de devenir une « pathologie » commune aux systèmes politiques nationaux.