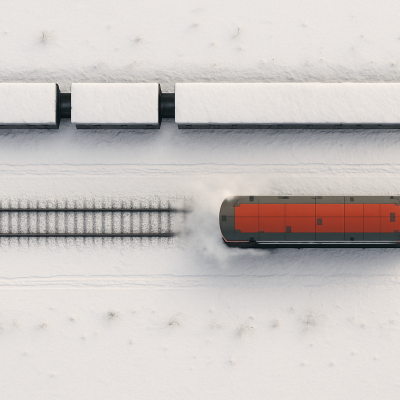Pacte vert européen, suite ou fin?
Vers un détricotage de l’ambition climatique suite aux élections européennes ?

La transition écologique pure et parfaite n’existe pas. Elle a été, est et sera la résultante d’un rapport de force politique. En ce sens, l’équilibre politique qui découlera des élections européennes du 9 juin déterminera une grande partie de l’ambition climatique de l’Union européenne pour les prochaines années.
Ces cinq dernières années, ce rapport de force s’est exercé dans le cadre des négociations relatives au Pacte vert européen. En se dotant d’objectifs extrêmement ambitieux dans les secteurs des transports, de l’industrie, de la production d’énergie, des bâtiments, l’UE s’est fixée un cap d’ici à la fin de la décennie. Cap qu’il conviendra de maintenir et ce, alors que l’extrême droite appelle à revenir en arrière afin de détricoter ce nouvel acquis communautaire vert. Or, contrairement à ce que prétendent ces promesses électoralistes, une analyse des clauses de revoyure contenues dans les principaux dossiers du Pacte vert (FitFor55) conduit à la conclusion suivante : la faisabilité juridique d’un détricotage total de l’ambition climatique contenue dans le Pacte vert européen n’est pas démontrée, en plus d’être irréalisable politiquement parlant. Juridiquement, puisque ces clauses de réexamen octroient un pouvoir d’initiative discrétionnaire à la Commission européenne pour rouvrir un dossier et que les droites conservatrices et radicales ne disposent d’aucun moyen légal permettant de contraindre la Commission. Politiquement, puisque le Rassemblement National (RN) et ses alliés seront dans l’incapacité d’exercer une pression politique quelconque sur la Commission européenne dès lors qu’il est exclu que leur groupe politique au Parlement européen participe à un accord de coalition concernant l’élection du futur Président de la Commission européenne.
Néanmoins, certains dossiers pourraient tout de même être rouverts sous pression des États membres. Pression sur laquelle le RN n’aura aucune prise puisqu’il n’est pas au pouvoir en France. En ce sens, les récentes négociations autours de la loi sur la nature et la restauration témoigne des divisions croissantes entre, mais également au sein même des institutions européennes et préfigurent ce à quoi pourrait conduire une percée de ces droites hostiles au Pacte vert. En cas de réouverture d’un dossier, des majorités ad hoc, à savoir texte par texte, pourraient se former, afin de diminuer de l’ambition climatique. Elles regrouperaient les forces de droite du Parti Populaire Européen (PPE), Conservateurs et Réformistes Européens (ECR) et Identité et Démocratie (ID) mais également une fraction potentielle des libéraux (Renew) et certains sociaux-démocrates (S&D). En effet, une droitisation du Parlement européen pourrait renforcer une tendance de fond qui conduirait à déplacer le curseur politique vers la droite à l’intérieur même des groupes politiques européens. Tendance inquiétante puisque, du fait de la nature systémique du Pacte vert, la diminution de l’ambition sur un dossier (fin de vente du véhicule thermique neuf en 2035 par exemple) pourrait entrainer des réactions en chaîne sur d’autres dossiers (règlement sur les bornes de recharges, directive énergies renouvelables).
Afin d’éviter la survenance d’un tel scénario, nous recommandons la formation d’une « grande coalition élargie », comprenant PPE-S&D-Renew et les Verts européens. En conditionnant son soutien à l’obtention de garanties concernant les objectifs définis dans le Pacte vert, les Verts européens contribueraient à sauvegarder l’ambition climatique européenne. De son côté, le PPE verrait sa candidate officielle être approuvée, résultat qui ne serait pas garanti en cas d’alliance d’Ursula von der Leyen avec la Première ministre italienne Meloni (ECR) dès lors que les S&D et Renew pourraient ne pas vouloir soutenir un tel glissement vers la droite.
Enfin, une victoire des droites européennes ferait également courir le risque que les familles et dirigeants politiques européens amalgament la défiance vis-à-vis de certaines politiques environnementales (cf. colère des agriculteurs) en une défiance plus générale vis-à-vis de la politique climatique, avec une conséquence : retarder la mise en oeuvre du Pacte vert au niveau national. Les élections européennes et les négociations qui s’en suivront doivent donc permettre d’octroyer une légitimité démocratique renouvelée au Pacte vert européen, en interrogeant quant aux moyens financiers à mobiliser dans le cadre de son déploiement, mais également la suite à lui donner. Puisqu’inachevé (partie agricole, alimentaire, biodiversité), ce n’est donc pas la question d’un « Pacte vert 2.0 » mais celle de son devenir qui se pose. Elle implique une logique de transformation, d’évolution, vers une dimension plus large, plutôt que de penser à une potentielle seconde itération du Pacte vert. Ce devenir doit être en lien avec l’économie (compétitivité), l’autonomie stratégique (sécurité) comme ont commencé à l’esquisser les chefs d’État et de gouvernement durant les discussions relatives au futur agenda stratégique européen, mais ne devra pas faire l’impasse sur la question sociale. Par ailleurs, ces discussions ne devront pas conduire à invisibiliser le Pacte vert européen ou diluer la lutte contre le changement climatique dans un ensemble plus grand, sous peine de réintroduire la logique éculée du « trilemme énergétique » : de la capacité à ne plus simplement faire cohabiter mais rimer durabilité, compétitivité et sécurité dépendra la réussite de la transition énergétique européenne.