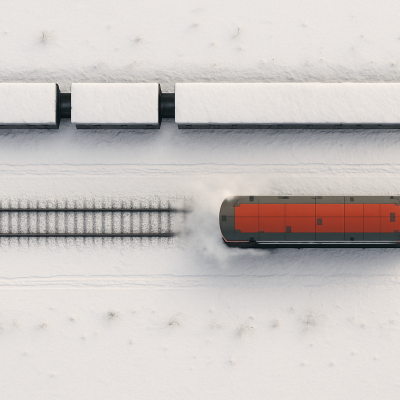Pacte vert: vers une pause réglementaire massive?

En 2019, Ursula von der Leyen faisait du Pacte vert européen la « nouvelle stratégie de croissance » de l’Union européenne (UE). En 2025, la boussole pour la compétitivité devant faire de la Commission européenne une Commission « de croissance et d’investissements » se retrouve pourtant dépourvue de toute mention explicite au Pacte vert. Relégué et second plan et attaqué de toute part en Europe, ce dernier semble plus que jamais remis en cause.
Moteur dans la promotion d’un objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030, ainsi que durant les négociations législatives afférentes tenues sous sa Présidence du Conseil de l’UE, la France serait légitime pour le défendre. Pourtant, les récentes déclarations de ses dirigeants politiques laissent craindre le contraire.
Simplification, dérégulation ou suspension?
En mai 2023, Emmanuel Macron appelait de ses vœux une « pause réglementaire européenne » sur les normes environnementales. Ce qui s’apparentait alors à une indétermination doctrinale quant aux réponses à apporter à la rhétorique critique de l’extrême droite européenne apparait désormais comme le signe avant-coureur de velléités dérégulatoires. Car depuis, le Président a précisé ses propos, et évoque le besoin de faire une « pause réglementaire massive [pour] revenir sur des réglementations, y compris récentes, qui entravent notre capacité à innover ».
Ainsi, plusieurs ministres ont récemment interpelé la Commission européenne afin de suspendre les potentielles amendes qui pourraient toucher le secteur automobile pour non-respect des objectifs d’émissions de CO2 des voitures en 2025. Pourtant, la survenance de pénalités, hypothétique et surestimée, relève avant tout d’une procrastination coupable de certains constructeurs automobiles, couplée à une insuffisante politique de stimulation de la demande.
Autre requête, celle de repousser de deux ans la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), mais surtout de « retarder indéfiniment » l’application de la nouvelle directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD). En plus d’être contradictoire avec le fait que ce dossier avait été initialement poussé par la France, une telle demande a pour effet de faire le jeu de l’extrême droite. En donnant corps aux propositions du Rassemblement National pour les européennes, l’exécutif concours à légitimer un tel discours, et cède un peu plus de terrain aux forces populistes qui instrumentalisent les politiques climatiques à des fins électorales.
Pourtant le discours relatif à la simplification est tout à fait légitime, à condition de ne pas être dévoyé. Pour être opérante, la simplification devra reposer sur un inventaire, suivi d’une évaluation détaillée de la raison d’être initiale des règles jugées trop contraignantes. Elle devra s’accompagner d’un examen minutieux permettant d’identifier l’origine du problème: normes européennes trop lourdes ou complexes, phénomène de sur-transposition ou superposition, règles à actualiser du fait de l’évolution du contexte. C’est en édictant dès à présent des garde-fous que l’on pourra s’assurer que la politique de simplification ne conduise pas à une dérégulation tout azimut.
Enfin, il ne faut pas croire qu’une simplification des règles réglera à elle seule nos problèmes de compétitivité. Malgré des économies potentielles pour les entreprises estimées à 37 mds€ par an d’ici la fin du mandat, cela reste peu comparé aux 800 mds€ annuels que le rapport Draghi préconise d’investir. Or sur ce sujet, l’Europe n’a pas le luxe d’une « pause ».