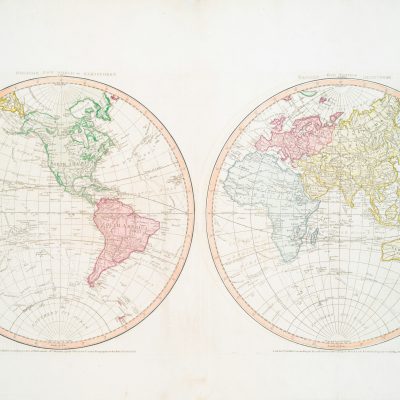Repenser la relation UE/ Afrique face aux désordres du monde

Deux mois après l’arrivée de la nouvelle administration américaine, la bascule vers un nouvel ordre international, aux contours encore incertains, ne se discute déjà plus. Le mouvement, amorcé depuis de nombreuses années, s’est violemment accéléré : son déploiement simultané sur plusieurs fronts – guerre commerciale, conflit israélo-palestinien, guerre en Ukraine, peut-être bientôt Panama, Groenland – et l’alternance de l’un à l’autre a été près de submerger la capacité d’initiative des pays européens.
Ces derniers sont dans une situation où ils ne peuvent, pour l’instant, que réagir aux évènements qu’ils subissent, jusque sur leur propre continent, à la frontière ukrainienne. Or, il est une autre frontière où des enjeux essentiels sont en train d’être escamotés par cet effet de submersion : celle avec l’Afrique, l’autre voisin immédiat de l’Europe. Il est cependant encore temps de déployer des dynamiques qui permettront de garder l’initiative, d’agir plutôt que de subir.
Cela suppose, comme condition première, de redéfinir ce qu’est avant tout la relation de l’UE avec l’Afrique. Depuis 20 ans, la vision s’est progressivement restreinte aux problématiques d’aide au développement pendant que la position européenne reculait dans tous les domaines, qu’ils soient diplomatiques, sécuritaires ou, économiques. Il est temps de reconnaître la relation pour ce qu’elle est : essentielle et stratégique, au même titre que celle avec la Chine ou le Moyen Orient. Il faut ensuite construire une vision européenne unifiée et non pas fragmentée en fonction des intérêts – ou désintérêts – particuliers de ses pays membres. Les enjeux sont globaux : de la même manière que les effets de la déflagration en Ukraine ne s’arrêtent pas à la Pologne, il ne faut pas imaginer que ceux de la crise sahélienne pourraient s’arrêter à l’Espagne, la France ou l’Italie. La possibilité qu’offre le continent en termes de diversification des sources d’approvisionnements en gaz ou en métaux critiques répond à des problématiques de souveraineté européenne. Idem en ce qui concerne le développement de relations commerciales équilibrées avec un voisin qui représente 1,5 milliards d’habitants. L’approche qui a consisté à développer une semi-concurrence intra-européenne qui ne dit pas son nom dans des domaines comme la fiscalité, les coûts de l’énergie et, de manière plus criante que jamais, la défense, a montré ses limites.
Concrètement, la première question qui se pose est « par où commencer ? » L’urgence consiste à adresser, afin que cesse l’érosion constante de la position européenne sur le continent, la problématique du financement : les besoins sont bien entendu colossaux – on considère que dans le seul domaine de infrastructures le gap de financement annuel est de plus 100 milliards de dollars. Or, cela fait quinze ans que la responsabilité du financement européen, qui était réparti entre les banques commerciales et les banques de développement, a été quasi entièrement reportée sur les banques de développement. Sans rentrer dans les causes de cette évolution car elles sont multiples – réglementaires, conditions de marché, perception du risque – l’échelle des enjeux indique qu’il n’est pas possible de demander aux banques de développement et au secteur public de couvrir des besoins pour lesquels ils n’ont jamais été taillés et qui seront toujours au-delà de leurs capacités. La situation ne pourra donc se débloquer qu’en ramenant des flux de financement privés dans le circuit.
Pour cela, il s’agit de démultiplier la capacité de financement disponible grâce à une action conjointe du public et du privé, qui se sont éloignés pendant trop longtemps – contrairement aux systèmes chinois et américains où ils avancent de pair, les premiers à travers leurs banques et sociétés étatiques, les seconds par la coordination des différents acteurs. En Europe l’expérience incomparable cumulée pendant des décennies par les banques de développement, doit être utilisée pour rassurer le secteur privé, tout en mobilisant le régulateur. En appréhendant précisément les contraintes spécifiques auxquels les investisseurs financiers sont soumis en termes de réglementation, de gestion de risques et d’objectifs de rendements, il sera possible de définir des solutions répondant à leurs problématiques, et de réconcilier le meilleur des deux mondes au travers de partenariats public-privés.
Il est encore temps mais la situation devient là-aussi terriblement pressante : les États- Unis ont retiré une immense partie des budgets des programmes d’aides de leur agence USAID (c’était, rappelons-le, le premier des donateurs), les budgets européens sont contraints, et les priorités vont aller au financement de la défense et à la reconstruction de l’Ukraine – le Royaume Uni a déjà annoncé une redirection d’une partie du budget de l’aide vers la défense. Depuis 20 ans les pays africains n’ont cessé de diversifier leurs partenariats – bien au-delà de l’exemple habituel de la Chine – au fur et à mesure que le poids du continent grandissait sur la scène internationale. L’UE peut choisir de s’inscrire à nouveau dans cette dynamique. Dans le cas contraire, elle devra subir les prochains chocs.