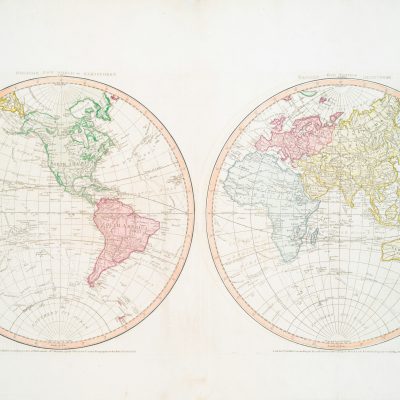UE, indulgence nécessaire, ambition indispensable

Nombre d’observateurs s’étonnent, ironisent ou se désespèrent face aux difficultés de l’Union européenne à jouer un rôle décisif dans la crise ukrainienne. Je pèche parfois moi aussi par excès d’impatience. Or on n’insistera jamais assez sur la révolution stratégique radicale – historique, colossale – qui bouleverse désormais l’UE. Il faut en prendre l’exacte mesure avant de sombrer dans des jugements plus négatifs les uns que les autres.
Cette révolution stratégique se nourrit d’au moins trois facteurs, que j’analyse dans mon dernier essai « Fractures dans l’Occident [1]».
Le premier est historique. Rappelons-nous. En 1950, lors de la création de la CECA, la construction européenne s’était vue attribuer trois interdits : ne plus penser ni faire la guerre ; avoir totalement confiance dans l’Amérique pour se défendre ; faire du commerce pour s’enrichir et pacifier les partenaires voisins. Ces trois règles ont permis à l’Europe de se construire et de prospérer avec un succès phénoménal. Or, après huit décennies de ce régime, les Européens sont tout à coup sommés de faire exactement l’inverse : penser la guerre et la géopolitique et se réarmer ; se méfier de l’inconstance américaine et viser l’autonomie stratégique ; revoir les règles du commerce mondial vers moins de liberté et d’ouverture. Autrement dit, pour survivre, ils doivent transformer les vieux interdits en règles d’action, les tabous en vertus, et le tout en trois ans. On serait perdu, confus, indécis et impuissant à moins !
Le deuxième facteur est stratégique. Pour la première fois dans l’histoire de l’Alliance atlantique, une menace contre l’Europe n’est plus perçue par l’Amérique comme une égale menace. La communauté de destin euro-atlantique a en effet disparu : Donald Trump n’a pas peur de la Russie, alors que les Européens s’inquiètent tous les jours un peu plus de l’agressivité de Vladimir Poutine. C’est ce différentiel inouï dans la perception de la menace qui accroit la dépendance désespérée de l’UE vis-à-vis des Etats-Unis : pour les convaincre de rester notre allié et notre défenseur, les Européens doivent faire beaucoup plus d’efforts et de concessions à l’égard de Washington que lorsque la menace était commune à toute l’Alliance.
Le troisième facteur qui nourrit la révolution de l’ordre européen réside au sein de l’Amérique elle-même. Donald Trump n’est pas seulement un protecteur velléitaire, imprévisible, voire dangereux : rien n’interdit de penser que sa désinvolture à l’égard de l’Ukraine et de l’Otan pourrait le conduire à une trahison stratégique des Européens. Mais la difficulté vient aussi du fait qu’il est porteur d’une véritable contre-révolution politique, hostile à la démocratie elle-même, qui amène certains de ses collaborateurs à soutenir ouvertement le pire de l’extrême droite autoritaire en Europe. Autrement dit, Donald Trump représente pour nous une double menace, de trahison stratégique et politique, au moment même où la menace militaire à l’Est, d’agression et de subversion russe, se renforce. Cette coïncidence de deux menaces, à l’Ouest et à l’Est, est également une première pour les Européens. Elle les confronte à un dilemme difficile : comment défendre nos démocraties contre une possible agression russe, sachant que notre protecteur militaire historique est aussi devenu un adversaire de la démocratie ?
Dans la réalité toutefois, pour une majorité d’Européens, Poutine apparait nettement plus dangereux que Trump, parce que la guerre est effectivement une issue tragique qu’il faut éviter à tout prix. Répondre à la menace russe constitue donc pour l’UE une priorité, à la fois militaire, budgétaire, industrielle et surtout atlantique : il faut absolument garder Washington impliqué dans la protection et la défense de l’Europe, quitte à avaler toutes les couleuvres que les Etats-Unis voudront bien nous imposer pour rester. C’est là que le bât blesse : défendre la démocratie ne devrait pas être un objectif secondaire, car c’est très exactement le but défini dans le préambule du traité de l’Otan. Autrement dit, tout autant qu’ils s’organisent pour leur défense à l’Est, les Européens devraient s’interroger sérieusement sur ce qui mine, aux Etats-Unis et à l’intérieur de leurs propres sociétés, le sentiment démocratique : répondre au populisme qui s’épanouit partout, en s’interrogeant sur le désarroi des classes moyennes européennes tentées par d’autres solutions, autoritaires ou violentes. Que cela plaise ou non, ce malaise démocratique a largement à voir avec l’explosion des inégalités sociales dans nos pays riches. Y répondre doit être l’ambition politique majeure, tout autant que la réponse stratégique à la Russie. Dissuader la menace russe, démonter l’illusion illibérale : telles sont les deux seules voies possibles, et nécessaires, pour la survie et sans doute la victoire de l’Europe.
[1] Fractures dans l’Occident, comment en est-on arrivé là, comment en sortir, Odile Jacob, Octobre 2025