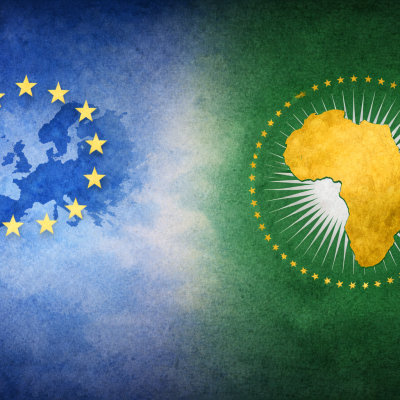Union économique et monétaire: passé et présent

L’Institut Jacques Delors, en collaboration avec l’Institut Jacques Delors – Berlin, la Hertie School of Governance et la Fondation Bertelsmann, a organisé la conférence « Making Europe’s Economic Union Work » (Faire fonctionner l’Union économique européenne), en présence de grandes personnalités européennes, dont Mario Draghi et Enrico Letta. À cette occasion, Mario Draghi, président de la BCE, a prononcé un discours.
Il est aujourd’hui essentiel de faire avancer le débat sur l’intégration européenne, et les conférences telles que celle-ci constituent des forums clés pour y parvenir. Il est essentiel de favoriser une discussion ouverte et franche sur notre avenir commun afin de développer les connaissances et de parvenir à un consensus.
C’est précisément grâce à sa vision, à son analyse rigoureuse et à ses discussions franches que Jacques Delors a pu surmonter les défis économiques de son époque et ce qu’il décrivait comme les « divergences d’opinion fondamentales » et les « réserves mentales » qui caractérisaient le climat politique de l’époque.
Aujourd’hui, nous sommes également confrontés à des défis économiques et à des différends politiques concernant l’avenir de l’intégration européenne. Il est donc utile de revenir sur l’évolution de l’intégration européenne dans les années 1980 et d’en tirer les enseignements.
La stratégie élaborée par Jacques Delors, Helmut Kohl, François Mitterrand, Italo Andreotti et d’autres dirigeants de l’UE reposait sur trois éléments : premièrement, libérer le potentiel de l’intégration européenne en la concentrant sur des défis communs pour lesquels l’UE pouvait clairement apporter son aide ; deuxièmement, reconnaître que l’intégration dans un domaine crée une interdépendance avec d’autres domaines ; et troisièmement, doter l’UE des outils et des institutions nécessaires pour gérer cette interdépendance et garantir la stabilité et la convergence.
Ces trois éléments devraient également nous guider aujourd’hui dans la conception et la mise en œuvre des réformes nécessaires à l’Union économique et monétaire (UEM).
Le programme du marché unique
Au milieu des années 1980, l’économie européenne sortait tout juste d’une décennie turbulente marquée par la récession et une faible croissance économique.
Le chômage dans la Communauté européenne n’avait cessé d’augmenter, passant de 5,8 % en 1980 à 11,2 % en 1985. Le taux de croissance potentiel de l’Europe était passé d’environ 5 % par an dans les années 70 à environ 2 % par an au cours de la décennie suivante.
L’environnement international devenait également moins favorable. La politique américaine en matière de défense, de relations extérieures et d’économie évoluait rapidement sous la direction du président Reagan, nouvellement élu. Des différends commerciaux avaient éclaté outre-Atlantique et la part des importations américaines soumise à des restrictions commerciales était passée de 8 % en 1975 à 21 % en 1984.
La confiance dans la poursuite d’un projet européen plus approfondi était faible. Au début des années 1980, seule une personne sur quatre se disait intéressée par les affaires européennes et seule la moitié environ des Européens considérait l’adhésion de leur pays à l’UE comme « une bonne chose ». Le processus d’intégration était au point mort et « l’Europe semblait manquer de confiance en elle-même », comme l’affirmait alors Jacques Delors.
Les dirigeants européens de l’époque comprenaient toutefois que la faible croissance était en fait un défi commun et que l’UE disposait d’un outil puissant pour y faire face : le marché commun. Ils ont également pris conscience que toute nouvelle ouverture commerciale devait s’accompagner de mesures garantissant son équité.
La croissance du commerce intra-UE était au point mort depuis le début des années 1970, en grande partie parce que le marché commun couvrait principalement des biens intermédiaires dont le potentiel de croissance était déjà saturé. La transformation du marché commun en un marché unique pouvait toutefois ouvrir le commerce dans des secteurs à forte intensité de R&D et de compétences et redynamiser les retombées en matière de productivité.
La création d’un marché unique impliquait la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, telles que les différences entre les règles d’octroi de licences et les normes techniques, qui limitaient les échanges commerciaux et les flux de capitaux entre les pays. Elle impliquait également la mise en place de règles communes qui seraient appliquées par une autorité de concurrence unique, afin que toutes les parties présentes sur le marché soient traitées de manière équitable.
Mais pour que le marché unique soit viable à long terme, l’ouverture des marchés et l’application des règles ne suffisaient pas. Il fallait tenir compte de l’interdépendance avec d’autres domaines politiques et doter l’UE des outils et des institutions nécessaires pour garantir la stabilité et la convergence.
Premièrement, pour préserver l’intégrité du marché unique, ni les taux de change fixes ni les taux de change flexibles n’étaient considérés comme une option viable à long terme.
Dans le cadre d’un régime de taux de change flexibles, les pays perdant des parts de marché pouvaient se livrer à des dévaluations compétitives, ce qui encourageait les autres pays à prendre des mesures de rétorsion et sapait la confiance entre les États membres. Les régimes de taux de change fixes se sont quant à eux révélés vulnérables, comme l’a démontré la crise du MCE qui a éclaté quelques années plus tard.
L’intégration économique et financière devait donc s’accompagner d’une avancée proportionnelle en matière d’intégration monétaire – un marché unique avec une monnaie unique –, qui a abouti à la décision de créer l’euro et l’Eurosystème.
Deuxièmement, il était bien compris que l’ouverture des marchés pouvait parfois pénaliser les producteurs locaux, tout en créant des effets de conglomération lorsque les industries migraient vers les régions les plus compétitives. Cela pouvait conduire à une répartition inégale des avantages de l’intégration, qui devait être compensée par des instruments garantissant l’équité et la convergence.
La mise en place de mécanismes au niveau européen pour répondre à ces besoins faisait donc partie intégrante du marché unique.
Le renforcement de l’application des règles de concurrence s’est accompagné d’une protection accrue des producteurs locaux, notamment par l’extension de la protection des indications géographiques pour certains produits alimentaires. Le budget de l’UE a été augmenté et les dépenses ont été rééquilibrées, passant de l’agriculture à la convergence et à la cohésion.
Plus précisément, des fonds ciblés ont été alloués pour promouvoir l’ajustement dans les régions moins développées ou souffrant des effets de la libéralisation des échanges. En 1992, la part du budget consacrée aux fonds structurels est passée de 17 % des dépenses de l’UE à plus de 25 %.
Dans l’ensemble, il s’agissait d’une stratégie ambitieuse et visionnaire, dont la mise en œuvre a nécessité un courage politique considérable. Et dans l’ensemble, elle a fonctionné.
En 1988, deux ans après le lancement de l’Acte unique européen, la croissance du commerce intracommunautaire avait déjà retrouvé son niveau du début des années 1970, et en 1990, le taux de croissance potentiel du PIB de l’UE avait augmenté d’un point de pourcentage pour atteindre 3 % par an. Grâce à l’intégration économique, les estimations suggèrent qu’après dix ans d’adhésion à l’UE, le revenu par habitant d’un pays est en moyenne 10 % plus élevé que s’il était resté en dehors de l’Union.
En conséquence, le marché unique est devenu de plus en plus populaire : la libre circulation des biens, des personnes et des services est régulièrement considérée par le public comme l’un des résultats les plus positifs de l’UE, après la paix entre les États membres. Cela reste le cas aujourd’hui.
La leçon à en tirer est claire : lorsque l’Europe se concentre sur des défis communs, lorsqu’elle reconnaît l’interdépendance et lorsqu’elle réagit avec des institutions appropriées, elle réussit ; lorsque l’intégration n’est pas accompagnée d’équité, elle échoue.
Les domaines dans lesquels l’UEM a le plus sous-performé au cours des dernières décennies sont ceux qui ont été laissés en suspens dans les années 1980 et 1990, tels que les cadres pour les politiques budgétaires et la surveillance bancaire. Delors était profondément préoccupé par le fait que les institutions chargées de la coordination des politiques budgétaires étaient trop faibles pour une union monétaire. D’autres ont très tôt compris qu’une monnaie unique nécessiterait un système de surveillance bancaire commun
. Nous savons que ces lacunes dans le cadre ont finalement contribué à l’accumulation de déséquilibres et ont joué un rôle dans la crise de la zone euro. Mais ce ne sont pas le marché unique et la monnaie unique qui ont produit cette situation. C’est l’incapacité à appliquer dans tous les domaines la formule qui avait fonctionné dans ces domaines.
Le rôle de l’Europe aujourd’hui
Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui en Europe sont à bien des égards similaires à ceux de l’époque de Delors. Nous sortons également d’une profonde récession qui a laissé des traces durables sur l’économie et la société. L’environnement international se caractérise par une incertitude croissante. Et certains se demandent si l’intégration européenne reste la réponse à nos problèmes communs.
La croissance potentielle a ralenti par rapport à d’autres économies avancées et devrait rester faible pendant un certain temps.
Tout comme dans les années 1980, bon nombre de nos défis trouvent leur origine dans cette faible croissance. La faible croissance exacerbe les pressions sur les finances publiques, aggrave le chômage, en particulier chez les jeunes et les personnes peu qualifiées, accentue les questions de répartition liées à l’ouverture des marchés et crée une fausse perception parmi le public selon laquelle le protectionnisme est une solution.
L’Europe peut-elle donc à nouveau fournir les clés pour changer notre trajectoire de croissance ? La réponse est oui, mais seulement si nous transférons intégralement la stratégie qui a fonctionné dans le passé. Il s’agit de se concentrer clairement sur les domaines dans lesquels l’Europe peut apporter une valeur ajoutée et d’accorder une attention rigoureuse à la cohérence des politiques.
Le domaine le plus important dans lequel l’Europe peut contribuer positivement à la croissance reste le marché unique.
La plupart des pays de la zone euro ont des sociétés vieillissantes, ce qui signifie que l’amélioration du niveau de vie dépendra de plus en plus d’une croissance plus forte de la productivité. Or, la croissance de la productivité stagne depuis un certain temps dans la zone euro. Le marché unique est l’un des outils les plus puissants dont nous disposons pour débloquer les mécanismes qui permettront d’accroître la productivité.
La croissance de la productivité passe par deux canaux : l’innovation et la diffusion des nouvelles technologies. L’Europe compte des entreprises innovantes qui soutiennent largement la comparaison avec leurs homologues internationales. Mais les innovations ne se diffusent pas assez rapidement vers les autres entreprises, ce qui pèse sur la productivité de l’économie dans son ensemble.
Les 10 % d’entreprises les plus performantes sont en moyenne trois fois plus productives que les 10 % les moins performantes. Et le secteur où l’écart est le plus important est celui des services.
Dans ce contexte, la promotion du programme du marché unique peut aider de deux manières.
Premièrement, les recherches montrent que l’ouverture au commerce est un facteur clé pour accélérer la diffusion des technologies. L’achèvement du marché unique des services peut donc stimuler la productivité en augmentant les échanges de services, qui devraient être plus importants dans un marché pleinement intégré. Les services représentent plus de 70 % du PIB de l’UE, mais seuls 20 % des services font l’objet d’échanges transfrontaliers, ce qui ne représente que 5 % du PIB de l’UE.
Le deuxième élément consiste à créer un véritable marché unique des capitaux. Des marchés financiers profonds jouent un rôle essentiel dans la facilitation de la diffusion, en fournissant aux entreprises le capital-risque nécessaire à la commercialisation de nouvelles technologies. Mais les possibilités offertes par notre vaste marché financier ne sont pas exploitées.
Dans la zone euro, seuls environ 30 % des titres de créance et 20 % des actions sont détenus par des investisseurs d’autres pays, et seulement environ 10 % des actifs du secteur bancaire sont détenus par des succursales et des filiales de banques transfrontalières. L’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux sont des mesures essentielles pour améliorer cette situation.
Dans l’ensemble, les gains découlant de ce programme seraient considérables. Selon une estimation, la suppression de toutes les barrières commerciales pourrait augmenter les revenus de l’UE de 14 % sur dix ans et doubler les échanges intracommunautaires.
Cela souligne pourquoi, en particulier pour les pays confrontés à une faible productivité, inverser le cours de l’intégration européenne ne serait pas une voie rentable. De plus, dans un environnement international où l’ouverture commerciale ne peut plus être considérée comme acquise, un marché intérieur large et profond pourrait devenir encore plus important pour nous protéger des chocs extérieurs.
L’achèvement du marché unique présenterait également un autre avantage.
Les marchés intégrés, en particulier les marchés financiers, contribuent à partager les risques au sein des pays et entre eux. Ce partage privé des risques joue un rôle essentiel dans l’ajustement des unions monétaires qui fonctionnent bien, car les régions individuelles ne peuvent pas s’adapter aux chocs par la dévaluation de leur taux de change. Cela se fait par deux canaux principaux.
Le premier est celui des marchés de capitaux intégrés. En général, une récession entraîne une baisse de la consommation et des prix des actifs dans une région, ce qui renforce ensuite le ralentissement économique. Mais lorsque les particuliers peuvent diversifier leurs actifs dans différentes régions, ils peuvent lisser leur consommation en puisant dans les actifs qu’ils détiennent dans les parties les plus performantes de l’union.
Le deuxième canal est le secteur bancaire intégré. Les banques locales étant généralement très exposées à l’économie locale, un ralentissement économique entraîne des pertes importantes et les incite à réduire leurs prêts à tous les secteurs. Mais si des banques transfrontalières opèrent dans la région, elles peuvent compenser leurs pertes par des gains dans d’autres régions et continuer à fournir des crédits.
Aux États-Unis, on estime qu’environ 70 % des chocs locaux sont absorbés par les marchés financiers intégrés. Dans la zone euro, cependant, seuls 25 % des chocs sont absorbés de cette manière, car l’intégration financière est faible. Comme je l’ai expliqué ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles notre crise a été si longue et pourquoi certains pays ont divergé sur le plan économique.
En d’autres termes, le partage des risques favorise à la fois la stabilité et la convergence au sein des unions monétaires. Sans cela, il devient beaucoup plus difficile de maintenir des taux de croissance élevés.
Ainsi, pour stimuler la croissance et accroître le partage des risques privés, notre priorité devrait être la suivante : recentrer clairement nos efforts sur l’achèvement du marché unique dans toutes ses dimensions et, conformément à la stratégie définie par Jacques Delors, soutenir cette démarche à l’aide d’outils et d’institutions appropriés.
Aujourd’hui, ce soutien consiste avant tout à combler les lacunes qui subsistent dans l’architecture institutionnelle de l’UEM. Des mesures doivent être prises dans deux domaines clés.
Renforcer l’Union monétaire
Tout d’abord, nous devons nous attaquer aux obstacles qui continuent d’entraver une intégration financière plus poussée.
Nous avons déjà fait d’importants progrès dans cette direction avec la création d’une supervision bancaire européenne, d’un ensemble de règles harmonisées et du mécanisme de résolution unique. Le secteur bancaire a également connu une réduction considérable des risques, avec une augmentation des fonds propres des banques, une baisse de l’effet de levier et une réduction progressive des prêts non performants.
Mais il reste encore du travail à accomplir. Il s’agit notamment de terminer l’assainissement des bilans bancaires, car les actifs hérités du passé constituent un frein aux acquisitions transfrontalières, et surtout de supprimer les obstacles réglementaires et prudentiels qui entravent encore les activités transfrontalières.
Par exemple, malgré l’union bancaire, la réglementation limite toujours la libre circulation des capitaux et des liquidités au sein des banques transfrontalières. Cela réduit les gains d’efficacité pour les banques opérant à l’échelle européenne et freine l’intégration de la banque de détail.
Toutefois, l’uniformisation des règles du jeu ne suffit pas à elle seule à assurer une intégration financière profonde, et c’est là le deuxième point. Le débat actuel est souvent présenté en termes de dichotomies : partage des risques privés contre partage des risques publics, et partage des risques contre réduction des risques. Mais je pense que, dans une large mesure, ces différents objectifs sont complémentaires et non substituables.
Prenons l’exemple des restrictions à la libre circulation des liquidités et des capitaux. Ces obstacles existent en partie parce que le cadre de résolution bancaire dans la zone euro est incomplet et ne prévoit pas de filet de sécurité public. S’il existe un risque résiduel que les coûts de la résolution bancaire finissent par peser sur le bilan d’un seul gouvernement, les autorités nationales auront intérêt à limiter les flux de capitaux et de liquidités afin de protéger leurs déposants en cas de défaillance d’une banque.
Avec un partage commun des risques publics grâce à un filet de sécurité pour le fonds de résolution, les incitations au niveau national à limiter les flux de capitaux et de liquidités disparaîtraient. Cela conduirait à son tour à une plus grande intégration bancaire et à un partage privé des risques au niveau de la zone euro.
Le partage des risques ne serait toutefois pas un moyen d’éviter la réduction des risques. Lorsque les marchés ont confiance dans la capacité des banques à être résolues efficacement, cela stabilise le système et réduit les coûts des crises. En d’autres termes, le partage des risques réduit en fait les risques.
Un bon exemple en est la Federal Deposit Insurance Corporation aux États-Unis, qui est également l’autorité de résolution et qui est soutenue par une ligne de crédit du Trésor américain. Pendant la crise, elle a procédé à la résolution d’environ 500 banques sans provoquer d’instabilité financière. Cela a été possible grâce à la confiance dans l’efficacité du cadre de résolution et au soutien des ressources nécessaires à sa mise en œuvre.
La même interaction s’applique également aux politiques budgétaires.
Nous avons vu pendant la crise comment l’absence de marge de manœuvre budgétaire, nécessaire pour stabiliser l’économie, peut créer un cercle vicieux de faible croissance, d’augmentation des écarts de rendement des obligations et de pertes sur prêts dans le secteur bancaire. Cela peut à son tour entraîner une fragmentation financière.
Tant que ce risque existe, il est évident qu’il freinera une intégration financière profonde. Cela signifie également que le partage des risques privés a tendance à s’effondrer précisément au moment où il est le plus nécessaire.
Pour y remédier, la première priorité consiste à rendre les politiques budgétaires nationales plus efficaces en encourageant les gouvernements à constituer des réserves. Pour cela, nous devons rétablir la confiance dans nos règles budgétaires en les rendant à la fois plus contracycliques et plus contraignantes.
Mais nous savons que même des politiques nationales saines ne suffisent pas toujours. Les marchés peuvent parfois réagir de manière excessive et pénaliser les États souverains, au-delà de ce qui serait nécessaire pour rétablir une trajectoire budgétaire viable. Et ce dépassement peut nuire à la croissance et, en fin de compte, aggraver la viabilité budgétaire. C’est pourquoi le partage public des risques a également un rôle à jouer, même si plus nous achevons l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux, moins ce rôle doit être important.
Le mécanisme européen de stabilité ne peut pas combler entièrement cette lacune, car il conduit généralement à un resserrement budgétaire procyclique. Nous avons donc besoin d’un instrument budgétaire supplémentaire pour assurer la stabilisation. Il devrait exister un instrument qui complète la politique monétaire en assurant la stabilité macroéconomique tant au niveau de la zone euro que, surtout, dans chacun de ses États membres.
Comme je l’ai déjà indiqué ailleurs, la forme que devrait prendre cet instrument budgétaire reste à débattre. Mais toute proposition devrait remplir les deux conditions suivantes.
Premièrement, elle devrait être adéquate, afin de pouvoir rétablir la pleine capacité de stabilisation budgétaire. Deuxièmement, elle devrait être conçue de manière à limiter l’aléa moral. Si ces conditions sont réunies, un tel instrument devrait être considéré comme un moyen de réduire les risques plutôt que de les accroître.
Conclusion
Permettez-moi de conclure.
Nous traversons une période difficile. Et les périodes difficiles sont riches d’enseignements.
Plutôt que de critiquer les opinions de nos adversaires ou de proposer des solutions simplistes à des questions complexes, qui sont invariablement erronées, essayons de comprendre quels sont ces enseignements. L’exemple des pères fondateurs de notre union monétaire nous apporte une aide précieuse dans cette entreprise.
Nous ne devons pas nous laisser décourager par le fait qu’il reste encore du travail à accomplir pour achever notre Union. Aucune union n’est parfaite dès le premier jour. Il s’agit d’un processus évolutif qui est bien décrit par l’engagement à construire « une union plus parfaite » inscrit dans la Constitution américaine.
L’histoire montre que cette évolution tend à suivre les priorités des citoyens.
Dans les années 1980, l’objectif premier était de sortir de l’« eurosclérose » qui frappait l’Europe à l’époque, et la croissance est devenue la priorité absolue.
Aujourd’hui, les priorités sont la sécurité personnelle et économique, la lutte contre le chômage des jeunes et le renforcement des modèles sociaux afin de mieux prendre en charge les malades, les personnes âgées et les chômeurs.
Comment atteindre ces objectifs ? Aujourd’hui, comme il y a trente ans, la réponse réside dans la relance de la croissance et dans le respect de nos valeurs européennes communes.