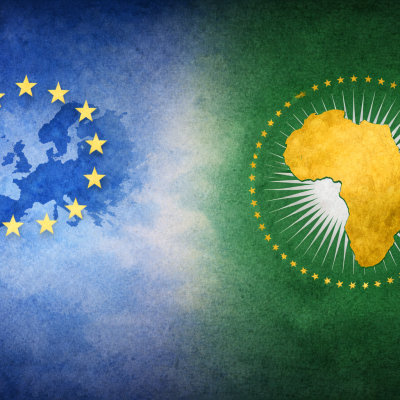[EN] Crise de la dette, crise de souveraineté

La crise financière qui frappe la plupart des pays occidentaux résulte de la combinaison d’une crise bancaire et d’une crise de la dette « souveraine » (appelée ainsi parce qu’il s’agit de dettes émises par des États). Certains efforts ont été entrepris pour faire face à la crise bancaire en termes d’effets (via la recapitalisation) plutôt qu’en termes de causes (en matière de réglementation financière), mais la plupart des efforts visent la crise de la dette souveraine. Cela prend une forme particulière dans la zone euro, non pas parce que sa situation financière est plus critique que celle des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais parce que les conditions d’exercice des souverainetés y sont moins fluides et plus complexes. Cette crise de souveraineté suscite à juste titre des débats politiques très animés, pour lesquels il semble essentiel de poser les quatre principaux enjeux.
1 – La perte de souveraineté de nombreux États membres est due à leur dépendance excessive vis-à-vis des créanciers privés
La crise de la « dette souveraine » est due à une dépendance variable mais excessive de nombreux États membres vis-à-vis des créanciers privés, qui acceptent d’acheter leurs bons du Trésor à des taux de plus en plus prohibitifs. Cette méfiance croissante des marchés financiers a contraint la plupart des pays européens à mettre en œuvre d’importants ajustements budgétaires, économiques et sociaux. Cinq gouvernements de la zone euro ont déjà subi les conséquences de ces ajustements, largement commentés au sein des institutions européennes.
Le profil des personnalités à la tête des gouvernements grec et italien a relancé le débat sur les raisons de ces changements, leur passage à la BCE (Lucas Papademos) ou à la Commission (Mario Monti) ayant notamment été évoqué. Ce débat ne doit pas occulter l’essentiel, à savoir que ce ne sont pas principalement l’UE et ses règles imparfaites qui ont conduit certains de ses États membres dans une telle situation, mais ces pays eux-mêmes, en perdant le contrôle de leurs comptes et, par conséquent, leur souveraineté.
Ce rappel n’exclut pas que l’UE doive renforcer l’aide qu’elle apporte aux pays en difficulté pour résoudre une crise qui, de facto, touche la zone euro dans son ensemble. La création d’« euro-obligations », comme l’a récemment proposée la Commission, permettrait l’émergence de dettes plus « souveraines », car elles seraient émises au niveau et au service de tous les États membres de la zone euro. Tout comme une intervention massive éventuelle de la BCE, cela contribuerait à éteindre l’incendie actuel, mais ne résoudrait pas les problèmes structurels qui ont conduit les États européens à perdre le contrôle de leur destin – et qui nécessitent la mise en œuvre de réformes de grande envergure.
2 – La crise de la dette renforce la capacité d’influence de l’UE sur les politiques économiques et sociales nationales dans un contexte politique incertain
La pression des marchés a accéléré la mise en œuvre des réformes structurelles que l’OCDE et l’UE appellent les États membres de l’UE à mettre en place depuis plus de dix ans, via des recommandations formulées dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et par la BCE. Ces réformes font désormais office de contrepartie aux actions de solidarité européenne selon des mécanismes dont la portée politique est variable : une « conditionnalité » de type « FMI » assez stricte imposée aux pays bénéficiant d’une aide financière ; un nouveau pacte de stabilité facilitant l’imposition de sanctions aux pays qui perdent le contrôle de leurs déficits ; un « pacte euro plus » pour la compétitivité, dont l’impact reste vague ; un projet de modification des traités visant à « graver dans le marbre » un engagement à contenir les déséquilibres des comptes nationaux.
C’est dans les pays aidés, en particulier en Grèce, que ce renforcement de l’interventionnisme de l’UE a déjà suscité de vifs débats. Ces débats pourraient s’étendre à la plupart des pays européens, même si c’est de manière moins spectaculaire : il s’agit de trouver le meilleur équilibre entre l’indépendance des politiques économiques et sociales nationales et le respect effectif des contraintes communes liées au partage d’une monnaie unique. Ces débats devraient se cristalliser autour du contrôle européen des budgets des États, surtout s’il intervient avant les votes des parlements nationaux, mais aussi sur l’équité des réformes engagées, qui est une question presque entièrement nationale. Ces débats sont essentiels d’un point de vue symbolique et pratique. Mais il est important de les aborder en sachant que l’UE ne va pas transformer d’un seul coup ses recommandations de type OCDE en injonctions de type FMI, car sa légitimité à « imposer » des réformes risquerait alors de rester illimitée en dehors de la période de crise – c’est pourquoi une coordination plus intégrée pourrait s’instaurer entre un nombre limité de pays volontaires.
3 – Les appels à une intervention européenne accrue relancent naturellement le débat sur le fédéralisme, qui se concentre paradoxalement sur le rôle de la BCE
Premier paradoxe : ce débat rappelle que l’UE est déjà une fédération, qui n’apparaît pas comme un mythe, souhaitable ou dénoncé, mais comme un outil politique utile, fondé sur l’exercice conjoint de certaines compétences (par exemple en matière commerciale ou monétaire) et sur l’intervention d’institutions fédérales telles que la Cour de justice ou la BCE.
Deuxième paradoxe : l’intervention massive de la BCE en tant que prêteur en dernier ressort est présentée par un certain nombre d’acteurs et de commentateurs comme la solution la plus efficace pour faire face à la crise ; mais ces mêmes personnes refusent souvent tout avenir fédéral en matière économique ou budgétaire.
Troisième paradoxe : comme d’autres fédérations, l’UE est régie par des traités, souvent négociés et ratifiés avec beaucoup de difficulté, qui font office de « contrat de mariage » dont on ne peut se libérer sans dommages politiques et psychologiques. Ces traités stipulent que la BCE est indépendante et qu’elle a donc pour vocation d’agir comme elle le juge utile, pour lutter contre l’inflation, qui a un impact sur la croissance, la compétitivité et la cohésion sociale des pays européens, ainsi que pour préserver la stabilité financière de la zone euro : elle l’a fait jusqu’à présent, y compris contre l’avis de pays présentés comme très influents, tels que l’Allemagne, sans satisfaire les pays présentés comme très exigeants, tels que la France.
4 – La crise met sous pression les démocraties nationales, qui doivent être respectées tant dans les pays bénéficiaires de l’aide européenne que dans les pays qui l’accordent
Le changement de gouvernement intervenu dans plusieurs pays en difficulté a eu lieu après des élections (Irlande, Portugal et Espagne) ou juste avant celles-ci, après trois mois de gouvernement intérimaire (Grèce). En Italie, ce changement est intervenu après un vote de défiance du Parlement, qui a ensuite largement soutenu Mario Monti, les prochaines élections devant se tenir, à ce stade, à la mi-2013. Les règles formelles de la démocratie parlementaire ont donc été respectées dans ces cinq pays. Les sondages d’opinion à ce stade soulignent la légitimité des gouvernements grec et italien, malgré les discussions compréhensibles qui ont suivi leur arrivée.
Les règles démocratiques doivent également être respectées dans les pays appelés à financer les plans d’aide européens, qui suscitent des controverses légitimes. Ces controverses ont fait tomber le gouvernement slovaque et ont ébranlé plusieurs coalitions au pouvoir, par exemple en Allemagne, confrontées à des opinions publiques parfois hostiles et sous la supervision logique des parlements nationaux. La prise en compte des positions de chacun tout en essayant de mieux comprendre leurs doutes et leurs inquiétudes contribue également beaucoup à la gestion démocratique de la crise actuelle.
Il est probablement inévitable que cette « crise de souveraineté » conduise les dirigeants européens et nationaux à faire preuve de capacités de leadership leur permettant de convaincre ou de défier leurs opinions publiques. Il est peut-être également inévitable de devoir attendre à nouveau que « la nécessité soit la mère des lois », dans une fédération d’États-nations dont les États et les peuples peinent à s’accorder sur des décisions bénéfiques tant au niveau national qu’européen.