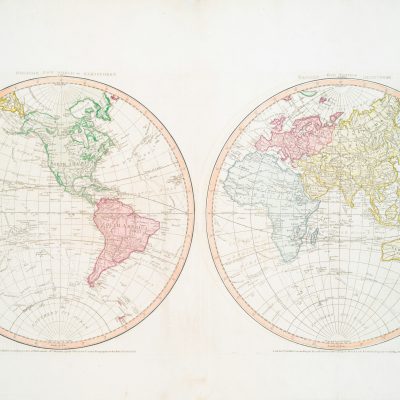[EN] La politique étrangère européenne peut-elle relancer le processus constitutionnel ?
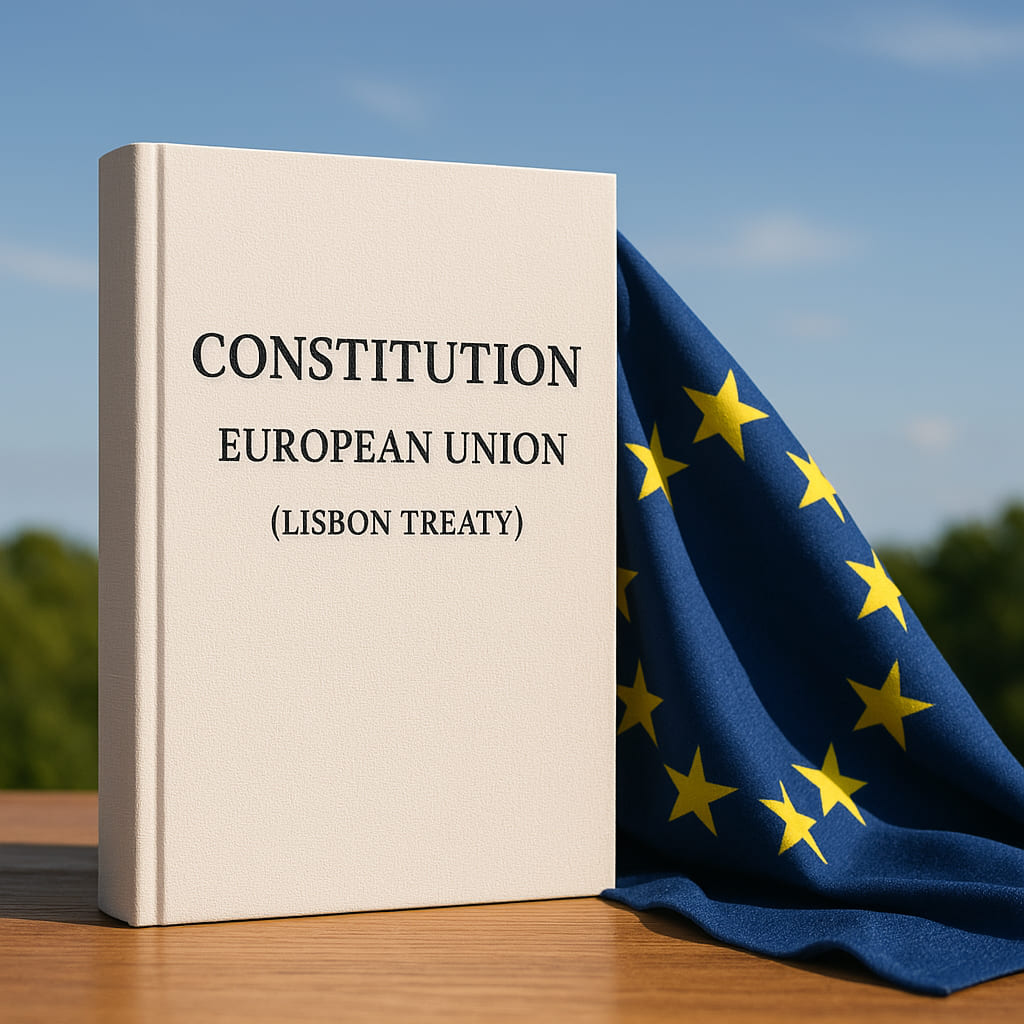
Cette étude est la deuxième d’une série de contributions que Notre Europe propose de publier afin de remettre le processus d’intégration sur les rails après le revers infligé par les référendums français et néerlandais.
Dans la première, le député européen Andrew Duff s’est penché sur les moyens de préserver les éléments essentiels du traité constitutionnel. La présente publication poursuit la discussion en jetant un regard critique sur l’avenir du volet « politique étrangère » du projet de Constitution.
Ce sujet mérite notre attention particulière pour plusieurs raisons. Depuis de nombreuses années, les sondages d’opinion montrent que c’est dans le domaine de la politique étrangère que la demande d’une voix européenne est la plus forte. Cependant, les mécanismes de coopération intergouvernementale mis en place à Maastricht et à Amsterdam n’ont pas beaucoup aidé l’Europe à s’affirmer sur la scène internationale, alors que les dispositions pertinentes du traité avaient fait l’objet d’un consensus relatif, tant lors de leur élaboration par la Convention que lors des débats de ratification.
Il est donc tout à fait logique de réfléchir à la meilleure façon de préserver cet acquis. Cela implique-t-il pour autant l’élaboration d’un traité distinct reprenant les principales avancées du traité constitutionnel ? Jean de Ruyt, ambassadeur de Belgique à Rome, a le mérite de prendre le taureau par les cornes, et ce avec prudence. Car le démantèlement du traité aurait de nombreuses conséquences.
Le traité constitutionnel reflète un équilibre fragile entre les préférences divergentes des États membres et il ne serait pas facile d’en retirer tel ou tel élément sans ouvrir la voie à un exercice de « cherry picking », qui aboutirait inévitablement à réduire les ambitions du projet constitutionnel.
Gilles Andreani, auditeur principal à la Cour des comptes et professeur associé à l’université Panthéon-Assas Paris II, aborde la question sous un autre angle. Évoquant les faiblesses structurelles qui ont empêché la PESC de tenir les promesses de Maastricht, il passe sans concession en revue quinze années de progrès éphémères, aujourd’hui compromis par la crise irakienne et l’élargissement. Dans ce contexte, il conclut qu’il serait vain d’attendre grand-chose de la mise en œuvre des dispositions du traité, aussi utiles soient-elles. Mieux vaut privilégier une approche pragmatique axée sur un petit nombre de questions clés, telles que le Moyen-Orient, la Russie ou l’Iran, et sur des réformes modestes visant à renforcer rapidement la coopération entre les gouvernements nationaux européens.Ces perceptions très contrastées ont en commun la volonté de faire avancer les choses sans se livrer à des envolées lyriques sur le destin de la politique étrangère européenne, comme cela a été le cas jusqu’à présent, sans résultat. Notre Europe publie ces études dans le but de faciliter le passage d’une analyse critique, aussi discrète soit-elle, à un débat. En espérant un nouveau départ.