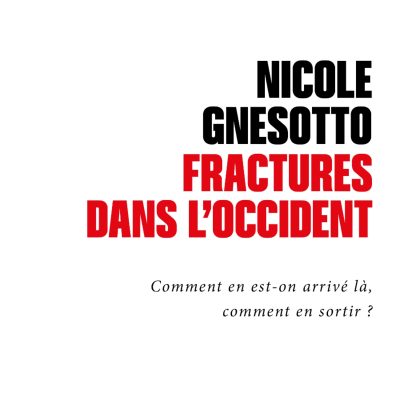[EN] Le traité de Lisbonne: bilan et perspectives

Au début de la dernière décennie, la perspective d’une adhésion des pays qui s’étaient affranchis du joug soviétique a rendu nécessaire une réforme des institutions et des règles de fonctionnement de l’Union européenne. Le traité laborieusement élaboré lors du Conseil européen de Nice à la fin de l’année 2000 n’ayant pas apporté de réponse satisfaisante, il s’est avéré nécessaire que l’UE se remette à la tâche, tout en cherchant à répondre aux défis démocratiques auxquels elle était désormais confrontée. La solution a été trouvée dans la Convention sur l’avenir de l’Europe et son projet de « traité constitutionnel ». Celui-ci a ensuite été rejeté et remplacé par le traité de Lisbonne.
Bien que signé en décembre 2007, le traité n’est officiellement entré en vigueur que le 1er décembre 2009. Il contient des innovations marquantes, notamment le statut institutionnel du Conseil européen, l’extension des pouvoirs du Parlement européen, la création des fonctions de président permanent du Conseil européen et de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la mise en place d’un service diplomatique européen, etc.
Ces nouvelles mesures ont-elles déjà eu un impact sur le cours de la construction européenne ? Quel a été leur impact sur l’évolution des équilibres politiques et institutionnels qui sous-tendent les négociations au cœur de ce qui n’est plus un « triangle » institutionnel, mais un « trapèze » ? Cette étude tente de répondre à ces questions en dressant un bilan éclairant des dix-huit premiers mois de mise en œuvre du traité de Lisbonne et en examinant les perspectives d’avenir.