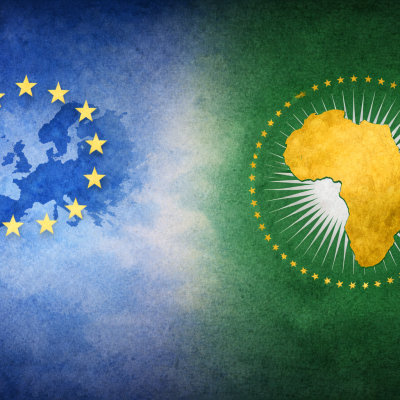[EN] Le « TSCG » : beaucoup de bruit pour rien ?

Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’UEM (TSCG), signé le 1er mars 2012, a déjà suscité des critiques dont l’ampleur est inversement proportionnelle à la longueur du document (16 articles assez courts) et au temps qu’il a fallu pour le rédiger (quelques semaines). Il est important de faire le point sur ces critiques et sur les impacts d’un tel traité sur l’UE, ses États membres et ses citoyens, en s’appuyant sur quatre séries d’observations politiques, juridiques, économiques et institutionnelles.
1 – Le « TSCG » est avant tout un instrument politique au service de la dialectique « solidarité européenne – responsabilités nationales ».
Son objectif est de rétablir le pacte de confiance entre les États membres dans un contexte marqué par le non-respect fréquent des règles de bonne gestion adoptées à Amsterdam il y a 15 ans et par les actes de solidarité européenne rendus nécessaires par la crise, alors qu’ils avaient tendance à être exclus de jure. Liée tant sur le plan politique que juridique au traité qui institue le « mécanisme européen de solidarité », la « TSCG » est souvent présentée comme un « pacte budgétaire », alors que seule la troisième partie porte ce titre. Elle souligne que son objectif principal est de formaliser la volonté des États membres d’être sérieux dans la gestion de leurs comptes tout en proposant une coordination légèrement renforcée des politiques économiques nationales.
Ce message de responsabilité s’adresse en particulier à des pays comme l’Allemagne. D’une part, parce qu’ils font preuve de solidarité dans la crise de la dette souveraine et souhaitent que les causes structurelles de cette crise soient traitées au-delà des sauvetages à court terme ; d’autre part, parce qu’ils ont des doutes quant à la crédibilité de leurs partenaires, qu’ils soient aidés ou non, et ont donc besoin d’être rassurés sur leur engagement à long terme. Un tel message s’adresse également à la Banque centrale européenne (BCE), qui a souligné à juste titre que ses achats de dette souveraine sur le marché secondaire et les niveaux élevés de liquidité qu’elle a accordés aux banques ne pouvaient avoir d’effets réels s’ils n’étaient pas accompagnés d’une action résolue des autorités nationales, notamment en matière budgétaire.
Il est difficile de souhaiter davantage de solidarité de la part de l’Allemagne et de saluer l’activisme de la BCE sans comprendre la logique politique qui a conduit à la signature du « TSCG », qui permet d’approfondir de manière plus européenne la dialectique solidarité/responsabilité à l’œuvre depuis le début de la crise. Et nous pouvons également voir ce traité non seulement comme un outil de compensation pour la solidarité déjà accordée, mais aussi comme ouvrant la voie à un approfondissement de cette solidarité, par exemple via les euro-obligations.
2 – La valeur ajoutée du « TSCG » par rapport au droit communautaire est limitée, voire incertaine
Si l’on examine le « TSCG » d’un point de vue strictement juridique, on constate que sa valeur ajoutée semble beaucoup plus limitée. La plupart de ses dispositions figurent déjà dans des textes de droit dérivé récemment adoptés (en particulier le « six-pack »), en cours d’adoption (l’exemple du « two-pack ») ou qui auraient pu être adoptés sans qu’un nouveau traité soit nécessaire. C’est donc principalement pour des raisons symboliques et politiques que la rédaction d’un traité a été choisie.
En matière de surveillance des politiques budgétaires, on peut bien sûr noter l’insertion d’une « règle d’or » au niveau national. Il s’agit toutefois d’une innovation dont l’effet juridique et pratique reste encore assez vague à ce stade, tout comme les dispositions prévoyant le renforcement des pouvoirs de la Cour de justice européenne. En matière de surveillance des politiques économiques, la quatrième partie du « TSCG » apporte très peu d’avancées par rapport au « pacte Euro Plus », compte tenu de la difficulté logique pour l’UE d’influencer les choix économiques et sociaux des États membres dans le détail, sauf dans les rares cas où ceux-ci ont conclu avec elle des programmes d’aide et d’ajustement (Grèce, Irlande, Portugal).
Le « TSCG » ne devrait en outre être signé que par 25 des 27 États membres de l’UE, mais il pourra entrer en vigueur dès que 12 des 17 États de la zone euro l’auront ratifié, ainsi que les huit autres pays qui l’auront ratifié, tandis que le Royaume-Uni et la République tchèque resteront en dehors. Outre ces incertitudes quant à sa portée, l’impact de la mise en œuvre du « TSCG » sur le fonctionnement du marché unique, qui constitue le fondement juridique et politique de l’intégration européenne, est incertain. Malgré les garanties contenues dans le texte même du traité, il sera bien sûr nécessaire de veiller au maintien de ce fondement, notamment sur la base d’une évaluation formelle et régulière.
3 – Une contribution économique insuffisante qui nécessite l’ajout d’un élément « croissance »
Parce qu’il met fortement l’accent sur la dialectique « solidarité-responsabilité », le « TSCG » est déséquilibré d’un point de vue économique. La stabilité et l’austérité sont nécessaires mais insuffisantes, à court et à moyen terme, dans une UE qui a également besoin de croissance.
Les négociations qui ont conduit à la conclusion du « TSCG » ont certes permis d’introduire davantage de références à la croissance, à l’emploi et à la cohésion sociale (aux articles 1 et 9). Il appartient donc plus que jamais aux institutions européennes de tirer le meilleur parti de ces bases juridiques sans se limiter à la dimension « disciplinaire » du nouveau traité.
Il leur appartient en particulier de profiter des moments décisionnels européens de 2012 pour réaffirmer que l’UE peut être une source de croissance. La relance du marché unique, la renégociation du cadre financier pluriannuel et l’émission d’obligations pour financer de grands projets d’infrastructure doivent donc être les autres volets d’une stratégie économique plus globale dont le « TSCG » n’est qu’un élément.
4 – Un traité intergouvernemental qui renforce utilement les pouvoirs des parlements et de la Commission
Parce qu’il s’agit d’un traité « intergouvernemental » et non communautaire, le « TSCG » a enfin relancé le débat sur les équilibres institutionnels au sein de l’UE, voire sur la « méthode communautaire ».
La mise en place d’un cadre d’action réunissant 25 États, des sommets de la zone euro avec un président permanent ou l’implication des parlements nationaux dans la gouvernance de l’Union économique et monétaire (UEM) : tels sont les éléments qui montrent à quel point la solidarité et la responsabilité accrues qui ont émergé de la crise nécessitent que les autorités politiques nationales se mobilisent davantage dans un cadre suffisamment formalisé, afin d’éviter un « leadership de facto » souvent mal perçu (cf. les critiques à l’encontre du « Merkozy »).
Dans ce contexte, l’implication des parlements nationaux doit être plus clairement précisée, mais aussi mieux articulée avec celle du Parlement européen, qui doit rester pleinement engagé dans la gouvernance de l’UEM, tant dans le « continuum » des démocraties nationales et de la démocratie européenne que dans le cadre de ses relations avec la Commission.
De même, le fait d’avoir dû donner la priorité à une voie intergouvernementale ne semble pas avoir entravé l’effort sans réserve de la Commission, pour laquelle le « TSCG » vise à renforcer les pouvoirs de surveillance et de contrôle en matière budgétaire et économique. Il s’agit là d’un progrès qui peut sembler paradoxal, mais qui est en réalité logique, car la Commission est la mieux placée pour agir de manière efficace et à long terme dans ces deux domaines, comme le prévoit déjà le droit dérivé de l’UE relatif à l’UEM.