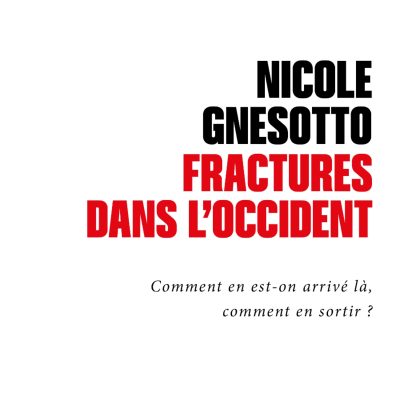[EN] Maastricht : Les cinq piliers de la sagesse
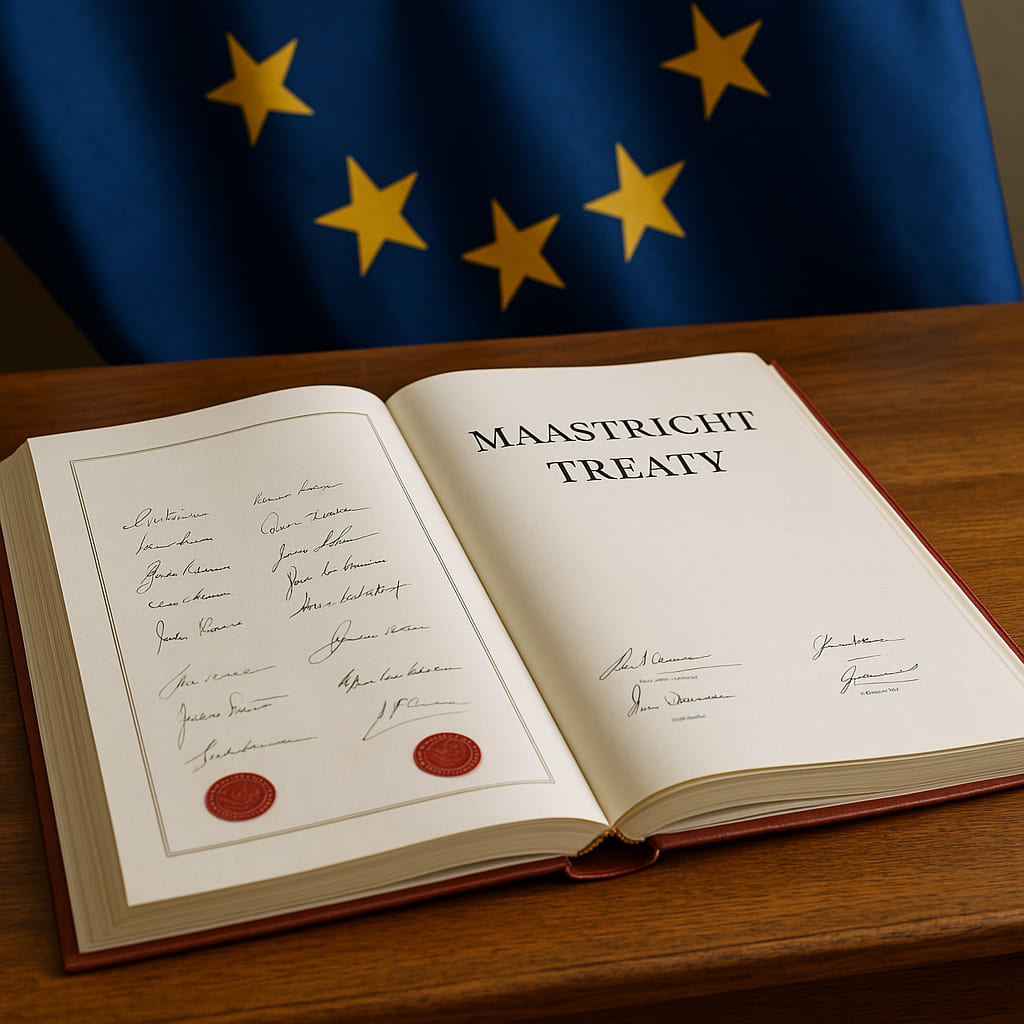
Vingt ans se sont écoulés depuis le sommet de Maastricht qui a donné naissance à l’« Union européenne » et posé les bases d’un certain nombre d’initiatives politiques majeures, dont l’Union économique et monétaire (UEM). Les événements de ces derniers mois ont remis ces initiatives sur le devant de la scène et ont donné lieu à des critiques parfois justifiées, mais souvent excessives. Il semble donc utile de replacer leur impact dans son contexte.
1 – Une union monétaire mise en place pour des raisons économiques et géopolitiques qui restent d’actualité
Le sommet de Maastricht est avant tout célèbre pour avoir ouvert la voie à la création de l’euro. Pour des raisons économiques : « pas de marché unique sans monnaie unique », étant donné que la dévaluation des monnaies nationales rend impossible une comparaison saine des prix et brouille la perception des investisseurs. Et (plus important encore) pour des raisons géopolitiques : après la chute du mur et la réunification de l’Allemagne, il était important d’envoyer un signal en faveur d’un renforcement de l’intégration européenne et de sceller la volonté des Européens de s’unir dans la pierre des traités et dans l’intimité du portefeuille des citoyens. Étant donné que le passage à la monnaie unique impliquait un sacrifice politique majeur pour l’Allemagne, il reposait en grande partie sur les critères de bonne gestion en vigueur dans ce pays.
Mais les chefs d’État et de gouvernement réunis à Maastricht n’ont pas voulu ou n’ont pas pu assumer toutes les conséquences du « rapport Delors », qui les exhortait à construire une UEM équilibrée, donc une union fondée sur une forte coordination des politiques économiques nationales. Ce n’est qu’au sommet d’Amsterdam, en 1997, que la « régulation interne » de l’UEM a été définie de manière détaillée, avec l’adoption du pacte de stabilité.
Ce que nous enseigne la crise actuelle, c’est que cette « réglementation interne » – qui aurait dû être respectée de manière plus rigoureuse – présentait certaines lacunes tant dans sa conception (absence de surveillance des dettes privées ou des déséquilibres macroéconomiques) que dans sa mise en œuvre (les sanctions étant infligées par les États membres, qui sont ainsi à la fois juge et partie). La récente réforme du pacte de stabilité a désormais permis de remédier à plusieurs de ces lacunes, avec des mesures qui pourraient bientôt être inscrites dans les traités.
Il n’est guère surprenant que, compte tenu de son ampleur, la crise actuelle ait relancé le débat sur les fondements mêmes de l’UEM. Mais cela devrait inciter à se demander si les raisons économiques et géopolitiques sur lesquelles les chefs d’État et de gouvernement réunis à Maastricht ont fondé leur travail sont vraiment devenues totalement caduques – et si une Europe dans laquelle chaque pays aurait conservé sa propre monnaie aurait mieux résisté à la tempête économique et financière actuelle.
2 – L’adoption d’un « protocole social » politiquement et juridiquement bienvenu
« Maastricht » a également marqué l’adoption d’un « protocole social » initialement signé par 11 États membres, sous l’impulsion de Jacques Delors. Ce protocole consacrait un message politique essentiel en faveur de la construction d’une Europe équilibrée, vouée non seulement à l’intégration économique, certes bénéfique, mais aussi à une économie sociale de marché.
Ce protocole social a insufflé un nouveau dynamisme aux négociations entre les partenaires sociaux, tant au niveau de l’UE, en leur accordant un droit d’initiative législative, qu’au sein des comités d’entreprise européens. Il a conduit à l’adoption de nombreux accords et normes, notamment dans les domaines de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail.
Ce protocole semble avoir progressivement épuisé son impact positif, mais l’adoption du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux offre désormais de nouvelles bases juridiques propices à lui donner un nouvel élan. Il ne fait aucun doute que la crise actuelle doit inciter tant la Communauté que les autorités nationales à se saisir de cette question, mais aujourd’hui comme hier, il s’agit avant tout de trouver la volonté politique de le faire.
3 – Une politique étrangère commune en manque de moyens, mais un objectif à atteindre malgré tout
Le sommet de Maastricht a également donné naissance à la célèbre « politique étrangère et de sécurité commune » (PESC), fondée sur la prise de conscience claire que les pays européens devaient unir leurs forces s’ils voulaient avoir un poids dans le monde de l’après-guerre froide. La plus grande erreur des chefs d’État et de gouvernement a été de ne pas doter l’UE des ressources politiques et institutionnelles nécessaires pour atteindre cet objectif. Ces ressources ont toutefois été progressivement renforcées, d’abord par le traité d’Amsterdam (qui a institué la fonction de haut représentant), puis par le traité de Lisbonne (qui a créé le Service européen pour l’action extérieure).
Ce « nominalisme » irréfléchi a toutefois logiquement alimenté un processus dans lequel la « PESC » n’a pas vraiment existé au cours des vingt dernières années, alors que l’UE a souvent agi efficacement dans les affaires extérieures, notamment grâce à son élargissement ou à ses politiques commerciales. Le sommet de Maastricht a au moins eu le mérite de rendre publique la nécessité d’une action extérieure commune, qui bénéficie d’ailleurs d’un large soutien populaire. Plus que jamais, il appartient aux autorités nationales et européennes de donner corps à cette action dans un monde où l’Europe rétrécit.
4 – Une coopération structurée dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Le « troisième pilier » du traité adopté à Maastricht a conduit à la mise en place d’une coopération policière et judiciaire afin de mieux réglementer la libre circulation des personnes au sein de l’UE – la fameuse « quatrième liberté », qui est la plus tangible de toutes. Il a également conduit l’UE à s’impliquer dans les domaines de l’immigration et de l’asile.
Cette impulsion politique a progressivement déclenché le développement d’une tendance spectaculaire à la mutualisation communautaire dans les domaines du droit civil, de l’immigration, de l’asile et de la gestion des frontières (traité d’Amsterdam), puis également du droit pénal (traité de Lisbonne), bien que ces domaines soient largement dominés par les souverainetés et les droits nationaux.
Il reste beaucoup à faire pour faciliter la vie des citoyens européens qui choisissent de vivre dans un autre État membre de l’UE, ainsi que dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, qui sont devenues des frontières communes mais dont le contrôle reste largement national. À ce stade, il s’agit de renforcer les outils européens mis en place pour aider les États membres (Frontex, le Fonds de solidarité, etc.), à moins bien sûr que l’on envisage de revenir aux frontières nationales, ce qui serait à la fois coûteux et inefficace.
5 – La proclamation d’une « citoyenneté européenne » qui doit être approfondie
Enfin, le sommet de Maastricht a été une déclaration nous indiquant que la construction européenne concerne directement les citoyens européens, en leur conférant des droits supplémentaires par rapport à ceux dont ils jouissent au niveau national. Ces droits comprennent le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales et européennes, qui symbolise l’appartenance à deux communautés au sein desquelles tous les citoyens européens doivent pouvoir désigner ceux qui les représentent.
Les citoyens n’ont pas toujours pleinement exercé ces droits, alors qu’ils ont davantage profité de leur droit à la libre circulation, qui est devenu une sorte de « droit naturel » pour les jeunes générations. En renforçant encore les pouvoirs du Parlement européen et en instaurant un « droit d’initiative citoyenne », le traité de Lisbonne a accru les droits politiques dont jouissent les citoyens de l’UE. Il ne reste plus qu’à leur donner de bonnes raisons d’utiliser davantage ces droits.
Il convient toutefois de rappeler que la citoyenneté européenne s’exerce également lors des élections nationales, car celles-ci désignent les membres du Conseil européen et du Conseil des ministres, qui jouent un rôle crucial dans la vie communautaire, et que c’est au niveau national que les citoyens continuent d’exercer leurs droits politiques fondamentaux, étant donné que l’intervention de l’UE est régie par le « principe de subsidiarité », autre principe proclamé à Maastricht.
Ainsi, vingt ans après le sommet qui les a institués, les « cinq piliers » du traité de Maastricht semblent dans l’ensemble constituer encore des fondements politiques et juridiques solides sur lesquels construire – c’est un fait dont nous ferions bien de tenir compte en ces temps troublés.