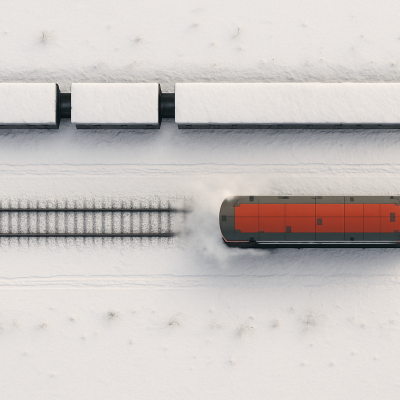Objectifs climatiques 2030: un défi plus politique que technique
Ce blogpost est une version enrichie issue d’une tribune publiée en exclusivité dans Les Echos le 2 juillet 2025.

En Europe, dire que le Pacte vert européen (European Green Deal) n’est plus en odeur de sainteté relève de l’euphémisme. Appels à une « pause réglementaire »[1], conduite d’une politique de simplification aux velléités dérégulatoires[2], détricotage des objectifs climatiques précédemment fixés par crainte d’un « backlash » [contrecoup] écologique, nombreux sont les exemples qui illustrent cette triste réalité.
Dans ce marasme politique ambiant, la dernière évaluation publiée par la Commission européenne pourrait pourtant faire office d’éclaircie bienvenue. Elle y estime que l’Union européenne (UE) serait en capacité d’atteindre une baisse de 54% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, soit un écart de seulement 1% par rapport à l’objectif fixé de moins 55% (par rapport à 1990). Pour en arriver à cette conclusion, l’exécutif européen a passé au crible les Plans Nationaux Energie-Climat de vingt-quatre des Etats membres (exception faite de la Belgique, l’Estonie et la Pologne) qui recensent les actions et politiques publiques que chaque pays entend entreprendre afin de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques. Porteuse d’espoir, cette analyse doit cependant être tempérée et ce, pour au moins trois considérations politiques.
Pessimisme de la raison
Premièrement, quel crédit peut-on réellement accorder aux engagements pris par les Etats membres dans le cadre de cet exercice de planification à la maille européenne? La tenue, tout comme la teneur des engagements climatiques affichés, demeure intrinsèquement liée à la coloration politique du pouvoir en place au sein de chaque Etat. Que ce soit suite au résultat d’élections[3], du fait de contraintes budgétaires ou pour tout autre raison, une redéfinition des priorités politiques en matière énergétique – comme c’est par exemple le cas actuellement en France – pourrait conduire à revoir à la baisse les ambitions initialement affichées auprès de la Commission européenne. In fine, cela questionne la capacité de cette dernière à faire respecter lesdits engagements, en utilisant les outils juridiques à sa disposition, chose qu’elle s’est jusqu’à présent refusé à faire. Car pour elle il existe un risque, celui de braquer un peu plus les Etats membres, dans un contexte où son capital politique, dès lors que l’on aborde la question climatique, est déjà largement entamé.
Deuxièmement, l’analyse de la Commission repose sur une double conditionnalité, à savoir une mise en œuvre à droit européen constant du Pacte vert et qui devra en parallèle être diligente. Dit autrement, pour que la baisse des émissions de 54% soit effective, il faudrait que soient appliqués au sein des vingt-sept, en temps et en heure, les lois et objectifs européens tels qu’ils furent votés au cours de la précédente mandature. Or, rien que sur le secteur des transports, principal poste d’émissions au niveau européen, les récents assouplissements pour les constructeurs automobiles en matière de règles sur les émissions de CO2, ceux attendus concernant la fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035, ou encore le retard de plusieurs Etats membres (dont la France) dans la transposition de l’extension du marché carbone européen aux secteurs des transports (et du bâtiment et de la petite industrie) illustrent l’absence de prise en compte de la réalité politique actuelle dans l’analyse opéré par la Commission européenne.
Troisièmement, les plans remis par les capitales ne détaillent ni les montants, ni la manière dont seront mobilisés les financements (publics et privés) afin de mener à bien cette transition écologique. Alors que l’UE connait un déficit en matière d’investissement climat de près de 2% du PIB européen (soit environ 400 milliards d’euros), la seule banque de décarbonation censée mobiliser 100 milliards d’euros sur dix ans sera insuffisante. A cela s’ajoute l’expiration, fin 2026, des fonds issus de la Facilité pour la reprise et la résilience, dont 37 % étaient dédiés au climat, soit environ 275 milliards d’euros. Par ailleurs, s’ouvriront à l’été les discussions concernant le prochain budget pluriannuel européen (2028-2034). Un statu quo en terme de montant total des dépenses de ce dernier (30% soit environ 360 milliards d’euros) alloués aux objectifs liés au climat serait un moindre mal eu égard la multiplication des priorités au niveau européen à l’instar des agendas de sécurité et de défense ou encore de compétitivité.
Ainsi, si elle reste techniquement réalisable, modulo des ajustements dans les secteurs de transports, bâtiments et de l’agriculture, l’atteinte de nos objectifs climatiques pour 2030 semble, en l’état, politiquement difficilement réaliste puisque reposant intrinsèquement sur le volontarisme de plus en plus défaillant des Etats.
Optimisme de la volonté
Pourtant, renoncer au Pacte vert européen, ne constituerait rien d’autre que la trahison de la promesse démocratique née suite aux élections européennes de 2019. Promesse à cette jeunesse désabusée qui avait su, à travers un élan mobilisateur sans précédent, légitimer démocratiquement l’adoption de plus de soixante lois sectorielles dont les retombées devraient se matérialiser au cours des prochaines années. Or, la crise des prix de l’énergie l’a prouvé[4], l’accélération de la décarbonation de notre société est un élément de résilience face aux chocs géo-économiques qui rythment le monde. L’Agence Internationale de l’Energie a ainsi pu chiffrer à 100 milliards d’euros le montant des économies réalisées par les consommateurs européens d’électricité entre 2021 et 2023 grâce au déploiement additionnels d’énergies renouvelables.
Comme démontré plus haut, la réussite de la transition repose désormais sur la capacité de nos décideurs à ne pas céder aux sirènes populistes qui les enjoignent à renier tout ou partie de leur héritage politique. Elle repose également sur la mobilisation de l’ensemble des forces vives. Celles à même d’articuler un discours qui permette d’inscrire la question de la décarbonation de notre économie au-delà des seuls enjeux de durabilité. En effet, de l’avenir du Pacte vert européen dépendra la faculté de l’UE à tenir ses objectifs climatiques mais surtout, de sa faculté à proposer un projet de société fédérateur.
[1] Nguyen, P.-V. « Pacte vert: vers une « pause réglementaire européenne » ? », Décryptage, Institut Jacques Delors, janvier 2024.
[2] Nguyen, P.-V. « L’énergie, bien plus qu’un marché », Blogpost, Institut Jacques Delors, juin 2025.
[3] Thalberg K., Defard C., Chopin T., Barbas A. & Kerneïs K. « The European Green Deal in the face of rising radical right-wing populism», Policy Paper n. 296, Paris : Jacques Delors Institute, January 2024.
[4] Nguyen, P-V., Pellerin-Carlin, T. « Flambée des prix de l’énergie en Europe », Institut Jacques Delors, 6 octobre 2021.