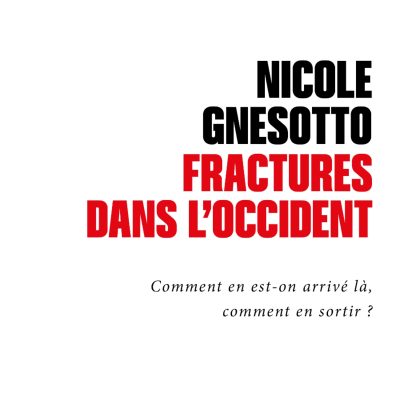Quelle réponse européenne aux défaillances de l’état de droit?

La décision de la Commission d’enclencher en décembre 2017 la première phase de l’Article 7 du TUE, qui pourrait in fine priver la Pologne de ses droits de vote au Conseil de l’UE, se révèle par exemple inefficace dans le court terme, la phase punitive requérant l’unanimité au sein du Conseil, où Varsovie est assurée du veto de la Hongrie.
Face à cela, l’idée de lier le respect de l’état de droit à l’obtention des fonds structurels européens dans le prochain cadre pluriannuel financier a été mise en avant par plusieurs chefs d’État et commissaires européens. Une telle suspension ne serait pas sans risque politique et son efficacité pose question mais elle traduit le besoin de développer une gamme d’outils plus étendus, plus sophistiqués et plus mordants que l’Article 7.
La solution ne doit pas venir seulement de la Commission européenne ni du Conseil, mais d’autres institutions, notamment de la Cour européenne de Justice. Les organisations de la société civile dans ces pays sont aussi des relais à appuyer. Les rôles de l’Agence des droits fondamentaux et de la Commission de Venise sont à intégrer. Tous ces instruments doivent pouvoir servir à faire renoncer ces pays à aller plus loin dans d’éventuelles réformes contraires à l’état de droit. La Commission et les États de l’UE intéressés doivent aussi dorénavant être clairs sur le fait que ces mesures ont vocation à être utilisées afin de renforcer leur effet dissuasif.