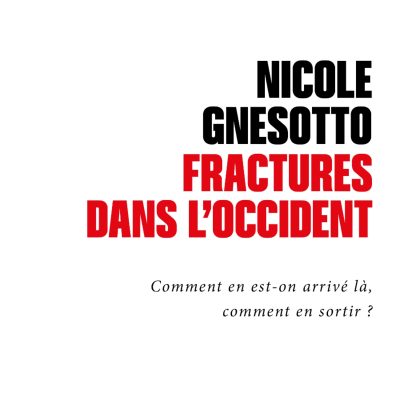Réaction de James Fishkin à l’article d’Andrew Moravcsik sur l’échec du traité constitutionnel

La critique de Moravcsik à l’égard de la consultation populaire dans l’UE se concentre en particulier sur deux liens de causalité qu’il juge douteux1 : premièrement, « une participation accrue génère une délibération plus éclairée » et, deuxièmement, « une prise de décision plus éclairée ou plus intensive génère une plus grande confiance du public et un sentiment plus profond d’identité commune et de légitimité » (p. 222). Les prétendues failles de ces propositions remettent en cause l’idée selon laquelle « des formes démocratiques plus populistes et délibératives » « génèrent participation et légitimité » (p. 221).
La difficulté fondamentale de cette critique réside dans le fait qu’elle ne fait pas la distinction entre les formes « populistes » et « délibératives » de démocratie. En effet, l’argument semble les traiter comme si elles étaient presque interchangeables. Nos recherches soulèvent de sérieuses questions quant à la critique de Moravcsik. Nous convenons que de nombreuses formes populistes de participation ne contribuent en rien à la délibération. Tout dépend de la conception institutionnelle (voir Fishkin, Democracy and Deliberation, Yale University Press, 1991). Une mobilisation irréfléchie n’est pas une délibération. Parler à des personnes qui partagent les mêmes idées n’est pas une délibération. Une structuration minutieuse est nécessaire pour permettre un échange de points de vue éclairé et civilisé. Grâce à une conception appropriée, nous avons constaté dans le cadre de la recherche sur les sondages délibératifs que la délibération contribue à pratiquement tous les aspects souhaitables de la citoyenneté. Nous pensons donc que la troisième proposition de Moravcsik peut être sérieusement remise en question (voir Luskin et Fishkin, « Deliberation and Better Citizens » sur http://cdd.stanford.edu pour des preuves des effets de la délibération sur plusieurs dimensions de la citoyenneté). Et dans le sondage délibératif britannique de 1995 sur les questions européennes, nous avons constaté que la délibération citoyenne renforçait le soutien à l’intégration de la Grande-Bretagne dans l’UE. Moravcsik a donc tort d’affirmer que les recherches en sciences sociales soutiennent systématiquement l’idée que le débat public diminue nécessairement la légitimité de l’Union européenne. Il s’agit là de questions empiriques ouvertes. Parfois, le débat public délibératif l’a clairement renforcée.
Nous convenons que la montée du populisme peut nuire à la délibération. S’il y avait eu quelque chose de plus reconnaissable comme une délibération citoyenne sur la constitution, certains des autres objectifs de la citoyenneté européenne auraient peut-être été atteints. Nos expériences avec les sondages délibératifs le suggèrent clairement. Par conséquent, une délibération microcosmique télévisée, combinée à des stratégies appropriées pour étendre la portée de ces efforts à un public plus large, aurait pu conduire à un débat différent et peut-être à un résultat différent. En tout état de cause, un retour à un débat réservé aux élites ne servira pas la légitimité de l’UE, tandis qu’une évolution vers une participation délibérative du public, plutôt qu’une simple participation populiste, pourrait y contribuer.